Anjou
Séjour en Anjou du 7 au 12 juin 2004 Après une bonne frayeur pour accéder à l’hôtel résidence de Voir Ensemble qui organisait le séjour, nous avons passé une nuit tout près de l’INJ au lieu de rendez-vous pour prendre l’autocar qui nous a conduit à Angers. Après 4 heures de voyage sous un soleil de plomb, ce sont 50 personnes qui ont pris leur premier repas en commun dans un restaurant de la vieille ville d’Angers. Après le déjeuner le groupe c’est grossi de 5 éléments indispensables pour le séjour Jean-Jacques, Henri, Yves Pierre et Alphonse qui vont nous accompagner tout au long de notre périple en Anjou. Ces cinq gaillards sont un groupe d’amis de la Pommeraye, qui sur la proposition de Jean-Jacques adjoint au maire de Pommeraye ont répondu présent pour nous guider.
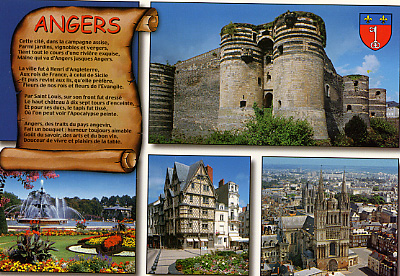 ANJOU: Ancienne province de la France axée sur la Loire, l'Anjou doit son renom à son riche passé historique. La capitale de la région, Angers, ville des arts et des fleurs, réunit les fonctions de ville-marché et de centre administratif. Géographie physique Le territoire de l'Anjou s'étend sur les départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de l'Indre-et-Loire. Région de carrefour, en contact avec les dernières assises du Massif armoricain, à l'ouest, et du Bassin parisien, à l'est, l'Anjou se divise en trois ensembles bien individualisés: l'Anjou noir, à l'ouest, l'Anjou blanc, à l'est, les vallées de la Loire, du Loir, de la Mayenne, de la Sarthe. L'Anjou noir regroupe le bocage Ségréen ou Craonnais, pays de plateaux peu élevés, et les Mauges. Les sols schisteux et humides sont couverts par un paysage de bocage. L'Anjou blanc est formé par les terrains tertiaires du Bassin parisien, parfois fertilisés par des placages de sable. Les vallées de la Loire, du Loir, de la Mayenne, de la Sarthe constituent le cœur de l'Anjou. Économie L'économie de l'Anjou noir est orientée vers l'élevage des bovins et des porcs. Dans l'Anjou blanc, les plateaux du Baugeois, au nord, portent des forêts de chênes et de pins et des cultures arbustives (pommiers, poiriers). Au sud, le Saumurois, plus riche, possède une économie agricole plus diversifiée: riches labours sur les plateaux; vignobles réputés et champignonnières sur les coteaux. Dans les vallées, la douceur du climat et la fertilité des terres alluviales irriguées sont favorables à la culture de légumes, de primeurs et de fleurs (hortensias bleus, porte-graines), ainsi qu'aux pépinières, sans oublier le vin des coteaux de la Loire. Sur les terres les plus riches est pratiqué l'élevage bovin. Cholet, principale ville de l'Anjou armoricain, possède des industries textile (lin, coton), agroalimentaire, chimique. C'est aussi un important marché aux bestiaux. Angers est un grand marché agricole (fruits, légumes, vins d'Anjou) qui a su combiner les activités traditionnelles et les techniques de pointe et l'électronique. Histoire Habitée par les Andecavi, peuple celtique, la région correspondant à l'Anjou est occupée par les armées de César en 57 av. J.-C. et incorporée à la province Celtique puis à la Lyonnaise (dont la capitale est Lugdunum, Lyon). Après avoir subi plusieurs invasions barbares, l'Anjou, à la suite de la bataille de Vouillé (507), est uni au royaume mérovingien. Situé aux confins de l'Aquitaine et de la Bretagne, il acquiert très vite une certaine importance grâce à son rôle stratégique, mais, en contrepartie, il subit maintes fois les attaques des Normands, que Robert le Fort réussit à repousser en 866. Au IXe siècle, l'Anjou est érigé en comté et ses seigneurs, en particulier Foulques III Nerra (972-1040), agrandissent, par achat ou par conquêtes, leur domaine des Mauges, du Saumurois et de la Touraine. À ces provinces, Geoffroy II Martel, fils de Foulques Nerra, ajoute le Vendômois et une partie du Maine. À sa mort, Geoffroy ne laisse aucun fils et c'est son neveu, Foulques IV le Réchin, qui lui succède, fondant ainsi la seconde maison d'Anjou (fin du XIe siècle). Une puissante principauté À partir de cette période, l'Anjou devient une puissante principauté féodale, parfaitement dirigée; il connaît une grande prospérité qui se traduit par les progrès des défrichements et de la viticulture, par l'essor des villes et des foires et par le rayonnement des abbayes romanes. Au milieu du XIIe siècle, l'importance de l'Anjou décuple lorsque Foulques V le Jeune, devenu roi de Jérusalem en 1131, marie son fils Geoffroy V Plantagenêt à Mathilde, fille du roi d'Angleterre Henri Ier Beauclerc. Par ce mariage, Geoffroy aspirait au trône d'Angleterre, mais il obtient seulement le duché de Normandie (1144). En revanche, son fils, Henri II Plantagenêt, devient successivement comte d'Anjou (1151), duc d'Aquitaine (1152) après son mariage avec Aliénor d'Aquitaine, puis roi d'Angleterre (1154). L'Anjou est alors un élément fondamental de l'«Empire Plantagenêt», qui s'étend de l'Écosse aux Pyrénées. La conquête de l'Anjou par Philippe II Auguste (1203) est reconnue par le traité de Chinon (1214). En 1246, il est donné en apanage au frère de Saint Louis, Charles, qui est à l'origine de la deuxième maison d'Anjou. Le pays traverse alors une période de prospérité économique. Les marchands de l'Europe du Nord, qui viennent y négocier le sel et le vin, contribuent à l'essor des ports de la région littorale. Le rattachement à la Couronne Charles et ses successeurs sont surtout préoccupés par leurs aventures méditerranéennes et apportent à l'Anjou la Provence et le royaume de Naples (les Angevins ayant été chassés de Sicile en 1282). Le fils de Charles Ier d'Anjou, Charles II, donne en dot à sa fille Marguerite l'Anjou et le Maine, lors de son mariage avec Charles de Valois (1290). Aussi reviennent-ils à la couronne de France à l'avènement de Philippe VI de Valois (1328). Mais, constitué en apanage par Jean II le Bon pour son fils cadet Louis Ier, l'Anjou est de nouveau associé au royaume de Naples. Durant la guerre de Cent Ans, ses princes seront fidèles à la cause française. À la mort du roi René d'Anjou (1480), chef de la branche aînée, et de Charles du Maine (1481), chef de la branche cadette, Louis XI recueille par succession la majorité des possessions de la maison d'Anjou. Ces dernières appartiennent désormais à la couronne de France. Du XVIe au XVIIIe siècle, plusieurs princes de sang portent le titre de duc d'Anjou: Henri III avant son avènement au trône, son frère François, duc d'Alençon, et le petit-fils de Louis XIV, qui devient roi d'Espagne sous le nom de Philippe V. Durant les guerres de Religion, l'Anjou est dévasté, de 1560 à 1598, et Saumur devient un centre de résistance protestante. Pendant la Révolution, la province est le théâtre de luttes violentes entre les Chouans et les armées révolutionnaires. En 1790, il forme pour l'essentiel le département de Maine-et-Loire, amputé au nord de la Mayenne et au sud de la Vienne. MAISON D’ANJOU: La première maison d'Anjou est issue des vicomtes d'Angers. Le comte Foulques V le Jeune, roi de Jérusalem, se maria deux fois. De lui sont issues deux branches: celle des derniers rois de Jérusalem et celle de la dynastie anglaise des Plantagenêt. La deuxième maison d'Anjou est capétienne. Philippe II Auguste reprit le comté à Jean sans Terre en 1203, et le futur Saint Louis érigea l'Anjou en comté-pairie pour son frère Charles Ier (1246), qui devint roi de Sicile. De cette deuxième maison sont issues les branches de Hongrie, de Naples, de Durazzo et de Tarente. La troisième maison d'Anjou est issue de Charles de Valois, père du roi de France Philippe VI, qui épousa Marguerite d'Anjou-Sicile, petite-fille de Charles Ier. Le Maine et l'Anjou formèrent sa dot. Jean le Bon les donna en apanage à son second fils, Louis Ier d'Anjou, adopté par la branche de Naples, ce qui fut la cause des guerres d'Italie (XVe-XVIe s En route pour le musée du Cointreau à Saint-Barthélemy d’Anjou situé dans la banlieue d’Angers. Le musée se divise en 4 espaces: l’espace produit qui permet de découvrir tout le processus de distillation de la liqueur Cointreau, l’espace entreprise qui nous fait voyager pendant 150 ans, avec l’histoire du Cointreau et de la famille Cointreau, l’espace communication pour s’imprégner de toute la saga publicitaire de la maison Cointreau puis l’espace dégustation afin de savourer la fameuse liqueur. Les différentes étapes de l’élaboration du cointreau sont la sélection des matières premières, la distillation, la finition puis enfin l’embouteillage. Le Cointreau est fabriqué à partir d’écorces d’oranges amères et douces, de sucre, de l’alcool de betterave neutre purifiée à 96 degrés. Les écorces douces proviennent du Brésil et d’Espagne quant aux écorces amères elles sont importées des Caraïbes. Les écorces d’oranges amères est le résultat de la cueillette d’oranges encore vertes, l’écorce étant encore très épaisse elle est très riche en huile essentielle. C’est le mélange des 2 sortes d’écorces douces et amères qui donnent le goût spécifique au Cointreau. Nous sommes dans la salle des alambics qui sont au nombre de 19 où on nous explique l’opération de distillation. On remplit d’immenses containers des écorces d’oranges, de l’alcool et de l’eau que l’on laisse macérer toute une nuit afin d’hydrater les écorces d’oranges. Puis on effectue la distillation qui dure entre 5 et 6 heures, cette opération est réalisée en injectant de la vapeur d’eau à 140 degrés. Les vapeurs d’alcool chargées en huiles essentielles s’échappent de l’alambic par le col de cygne qui surmonte la marmite. Les vapeurs d’alcool circulent dans une colonne ce qui permet de la condenser en liqueur, la distillation se déroule en plusieurs phases dont les premières vapeurs que l’on appelle les crêtes de distillation sont trop chargées en alcool. La crête de distillation ainsi que la queue de distillation qui par contre n’est pas chargée en alcool sont récupérées dans une cuve à part, en fait, on extrait uniquement que le cœur de la distillation. L’alcool distillé appelé (alcoolat) à une teneur en alcool de 86 degrés, c'est l'étape suivante dite finition qui en ajoutant de l'au purifiée donnera une liqueur chargée de 43 degrés d'alcool. Il existe deux sortes d'alambics à colonne à partir de 1970 et à boule qui date des années 1950, tous deux sont situés au-dessus de la marmite. Les alambics sont toujours en cuivre malgré qu'ils soient récents, le cuivre étant un bon conducteur de chaleur. La finition du produit ne se limite pas qu'au coupage de l'alcoolat, on passe le mélange dans une centrifugeuse afin d'enlever les derniers résidus puis vient une seconde phase de coupage où on ajoute du sucre liquide. Après la distillation on vide la marmite où ont macéré les écorces, les opérateurs tirent avec des râteaux les résidus d'écorces dans des brouettes puis ils les transportent dans une cuve creusée dans le sol. La maison cointreau à une politique de recyclage des déchets les écorces d'oranges après distillation sont revendues à des élevages de sangliers ou de bovins pour leur alimentation. Après la certification de l'environnement, l'entreprise s'est engagée sur la certification de la sécurité. Aujourd'hui l'entreprise emploie 220 CDI et 60 CDD, la production annuelle est de 30 millions de bouteilles dont 95% sont exportées. Depuis 150 ans ce sont 4 générations qui portent la liqueur cointreau aux 4 coins du monde, c'est en 1849 à Angers que deux frères Edouard-Jean et Adolphe Cointreau, héritiers d'une ancienne lignée de maîtres boulangers confiseurs décident de devenir distillateurs liquoristes et créent la société Cointreau frères. Ils sont primés à l'exposition universelle de Paris en 1867, Edouard Cointreau successeur dès son retour de la guerre de 1870 continua à développer l'entreprise. C'est au cours de ses nombreux voyages que Edouard Cointreau trouve l'idée d'une liqueur, le coeur en sera l'orange et la couleur cristalline. Dès son mariage en 1875 sa femme devint l'âme de l'entreprise en développant sa politique sociale, quelques mois plus tard Edouard trouve la formule idéale du Cointreau qui ne changera plus. En 1878 lors de l'exposition universelle il obtient sa première médaille pour sa toute nouvelle liqueur, une grande épopée va alors commencer pour la maison Cointreau. La liqueur est contenue dans une bouteille carrée telle un coffre-fort ambré qui l'emporte au-delà des océans. En 1885 face à de nombreuses contrefaçons, il dépose sa marque et fait la promotion de son produit dans le monde entier. Pour la publicité il imagine le célèbre pierrot, la liqueur devient la boisson des rois Edouard VII et Anne d'Autriche succombent à ses charmes. Ses fils Louis et André créent des filiales à travers toute l'Europe puis conquièrent l'Amérique. En 1934 André est seul à la tête de l'entreprise, il est député du Maine et Loire, président des vins et spiritueux il poursuit la modernisation de l'entreprise. Pendant la seconde guerre mondiale l'usine est endommagée, à la libération l'entreprise participe à l'effort de reconstruction de la cité et termine l'agrandissement de la distillerie. Pour son centenaire en 1949 on inaugure les nouveaux bâtiments et on octroie le treizième mois au personnel. C'est alors que la nouvelle génération Pierre, robert et Max sont associés aux affaires. Dans les années 60, Cointreau installe ses bureaux sur la plus belle avenue du Monde les Champs Elysées à Paris, des accords de partenariat sont signés avec les marques Picon, Isara, Saint-James et Rémi Martin. En 1968, on atteint les 12 millions de bouteilles et la distillerie est transférée de Angers à Saint-Barthélemy d'Anjou où la nouvelle distillerie est inaugurée en 1972. Les anciens alambics sont conservés et installés à côté d'une nouvelle chaîne d'embouteillage automatique. Aujourd'hui Pierre Cointreau est président de la société et Robert, son cousin est vice-président d'honneur. En 1990, la société Cointreau a fusionné avec l'entreprise de cognac Rémi Martin qui est devenu la société Rémi Cointreau. Cette nouvelle société a racheté de nombreuses autres entreprises comme des fabricants de jus de fruits, de champagne, de vodka, de vin, de whisky etc. Nous parcourons une passerelle de 170 mètres de long qui surplombe tout l'espace de production, on aperçoit l'espace où l'on effectue la phase de finition puis les lignes d'embouteillages. Tout le long de la passerelle nous découvrons toute la saga publicitaire de la maison Cointreau dont le fameux Pierrot sous toutes ses formes qui fut l'emblème de la maison Cointreau pendant 50 Ans. D'immenses cuves qui contiennent 100000 litres de Cointreau sont dressées dans l'usine. Nous passons devant une vitrine qui renferme 200 contrefaçons de la fameuse bouteille carrée, ces bouteilles représentent tous les procès gagnés. Après le Pierrot, la bouteille fut ornée d'une estampille Cointreau sous laquelle est passé un ruban rouge. L'embouteillage est constitué de 11 lignes entièrement automatisées: le dépalettiseur prend les bouteilles vides sur les palettes pour les disposer sur le convoyeur ou tapis roulant, une machine dispose le ruban rouge sur la bouteille, une autre machine colle l'estampille, la vineuse injecte une goutte d'alcool dans la bouteille pour un dernier nettoyage, la tireuse remplit la bouteille de liqueur et place le bouchon sur le goulot, la sertisseuse bouche la bouteille, l'étiqueteuse ajuste l'étiquette, ensuite les bouteilles sont placées dans des cartons qui seront fermés puis collés et disposés sur des palettes filmées prêtes à être livrées chez le client. Toute cette chaîne est automatisée, elle débite 6000 bouteilles à l'heure. La production annuelle de liqueur est de 12 millions de litres, la maison Cointreau n'a jamais connu de grève. Après une visite de plus d'une heure, nous nous sommes rendus au bar de l'usine où nous dégustons un cocktail à base de Cointreau. Ensuite nous avons rejoint notre hôtel qui se trouve à une trentaine de kilomètres d'Angers et de Cholet, c'est un village de 3000 habitants qui se nomme la Pommeraye. La Pommeraye doit son expansion à son ancien maire qui fut sénateur et président du conseil général du Maine et Loire. Le village est le siège social de 3 grandes entreprises de transports routiers dont une possède plus de 1000 véhicules. La commune possédait un couvent qui comprenait 900 religieuses de la congrégation de la Providence, aujourd'hui le couvent s'est transformé en maison de retraite pour religieuses et religieux. Après la seconde guerre mondiale, l'école laïque a été fermée car une des institutrices avait collaboré avec les Allemands, dans la région les établissements catholiques sont fortement implantés. Jusqu'en 1984 la Pommeraye ne comptait qu'une seule école privée mais depuis l'école laïque a réouvert pour répondre à la demande. La Pommeraye possède un collège privé de 600 places dont les deux tiers sont des enfants de la commune. Exceptionnel pour un village de 3000 habitants, il possède un lycée privé qui offre 200 places ce qui signifie qu'un enfant de la Pommeraye peut être scolarisé de la maternelle à la terminale. Le village est situé sur un promontoire domaine du vignoble d’Anjou, qui domine la vallée où coule la Loire. En route pour le château d’Angers que nous allons visiter avec une guide, qui nous a remis un document en braille relatif à la fameuse forteresse. ANGERS: Chef-lieu du département de Maine-et-Loire, sur la Maine; la ville rassemble 156 327 habitants [1999] (Angevins) et son agglomération 309 370 [1999]. Nœud de communication et centre commercial d'une riche région agricole. Constructions mécanique, électrique et électronique; textile et agroalimentaire; aéronautique. Université catholique ancienne et Université d'État récente. Centre national de la danse contemporaine. HIST. Place forte gauloise, puis cité romaine, plus tard capitale du comté d'Anjou, Angers fut rattaché à la couronne de France en 1480. ARTS. Bâti sur la rive gauche de la Maine, dominant la vieille ville, l'imposant château (reconstruit par Saint Louis au XIIIe s.) abrite un musée de tapisseries (tenture de l'Apocalypse, 1376). La ville possède de belles églises: cathédrale Saint-Maurice (XIIe et XIIIe s.), Saint-Martin (VIe-XIIe siècle), la Trinité (XIIe et XVIe siècle) et de remarquables édifices civils, notamment le palais épiscopal, ancien hôpital Saint-Jean (XIIe siècle), et le logis Barrault qui conserve un ensemble d'œuvres de David d'Angers. Nous abordons le château par une allée, nous franchissons le pont levis qui ne fonctionne plus, qui garantissait la porte de la ville. Le château a été construit en 1232, il occupe une surface de 22000 mètres carrés, le chemin de ronde mesure 1 kilomètre de long. L’ensemble est composé de 17 tours, le dernier duc d’Anjou qui a vécu ici est le roi René. Pendant sept siècles, des milliers de prisonniers ont été détenus dans cette forteresse, les murs font 2,80 mètres d’épaisseur. Nous pénétrons dans la cour du château, un jardin est implanté dans l’enceinte dont les plantes et la vigne sont réchauffées par l’ardoise qui constitue les murs. Les cents pieds de vigne cépage chemin donnent chaque année une centaine de bouteilles de vin blanc, dont la qualité est médiocre. Nous allons gravir par un escalier en colimaçon la tour du moulin, qui est la plus haute et la plus intacte de l’ensemble des 17 tours. Les 16 autres tours ont été endommagées au 16e siècle par ordonnance du roi, l’ordre avait été donné au gouverneur de l’époque le lieutenant Donadieu de Puycharic de détruire la forteresse qui était un sujet de conflit. Donadieu de Puycharic eut une idée géniale, tout en simulant le début de la destruction n’a fait que fortifier la forteresse en élargissant les remparts. La forteresse est construite face à la Maine afin de se défendre contre les Armoricains, les Normandes et les Anglais qui n’ont jamais pu en prendre possession. Dans la chapelle du château ont été détenus ou stockés plus de 500 prisonniers marins anglais, pour pouvoir les «entreposer», on avait construit des mezzanine en bois sur lesquelles on avait disposé des hamacs. Contrairement à un autre prisonnier connu Nicolas Fouquet, qui bénéficiait comme cellule le logis du gouverneur, c’est le chevalier D’Artagnan qui a accompagné le ministre des finances de Louis XIV à Angers. Nicolas Fouquet fut détenu dans la forteresse pendant 3 ans, puis après son procès il a été emprisonné à Paris pendant 19 ans. A partir du XIXe siècle, la forteresse est devenue une base militaire, nous approchons de la tour du moulin dans laquelle étaient détenus des prisonniers de tous genres. La tour est constituée de 3 niveaux, les murs du deuxième étage sont creusés d’ouverture d’archères et de canonnières puis nous arrivons à la plate forme de la tour du moulin. Nous sommes à 50 mètres d’altitude de la base de l’édifice, nous pouvons découvrir une vue panoramique de la ville et de la rivière. Au centre de la tour était disposé le moulin, la Maine est en contre bas du château ce qui fait que l’enceinte est creusée de fossés et non de douves. En fait, le château est construit sur un promontoire, les murs qui protègent le chemin de Ronde sont en ardoise. Le roi René était très apprécié de ses sujets, il est mort assez âgé pour le moyen âge, il était roi de Naples et de Sicile, duc puis comte d’Anjou. N’ayant pas eu d’enfant pour lui succéder, il a légué la tapisserie de l’Apocalypse à la cathédrale d’Angers. Le roi René a logé dans le logis royal qui se trouve dans l’enceinte du château; en empruntant le chemin de Ronde, nous nous dirigeons vers le jardin suspendu. Le roi René est décédé en 1480 à l’âge de 72 ans, son grand-père avait été le commanditaire de l’Apocalypse, il ne voulait pas que la tapisserie arrive entre les mains du royaume de France d’où ses legs. Nous pouvons admirer la cathédrale avec ses deux flèches, le roi René est mort à Aix en Provence. A sa naissance ses parents Yolande d’Aragon et Henri II l’ont prénommé René qui a une signification en latin Renatus, suite à un miracle un enfant mort fut ramené à la vie dont la sensation de renaître qui a donné le prénom René. Adoré par son peuple, René aime son Anjou par sa nature, son arboriculture, sa viticulture avec ses vins d’Anjou d’où son intérêt pour les jardins. Le jardin médiéval suspendu reconstitué en 1950 est constitué de ceps de vignes avec un rosier à chaque rangée afin de prévenir des maladies, d’absinthe, de buis, de la santoline, des campanules et bien d’autres plantes et fleurs. Ensuite, nous nous dirigeons vers la porte des champs en passant devant le logis du gouverneur où était détenu Fouquet, la porte des champs a été construite au XVIe siècle. Le pont-levis a été détruit, sous le porche nous pouvons voir les encoches où glissaient les deux herses au milieu desquelles était suspendu un assommoir. A travers d’allées qui serpentent dans un jardin, nous rejoignons la chapelle qui a servi de lieu de détention. Dans la chapelle sont exposées toutes sortes de matériel carcéral qui relatent sept siècles d’enfermement dans la forteresse du château d’Anjou des entraves de pieds, des colliers d’hommes en fer très lourds, des boulets de canons etc. la forteresse renfermait des prisonniers de guerre, de droit commun et des aliénés au moyen âge. Depuis la fin du XIXe siècle, les prisonniers ont déserté la forteresse pour la prison du Pré Pigeon, qui aujourd’hui est classée comme monument historique. En 1884, les aliénés vont aussi quitter la forteresse pour le nouvel hôpital psychiatrique construit dans la banlieue angevine. Enfin, nous nous dirigeons vers le musée qui renferme la tapisserie de l’Apocalypse, Ce musée contient de nombreux tableaux qui orne la galerie de l’Apocalypse qui a été construite en 1952 pour y exposer en 1954 la tapisserie qui à son origine mesurait 140 mètres de long sur 6 mètres de haut, chaque scène mesurait quant à elle 22,50 mètres de long. Aujourd’hui, la tapisserie est dressée contre un mur de 103 mètres de long, c’est la plus grande tapisserie médiévale au monde. Cette tapisserie n’a été exposée qu’une fois en intégralité lors du mariage des parents du roi René, à Arles en 1400. Sa spécificité est de n’avoir ni d’endroit, ni d’envers, il n’y a aucun nœuds, tout est dissimulé. La tapisserie est constituée de sept tableaux qui représentent chacun une scène, qui nous parle de l’apocalypse selon Saint-Jean. Le commanditaire de ce chef-d’œuvre est Louis Ier, duc d’Anjou, frère de Charles V roi de France au XIVe siècle. Trois noms apparaissent sur les factures: le peintre Hennequin de Bruges, Nicolas Bataille le marchand et Robert Poinçon le lissier, cette commande a été exécutée en 10 ans. L’Apocalypse a subi plusieurs avaries au cours des siècles, pendant la révolution on a découpé la tenture pour des besoins quotidiens, mais certains révolutionnaires vont mettre un terme à la destruction de l’Apocalypse. Dès sa nomination à la cathédrale d’Angers, le chanoine Joubert part à la recherche des pièces disparues. Son travail sera récompensé car il a pu reconstituer 103 mètres de la tapisserie initiale qui en comprenait 140, une scène complète est la propriété d’un riche collectionneur à Washington, une autre se trouve dans un musée à Glasgow. Ces tableaux qui forment l’Apocalypse servaient à décorer et réchauffer l’intérieur des châteaux. Sur ce chef-d’œuvre, nous avons une lecture biblique et une lecture socio-politique, car à l’époque, nous sommes pendant la guerre de Cent ans. Nous avons aussi beaucoup d’informations sur la végétation, on peut également comprendre les différentes échelles sociales par les figures et la façon de s’habiller. Après 2 heures de visite sous un ciel bleu, nous avons rejoint la Pommeraye pour y prendre le déjeuner. En route pour Cholet où nous allons visiter le musée d’art et d’histoire, nous passons devant le musée du textile que nous ne pourrons pas visiter. CHOLET: Chef-lieu d'arrondissement de Maine-et-Loire, sur la Moine, dans les Mauges; 56 320 habitants [1999] (Choletais). Gros marché aux bestiaux. Important centre industriel : textiles (lingerie, mouchoirs, cotonnades, confection), constructions mécaniques, matériel électronique, jouets, travail du cuir (chaussures) et du caoutchouc, conserveries. Musée des guerres de Vendée. Histoire Cholet est située dans une région où l'homme a laissé de nombreuses traces depuis la préhistoire: un cimetière néolithique, réutilisé par les Gaulois puis par les Romains, y fut mis au jour en 1884. La ville s'est formée au Moyen Âge autour de deux noyaux, sur la rive nord de la Moine. Le plus ancien, à l'est, se constitua sur le monticule de Livet autour d'une église fondée vraisemblablement au VIe siècle. Cette agglomération, d'abord appelée Aubigné, devint le bourg Saint-Pierre. Le noyau le plus récent, à l'ouest, est la cité féodale qui se développa au nord du château bâti au XIe siècle sur un escarpement rocheux dominant la rivière, et qui forma la paroisse Notre-Dame (1185). Cette structure demeura inchangée jusqu'à la fin du XVIIe siècle, époque à laquelle le marquis de Broon, seigneur de Cholet, réunit ces deux ensembles urbains par un nouvel axe, la rue des Vieux-Greniers. Un centre textile: Pendant la seconde moitié du XVIIe siècle, Cholet devint un centre important de négoce et de fabrication des toiles. En 1748, un bureau de la Marque y fut institué pour contrôler les produits de la manufacture. À la veille de la Révolution, la ville comptait 8 500 habitants, soit huit fois plus qu'un siècle auparavant. Une ville ravagée par les guerres de Vendée Pendant les guerres de Vendée, Cholet fut le théâtre de plusieurs combats qui provoquèrent sa destruction complète, et dont le plus meurtrier s'acheva par la victoire des républicains, le 17 octobre 1793. Durant ce conflit, la cité perdit plus des trois quarts de sa population: le recensement de 1797 faisait état de 2 162 habitants. L'industrialisation: Au XIXe siècle, les activités de la ville, en particulier l'industrie textile, reprirent rapidement. Le tissage fut mécanisé et concentré dans de grandes usines. Vers 1830, Cholet avait retrouvé sa population d'avant la Révolution; en 1857, elle devint la sous-préfecture du Maine-et-Loire. Le musée d’art et d’histoire de Cholet est implanté dans un ancien centre commercial qui n’a pas eu l’essor escompté, la municipalité a donc racheté le bâtiment puis elle a fait appel à 2 architectes qui ont transformé l’ancien Mag2 en musée. Le volume est divisé en plusieurs salles, la galerie d’art où sont exposés plus particulièrement des tableaux de peintres Choletais un certain Trémoliet, un autre dont le nom est Maindron et un contemporain Monsieur Morellet. Nous nous dirigeons vers la partie du musée Consacrée à l’histoire, pour la petite histoire des mines d’or ont été exploitées jusqu’en 1950 à Saint-Pierre-Montlimar. A la même époque les rues de Cholet ont été dépourvues de leurs pavés, pour remblayer le soutènement, on est allé chercher des remblais qui provenait des mines d’or de Saint-Pierre-Montlimar. C’est pour cela que aujourd’hui on dit que les choletais roulent sur l’or. La visite commence par le XVe siècle, Agnès Sorel était la maîtresse de François II, elle avait une cousine Antoinette de Magnolet qui l’a remplacée dans le lit et le cœur du roi à son décès. Demoiselle de Magnolet tira beaucoup de profit de sa liaison avec le roi qui se maria légitimement pour assurer sa succession, après sa rupture elle serait morte de Chagrin. Agnès de Magnolet s’était constituée une cour après avoir acheté la chatellerie de Cholet en 1460, les rendez-vous amoureux avec le roi François II qui était duc de Nantes se tenaient à Clisson, équidistant des 2 villes. Antoinette de Magnolet a été enterrée au couvent des cordeliers en 1470, pendant les guerres de religion 1568-1592, le couvent va être rasé ainsi que la chapelle où reposait le tombeau de Antoinette de Magnolet, la pierre tombale de la demoiselle de Magnolet sera mis à jour en 1870 et elle est exposée au musée. Pendant son passage à Cholet, elle attira la noblesse ce qui profita en terme économique à la cité. Deux rues portent des noms qui ont attrait à cette époque la rue Bel Ebat, la rue du Petit Conseil et la rue du Grenier à sel. La ville de Cholet est traversée par la Moine, qui au moyen âge délimitait le Poitou et l’Anjou. Le château de Cholet est construit face à la Moine, afin de protéger la ville des poitevins. En 1360, on a créé la gabelle qui était un impôt sur le sel, le Poitou en était exonéré, ce qui favorisait la contrebande. Il faut savoir que la gabelle multipliait le prix du sel par 40, on a donc installé un grenier à sel à Cholet. Un grenier à sel qui est constitué des officiers avec son grainetier, son receveur, un procureur, un avocat etc. vous aviez aussi un dépôt qui devait contenir 2 ans de réserve de sel pour un territoire qui en était le troisième élément, celui de Cholet comprenait 29 paroisses. Les officiers se réunissaient en petit conseil et formaient un tribunal, qui appliquait des sanctions à ceux qui trafiquaient avec le sel. La première fois, c’était une amende de 200 livres qui équivalait à une année de salaire, puis en cas de récidive on appliquait un lys au fer rouge sur l’épaule du contrevenant, puis la troisième sanction était l’envoi à Toulon pour être embarqué à bord de galère du roi. Nous arrivons en 1789 où la gabelle ne suffisait plus pour financer la royauté, Louis XVI et son gouvernement ont eu l’idée de récupérer les biens de l’église. Ces biens vont servir de contrepartie à une nouvelle monnaie l’assignat, la planche à monnaie a tellement tournée que l’assignat perdit beaucoup de sa valeur. Certains initiés ont fait fortune grâce à cette monnaie et l’état n’avait toujours pas d’argent, on a donc lancé les états généraux, la législative puis la convention. Trois dates importantes: le 3 janvier 1793 Louis XVI est décapité, puis on instaure la loi contre les prêtres qui vont être obligés de quitter le territoire national et le 3 mars 1793 c’est la première révolte dans Cholet. Le 14 mars 1793 c’est la prise de Cholet par les vendéens ou le début des guerres de Vendée, qui pour les Choletais se termineront le 14 octobre 1793 par la prise de la ville par les républicains. Nous passons dans une salle où sont exposés tous les tableaux qui représentent les chefs des vendéens, ces tableaux ont été commandés sous Louis XVIII pour les offrir aux familles de ces combattants, les tableaux ont été peints entre 1815 et 1830. Les guerres de Vendée désignent les luttes menées contre la Révolution, à partir de 1793, par les royalistes de l'Ouest. En 1789, la Vendée et les Mauges (sud de l'Anjou) étaient les régions où le régime seigneurial et l'esprit de la féodalité avaient le plus conservé leur aspect traditionnel. Les métairies du Bocage vendéen appartenaient à une noblesse souvent rapace à l'égard de ses tenanciers, mais qui avait le mérite de résider sur ses terres: elle n'aimait pas en sortir et même répugnait à servir dans les armées du roi. Elle avait conservé le gouvernement des affaires locales, qu'elle partageait avec le clergé. En effet, la Vendée était demeurée étrangère à l'indifférence ou à la tiédeur religieuse du XVIIIe siècle. Au contraire, la religion avait gardé des efforts missionnaires du XVIIe siècle une allure colorée et chaude, très différente de la piété sévère des cercles fervents au XVIIIe siècle. On aimait beaucoup les dévotions, particulièrement celle, toute récente, du Sacré-Cœur. La fidélité religieuse et monarchique La société vendéenne demeura dans la France révolutionnaire un îlot de stabilité. L'agitation naquit de l'application des lois révolutionnaires. La Constitution civile du clergé fut appliquée en Vendée comme ailleurs; mais la quasi-totalité de la population suivit les «bons prêtres», hostiles à l'Église constitutionnelle et poursuivis par les nouvelles autorités légales. Une organisation religieuse parallèle, bientôt persécutée, rassembla les Vendéens, épouvantés par la mort de Louis XVI, le 21 janvier 1793. L'exécution du roi atteignit en effet la sensibilité religieuse de la population. Le roi de France n'était pas un vulgaire chef d'État; il demeurait l'oint du Seigneur, et son existence paraissait liée à celle de l'Église. Le soulèvement de 1793 Les sentiments religieux et monarchiques, indissociables, furent à l'origine du soulèvement de mars 1793, bien que l'étincelle qui mit le feu aux poudres fût l'essai de conscription tenté par les autorités républicaines. Il s'agissait de trouver des volontaires pour l'armée ou de faire désigner par la population un contingent d'appelés. Alors, des bandes de jeunes Vendéens se répandirent de village en village et se lancèrent à l'assaut des petites villes où se tenaient les forces républicaines : Cholet et La Roche-sur-Yon furent prises. En quelques jours, la Vendée et les Mauges entraient en dissidence. Les républicains étaient massacrés; on fit disparaître drapeaux tricolores et emblèmes révolutionnaires. Les révoltés arborèrent le drapeau blanc et la fleur de lys, le chapelet et le Sacré-Cœur. L'organisation des forces La Vendée catholique et royale était née. La révolte spontanée avait été paysanne et populaire. Des chefs s'étaient improvisés sur-le-champ, dans le tumulte de la première agitation. Cathelineau était colporteur, Stofflet un ancien soldat devenu garde-chasse. Ici, un perruquier commandait une bande; là, un marchand de volailles. Après leurs premiers succès, dès la mi-mars 1793, les paysans sollicitèrent les nobles, leurs chefs naturels, ceux qui portaient l'épée et auxquels ils étaient habitués à obéir. Sans enthousiasme, contraints en quelque sorte par leurs anciens tenanciers, les nobles se mirent à la tête du mouvement: des gentilshommes campagnards s'amalgamèrent aux chefs plébéiens des débuts. On s'organisa sous le contrôle d'un conseil supérieur, dirigé par l'abbé Bernier, prêtre réfractaire à la Constitution civile du clergé, car les prêtres réfractaires soutenaient inconditionnellement les insurgés. Les trois armées vendéennes Trois armées furent formées: l'«armée d'Anjou», commandée par le marquis de Bonchamps; la «Grande Armée catholique et royale» du Bocage vendéen, animée par Cathelineau et par Maurice d'Elbée, un officier; l'«armée du Marais» sur la côte, dirigée par François de Charette de la Contrie. Les troupes vendéennes pratiquaient l'embuscade; elles se rassemblaient et s'éparpillaient rapidement à travers la campagne. Mais, malgré l'indigence de leur armement, elles devinrent vite capables de batailles rangées. Les troupes républicaines, les «Bleus», composées de volontaires parisiens, pillards et indisciplinés, battirent en retraite. En mai 1793, les Vendéens prirent Thouars et Fontenay-le-Comte; en juin, Saumur et Angers. Ils pensèrent marcher sur Paris, mais ils préférèrent se retourner vers Nantes, où ils échouèrent à la fin de juin. Les «Bleus» conservèrent la ville et les «Blancs» perdirent Cathelineau, blessé mortellement. La défaite L'insurrection demeurait très forte, mais il lui manquait les renforts qu'elle espérait. Aucun des princes exilés, le futur Charles X, par exemple, ne pensa à venir animer le combat. Aucun des évêques émigrés ne vint se placer au milieu des Vendéens. Le 1er août 1793, la Convention ordonna la destruction méthodique des maisons, des récoltes, du cheptel, afin de rendre le pays inhabitable. Elle envoya dans l'Ouest l'armée vaincue à Mayence, qui avait promis à ses vainqueurs, pour avoir sa liberté, de ne pas combattre pendant un an les ennemis de la France. En octobre 1793, sous la direction de Kléber, deux colonnes républicaines, parties, l'une de Nantes, l'autre de Niort, se rejoignirent à Cholet, où les Vendéens furent écrasés et perdirent Bonchamps. Les «Blancs» franchirent la Loire en catastrophe et se dirigèrent sur Granville, sous la conduite de La Rochejaquelein. Les Vendéens espéraient s'emparer de Granville et recevoir des secours de la Grande-Bretagne, mais ils ne purent entrer dans la ville et rebroussèrent chemin jusqu'à la Loire, où les débris de leur troupe furent détruits dans les combats du Mans et de Savenay, en décembre 1793. Autour des chefs rescapés, il n'y eut plus que des îlots de résistance; les représailles commencèrent. Des troupes républicaines, formées en «colonnes infernales» et commandées par Turreau, ravagèrent le pays. À Nantes et à Angers, les contre-révolutionnaires furent, par milliers, guillotinés, fusillés, noyés dans la Loire. À cette Terreur répondit le terrorisme des Chouans qui, en Bretagne et dans l'Ouest tout entier, menaçaient les vies et les biens des républicains. Ils tiraient leur nom du premier d'entre eux, le paysan manceau Jean Cottereau, dit Jean Chouan. La chouannerie bloqua l'administration et l'activité régulières des départements de l'Ouest. Pour en finir, la Convention thermidorienne fit, sur les conseils de Kléber, de larges concessions: amnistie générale, accords de paix signés avec différents chefs vendéens, tolérance religieuse surtout. Les chefs vendéens et les Chouans ne voyaient là qu'une trêve. Mais, pour le gros de leurs troupes, c'était la paix et le retour des «bons prêtres». Quand, en juin 1795, Charette, en Vendée, et Cadoudal, en Bretagne, se révoltèrent à nouveau, le soulèvement fut de faible ampleur. Dans le même temps, les émigrés qui avaient débarqué à Quiberon étaient vaincus et fusillés; l'expédition du comte d'Artois ne dépassa pas l'île d'Yeu (octobre 1795). En février-mars 1796, Stofflet et Charette, qui battaient encore la campagne, furent pris et fusillés. La chouannerie s'éteignait doucement, quand, en 1799, le Directoire la ressuscita en recommençant les persécutions religieuses. Elle eut de nouveaux chefs: Cadoudal, Bourmont, d'Andigné. Dernières phases Il revint à Bonaparte, Premier consul, d'achever la pacification. Il accorda l'amnistie mais se montra impitoyable envers les rares irréductibles. La Vendée demeura calme jusqu'en 1815 ; pendant les Cent-Jours, elle forma une armée royaliste. En 1832, la duchesse de Berry chercha à ranimer les dernières braises vendéennes, mais la Vendée ne se souleva pas pour soutenir le roi légitime. Les révoltes n'étaient plus qu'un souvenir, ravivées cependant par les historiens, et particulièrement lors de la célébration du bicentenaire de la Révolution de 1789. Nous circulons ensuite au milieu de vitrines qui renferment des armes vendéennes des faux emmanchées verticalement, des fourches, des pointes, des épées des fusils et toutes sortes d’armes. Nous découvrons un tableau qui a créé la polémique depuis son exposition au musée des généraux vendéens en 1993, c'est un tableau académique car il est structuré avec deux côtés distincts, c'est un tableau réaliste par les détails du prêtre attaché à l'arbre, de la femme allongée qui est morte, c'est un tableau romantique avec le sens des ruines, il est aussi manichéen dans la mesure où l'on va opposer les bons républicains aux méchants vendéens. C'est une immense toile qui jusqu'à son exposition au musée des généraux vendéens était roulée dans les réserves du musée de Cholet, certains choletais n'ont pas accepté que l'on expose ce tableau dédié aux généraux vendéens car le peintre a représenté les massacres des vendéens sur les républicains. Le 19 décembre 1793 la bataille de Torfou a été gagnée par les femmes, une armée française encerclée a du capituler à Mayence, comme punition on l'envoya combattre en Vendée. Les mayençais étaient bien habillés et bien commandés par des chefs militaires ce qui fait que dans un premier temps les vendéens vont reculer. Devant cette attitude les femmes vont prendre des bâtons et menacer leurs maris s’ils ne retournent pas au combat, poussés par leurs femmes les Vendéens reprennent un regain de courage et enfoncent et repoussent les mayençais. Un tableau représente le plan de Cholet après la prise de la ville par les républicains, le 17 octobre 1793, on aperçoit le château avec son toit détruit, les premières maisons de Cholet toujours des fermes, un enclos qui est un cimetière avec ses tombes, un moulin à vent qui se trouve à l'emplacement de l'église du sacré coeur, la déroute des vendéens est représentée par une charrette qui roule à toute vitesse pour traverser la Loire. Nous passons devant la statue de Bonchamps qui a demandé grâce pour les prisonniers républicains, le sculpteur est David d'Angers dont un de ses aïeuls faisait partie des prisonniers à qui Bonchamps a sauvé la vie. Nous avons parlé des généraux, des femmes, maintenant nous allons parler des enfants le petit Barrat, qui était originaire de Palaiseau. Il était venu avec le général Desmarets pour s'occuper de son cheval, une nuit il est surpris dans une clairière par un groupe de vendéens, qui lui demande de crier "vive le roi".Le garçon cria "vive la république", aussitôt il sera transpercé de coups de baïonnettes. Desmarets va envoyer un compte rendu à paris, Robespierre va se servir de ce cas pour faire un discours enflammé à la tribune de la convention. Le petit Barrat va devenir le héros républicain, dans le musée il est représenté en général de cavalerie. Un tableau évoque les mariages républicains, on mettait dans une barque un curé et une bonne soeur nus qui étaient attachés entre eux, puis au milieu de la Loire, on ouvrait la trappe sous l'embarcation c'était une façon d'économiser une balle. L'horrible est peut-être le suicide du général Boulin, encerclé par les vendéens il se tira une balle sous le menton, il ne voulait pas tomber vivant aux mains des vendéens car il portait un pantalon en peau de vendéen tannée. Il a existé une tannerie de peau humaine à Clisson, au musée d'art et d’histoire de Nantes on y voit une peau humaine tannée. Dans une vitrine on distingue un crâne humain, c'est le crâne de Stofflet, il était d'Europe centrale et a participé à la prise de Cholet en 1793. Entre 1794 et 1796 il va faire le coup de main dans la région de Cholet, trahi par l'abbé Bernier il est traduit devant un tribunal, condamné à mort il sera fusillé à Angers. A cette époque à Angers, un médecin farfelu voulait savoir dans quel coin du cerveau, pouvait bien se trouver la glande qui empêchait les Vendéens d'accepter les idées de liberté, égalité et fraternité. Le crâne va rester dans la famille Stofflet dans du formol, ça va passer par testament de père en fils à condition que le fils soit médecin. Aujourd'hui la famille ne comprend plus de médecin, alors le crâne de Stofflet est en dépôt précaire au musée des généraux vendéens. Nous passons devant des vitrines qui renferment des souvenirs de la restauration 1815-1840, c'est Louis XVIII, Charles X et Louis Philippe vont se succéder, envoyés en exil à la suite de quelques révolutions dont celle de 1830. Pendant la restauration les gouvernements sont redevables auprès des vendéens et ils les récompensent par des fusils d'honneur, de l'argent et les albums des copies des tableaux des généraux vendéens seront vendus au profit des vendéens. Une grande statue représente le Vendéen, elle était dressée dans un carrefour de Cholet, mais certains ne voulait plus voir ce symbole du passé l'ont plastiqué, reconstituée la statue a trouvé sa place au musée. La tête du vendéen est une copie de la tête de la statue de Jeanne d'Arc qui se trouve à Rouen. Dans sa main gauche, le Vendéen tient un coeur, dans l'autre main arrachée il tenait une faux emmanché verticalement. Nous arrivons dans la salle qui se réfère à 1914, un régiment installé à Cholet en 1870 et dissout après la première guerre mondiale, le 77e régiment d'infanterie qui à l'origine devait préserver Cholet de tous soulèvements. Ce régiment s'est illustré au cours de la première bataille de la Marne, le terme (bleu) vient de la couleur bleue des pantalons qui avait remplacé la couleur garance trop voyante, alors on savait tout de suite où se trouvait les nouveaux arrivants qui portaient le pantalon bleu. Cholet possède un aérodrome depuis 1910, il est à l'emplacement où se tenait le terrain de manoeuvre du 77e d'infanterie. En 1910, un certain Roland Garros est venu à Cholet pour passer son brevet de pilote, il a participé à la guerre de 1914, il est mort 5 semaines avant l'Armistice abattu dans son avion. Une société aérienne était aussi installée à Cholet pendant un temps, elle transportait par ailleurs l'équipe de basket de Cholet lors de ses déplacements. Une figure de Cholet monseigneur Luçon qui a été curé de notre dame de Cholet, ensuite il a été cardinal de Reims dans les années 1905 au moment de la séparation de l'église de l'état. On lui a donc demandé à récupérer le reliquaire, qui renfermait la sainte ampoule contenant l’huile sainte qui sert pour oindre les rois de France. On lui a demandé le reliquaire qu'il a donné mais il a gardé la sainte ampoule que l'on a retrouvé quelque temps après. Si par hasard un roi en France voulait être oint et sacré, ça serait grâce à monseigneur Luçon. Après avoir fait le plein d'histoire vendéenne nous avons rejoint la Pommeraye, nous sommes passés à Saint-Pierre Montlimar où se trouvent le siège social de la société Eram, les entrepôts qui alimentent les magasins et toute l’activité administrative et commerciale de la marque. Le retour à la Pommeraye c’est passé avec des commentaires avisés et coquins du troubadour Phony, sans oublier son ami d’enfance Jean-Jacques. En route pour le musée des traditions et des anciens métiers à Saint-Laurent–la-Plaine, ce musée a été créé en 1975 dans l’ancien presbytère.A l’intérieur du musée le revêtement du sol est en tommettes (pierres cuites) afin de donner un côté XIXe siècle au bâtiment. Dans une salle nous apercevons tout ce qui concerne la bureautique et l’imprimerie, où se côtoient des machines à écrire du début du XXe siècle et des machines d’imprimerie qui remontent à la fin du XIXe siècle. En continuant notre circuit nous pouvons découvrir des objets en broderie des bavoirs, des coiffes, des habits ecclésiastiques et toutes sortes de costumes. Une salle renferme les objets de passementerie, rubans et galons qui autrefois ornaient les vêtements ce qui revient à la mode, aujourd’hui la passementerie est réservée aux décors intérieurs rideaux, ameublement etc. Nous circulons au milieu de matériels usuels comme des cardes pour carder la laine, un appareil qui fouette avec des lanières la fourrure afin de la nettoyer. Ensuite nous déambulons dans un espace réservé aux machines à tisser, c’est le royaume de Jacquard. Les matières utilisées par ces machines étaient le coton, le lin, la soie, pour constituer un ruban une machine à tisser utilise jusqu’à 16 fils commandés par une carte perforée. Nous pénétrons dans la cour de l’ancien presbytère où coule une fontaine, puis nous apercevons un énorme marteau emmanché d’un tronc d’arbre qui était activé par la force hydraulique, ce marteau servait à marteler le cuivre pour confectionner des chaudrons. Sous un hangar sont exposés toutes sortes de charrettes, de cycles du XIXe siècle puis nous nous dirigeons dans d’autres dépendances. Nous découvrons la fabrique d’un sabot avec tous les outils nécessaires pour sa confection, nous découvrons également les rudiments de la cordonnerie du début du XIXe siècle. A cette époque le soulier gauche et le pied droit étaient identique, on inter changeait chaque jour les chaussures pour les faire à son pied. Un espace est consacré à la ciergerie, certains cierges sont décorés, la décoration était obtenue dans un bain d’eau chaude où l’artisan modelé son cierge à l’aide de pinces spéciales. Nous entrons dans le domaine de la forge où sont disposés tous les outils utilisés par le forgeron, une odeur de graisse se dégage de cet endroit. Le village possédait beaucoup de maisons des câlins qui n’étaient pas des maisons de passe, mais la contraction de cave et lin, c’étaient les maisons des tisserands. Les tisserands travaillaient le lin dans leurs caves, ce métier a eu une grande réputation avec les fameux mouchoirs de Cholet qui a fait la richesse des Mauges. Aujourd’hui pour acquérir un mouchoir en lin de Cholet, il ne reste plus qu’un site de production qui se trouve au musée du textile à Cholet. Les tisserands en 1880 sont devenus les ouvriers des usines de chaussures, en 1990 le Maine et Loire produisait le quart des chaussures françaises, aujourd’hui beaucoup d’usine délocalisent leur production dans les pays où la main d’œuvre est moins chère. Ensuite nous sommes dans l’environnement de la lingère, nous pouvons remarquer toutes sortes de fers à repasser installés sur une cuisinière du XIXe siècle. Nous pénétrons dans une pièce transformée en salle de classe où sont exposés des pupitres avec leurs encriers, l’estrade où trône le bureau du maître avec la bouteille d’encre, des porte-plume avec leurs plumes Sergent Major, des buvards, un tableau où est inscrit à la craie blanche une règle de morale, un bonnet d’âne, une règle est placée dans un coin de la classe où l’élève était agenouillé comme punition, un grand poêle est dressé au fond de la classe. Puis nous visitons une habitation du XIXe siècle où tout se passait dans la même pièce seule à être chauffée, sur la tables est installé le couvert, au bout de la table se trouve une chaise sur laquelle est posée la chemise du chef de famille. Le chef de famille mange en face de la porte d’entrée avec son fusil à portée de la main, une lampe à pétrole est suspendue au milieu de la pièce. Un lit à baldaquin est situé dans le coin de la pièce, une pierre d’évier est installée sous la fenêtre avec son seau pour aller chercher l’eau au puits ou à la fontaine la plus proche. Nous sortons du musée qui propose 1000 mètres d’exposition, nous nous dirigeons vers l’église qui est attenante de l’ancien presbytère, nous marchons à travers de matériels vinicoles des cuves, des pressoirs, des alambics à Cognac, des alambics ambulants qui circulaient de ferme en ferme. Aux abords de l’église est installée une immense roue à aube, qui entraîne un immense axe qui servait à faire fonctionner une scierie dans les Vosges. Enfin nous pénétrons dans une remise où sont stockés du matériel agricole machine à battre à vapeur, une auge en bois qui servait à piler les ajoncs, des chariots dont les roues en bois atteignent près de 2 mètres de haut, un motoculteur de 1930 et de nombreux autres charrois. C’est à midi pétante au clocher de l’église que notre voyage dans le XIXe siècle s’est terminé, nous avons rejoint la Pommeraye pour y prendre le déjeuner. Du vignoble d’Anjou aux coteaux du Layon, ces deux vignobles sont distants de 7 kilomètres. Pour rejoindre Chalonnes, nous circulons sur la route empruntée pour la course de côte automobile qui compte pour le championnat de France. LA Loire qui traverse Chalonnes est située à 60 mètres en contrebas de Pommeraye, au cours de notre descente nous apercevons des carrières de chaux. Nous arrivons dans la vallée de la Loire où les terres sont inondables, la plaine est ensemencée de blé. Nous traversons la ville de Chalonnes pour rejoindre le caveau où nous attend le petit train touristique qui va nous faire découvrir le vignoble des coteaux du Layon. Chalonnes a 6000 habitants, la ville remonte au temps des gaulois, à l’époque médiévale Chalonnes était la propriété de l’évêque d’Angers. L’économie locale est représentée par l’usine Eram et l’entreprise Balland-Bucher qui fabrique du matériel viticole. Nous serpentons dans les rues de Chalonnes dont les spécialités culinaires sont le brochet au beurre blanc, les rions (des petits morceaux de cochon, le pâté aux prunes et la fameuse saucisse au vin blanc que l’on peut déguster lors de la fête des vins qui se déroule tous les derniers week-end de février. Nous roulons dans la rue des Cordiers, auparavant cette rue était le lieu où les gens transformaient le chanvre pour confectionner des cordages, des sacs ou des vêtements. En 1960 dans la vallée de la Loire, on cultivait encore 400 hectares de chanvre, aujourd’hui on cultive du maïs, beaucoup de fleurs séchées et des melons. Nous apercevons une place dont Louis XIV en instaura le champ de foire au XVIIe siècle, actuellement 3 cafés subsistent à cet endroit qui en a compté une vingtaine. L’hôtel de ville a été construit en 1860 sous Napoléon III, nous franchissons la Loire grâce au pont suspendu construit en 1948 qui est un des premiers ponts suspendus par câbles construis en France. Nous empruntons les quais de Chalonnes en bordure de Loire qui mesure 600 mètres de long, des jalons relatent les grandes crues de la Loire qui a un débit qui peut varier de 40 à 7000 mètres cubes par seconde. Le niveau du fleuve peut aller de moins 1,20 mètre à plus 6,80 mètres, ce qui fait un écart de 8 mètres de hauteur. Au milieu de la Loire se situe l’île de Chalonnes qui comprend 300 habitants, le chanvre à complètement disparu de l’île qui recouvrait la moitié de sa superficie. Gilles de ray le fameux barbe bleue s’est marié à Chalonnes le 22 juin 1422 avec sa cousine Catherine de Thouars. Les 3 grandes crues mémorables sont celles de 1910, 1936 et celle de 1982 qui est encore dans la mémoire de tous les habitants de Chalonnes. Une voie romaine traversait la Loire à Chalonnes, pendant l’été on peut encore apercevoir quelques rochers qui signifient la présence de cette voie de communication. Notre moyen de locomotion le petit train est le résultat de l’association de 6 viticulteurs, qui l’ont acheté pour faire découvrir leur vignoble et leur production. La gare de Challonnes est située sur la ligne entre Angers et Cholet qui a été ouverte en 1848, le quartier de la gare quant à lui date des années 1950. Nous quittons Chalonnes pour aborder les vignes, nous traversons le petit village de la Croix-Brouillay, c’est ici que fut construit le premier puits de charbon au XIV.me siècle. Un des concessionnaires de la mine était le comte de Lascaze qui, avec son père, avait accompagné Napoléon à Sainte-Hélène. Le charbon était expédié par voie ferrée depuis Chalonnes, puis nous commençons la route du vignoble. Le vignoble angevin représente 20000 hectares, qui produisent plus un million d’hectolitres de vin. A Chalonnes, la vigne représente 170 hectares répartis sur 18 vignerons, la production est de part égale entre le blanc, le rosé et le rouge. Le rendement de rouge est de 2 bouteilles par cep de vigne, celui du blanc coteau du Layon est d’une bouteille par cep de vigne d’où l’écart de prix à la vente. En Anjou 50% des vignerons vinifient eux même leur vin, il faut savoir que la vigne peut pousser de 10 centimètres par jour à certaines époques. Au mois de juin on effectue le palissage de la vigne, nous approchons du village de Dardenay qui était aussi un village de mineurs. En 1750 la région possédait 36 puits de charbon dont 2 qui atteignaient 560 mètres de profondeur. Les vignes sont le royaume du rosier, nous passons devant chez un horticulteur qui cultivent des plantes d’ornement et des semis. Aujourd’hui la vigne est plantée avec l’aide d’un laser, les rangées sont espacées de 2 mètres ainsi que chaque cep, ce qui nous donne 5000 pieds à l’hectare en Anjou. Il faut savoir que c’est 6000 pieds à l’hectare dans le Muscadet et 10000 pieds dans le bordelais. Dans la région existent 3 sortes de moulins dont celui à tour apparu en Anjou au XIVe siècle, ce type de moulin avait uniquement le toit qui pivotait. Les moulins ont fonctionné jusqu’en 1922, ils ont servi à la résistance au cours de la seconde guerre mondiale et comme repères pour l’aviation. L’herbe envahie la vigne où elle est tondue, sa présence empêche la terre de descendre en bas de la pente, qui dans les coteaux du Layon peut atteindre 30 à 40% La tonte amène des matières organiques au sol, cette technique permet une diminution de 50% de désherbant utilisé. Il existe plusieurs cépages le cabernet rouge ou le cépage blanc sec, le chenin qui est vendangé manuellement. En général les vendanges débutent au mois d’octobre, à la machine 3 hommes vendangent 3 hectares en une journée, pour la même superficie manuellement il faut 8 hommes et une semaine pour effectuer le même travail. Le chenin se ramasse à sa macération (pourriture noble), on peut effectuer plusieurs passage dans une vigne pour faire la récolte du raisin. De novembre en février on taille la vigne, en avril et mai on fait l’ébourgeonnage, au mois de juin c’est le palissage qui consiste à remonter les fils de fer, en juin on fait les passages dans la vigne et on tond l’herbe, pendant l’été on laisse la vigne pousser et le raisin mûrir. Des anciennes cabanes en pierre qui servaient autrefois de reposoir et d’entrepôt sont parsemées au milieu des étendues de vignes. Certains carrés de vigne ont 80 ans, à partir de 30 ans la vigne a des racines de un mètre de longueur ce qui fait qu’elle trouve sa nourriture dans le sol et qu’elle ne crève jamais. Nous découvrons la vallée de Rochefort avec son pont qui enjambe la Loire où circulent les trains de la ligne Angers Cholet. Cette vallée en 1982 était transformée en un immense lac, une charrue et un pressoir ornent un rond point. Nous approchons de Chalonnes dont le territoire héberge 6 fours à chaux, la chaux servait à faire du mortier, pour adoucir la terre surtout en Bretagne. Le chaux fournier l’ouvrier du four disposait de la paille, du sarment et des bûches à la base du four pour allumer le feu. Après la mise à feu on disposait une tonne de charbon puis 2 tonnes de pierre calcaire, la pierre calcaire se décomposait et se transformait en chaux. La cendre et la chaux se séparaient automatiquement à la base du four, au fur et à mesure que la cuisson faisait baisser le niveau de matériau, on ajoutait du charbon et de la pierre calcaire pour perpétuer le processus. En fin d’activité le puits de charbon doit être rebouché, pour être plus productif les ouvriers jetaient des piquets de bois dans le puits qui s’enchevêtraient ce qui provoquait un bouchon. Le bouchon faisait économiser de la terre à injecter dans le puits ce qui favorisait économiquement l’ouvrier, mais, la conséquence c’est que plusieurs décennies plus tard, on a construit des habitations sur ces anciens puits qui s’affaissent au gré du temps. Nous voici au belvédère qui est le point culminant de Chalonnes 66 mètres au-dessus de la Loire, une tour y est construite qui servait au propriétaire terrien de surveiller ses ouvriers à la tâche. Depuis le haut de la tour on peut découvrir 17 clochers des communes avoisinantes, puis nous redescendons sur la ville. Nous effectuons un transfert du petit train à notre bus, nous nous rendons dans une cave particulière pour une dégustation. Nous avons droit à la visite de la cave depuis l’arrivée du raisin, les différentes vinifications des vins blancs, rosés et rouges. Pendant l’élevage du vin le viticulteur goûte son nectar presque quotidiennement afin de contrôler sa maturité. Une fois que le vin est bien structuré, on effectue le décuvage, puis vient le conditionnement. Le domaine s’étend sur 18 hectares de vigne, en plus du couple de viticulteurs 2 employés travaillent Toute l’année. Toute la production est vendue aux particuliers dont une grande partie aux visiteurs de la cave drainés par le petit train. Le domaine commercialise uniquement du vin en AOC d’Anjou comme les coteaux du Layon, il existe aussi un crémant d’Anjou. Après la visite la propriétaire des lieux nous a proposé une dégustation sans modération, elle était assistée pour le service par nos 5 guides angevins qui ont su nous faire savourer les différents vins. Bien désaltérés nous avons fait nos emplettes, puis le visage rougit par le soleil et la fraîcheur de la cave nous avons repris la direction de la Pommeraye. Après le petit train en route pour embarquer sur le bateau afin de découvrir l’environnement de la Loire, c’est à Montjean-sur-Loire que débute notre promenade fluviale. Nous naviguons sur le lit mineur de la Loire qui fait 100 mètres de large, alors que le lit de la Loire atteint 600 mètres. La Maine qui coule à Angers est le tronc commun de la Mayenne, du Loir et de la Sarthe qui se jette dans la Loire. Nous apercevons un grand banc de sable où séjournent des sternes, ils parcourent 10000 kilomètres pour venir se reproduire ici, leur zone d’hivernage se situe entre l’équateur et le Sahara. On les appelle hirondelles de mer, ce sont des oiseaux piscivores qui lors de leur prélude à l’accouplement, la femelle répond favorablement aux avances du male lorsque celui-ci a réussi à pêcher 3 poissons. La femelle pond ses œufs à même le sable, c’est la chaleur emmagasinée par le sable qui va couver les œufs. Pour rafraîchir la chaleur des œufs, en plein été le sable peut atteindre 50 degrés, les parents font des va et vient dans le fleuve pour humidifier leur plumage afin de tempérer les œufs. Nous croisons une reproduction de gabare qui est accostée au bord du fleuve, ce genre d’embarcation a navigué sur la Loire du XVIIe au XIXe siècle. Les planches de la gabare ne sont pas placées bord à bord, mais à Clain c'est-à-dire qu’elles se chevauchent. Ces bateaux avaient un mât qui pouvait atteindre 10 mètres de hauteur et une voile, la longueur d’une gabare pouvait varier entre 14 et 30 mètres. Pour passer sous les ponts les mâts étaient articulés, pour avoir moins de perte de temps au passage des ponts, on avait inventé la technique du train de gabares qui comprenaient de 6 à 10 gabares accrochées l’une à l’autre. Lors du passage d’un pont la première gabare baissait son mât et les autres continuaient à pousser. La manœuvre se répétait à chaque gabare en approche du pont, ce qui fait que le train de gabare était toujours en action lors du passage sous un pont. Depuis 1863 quand on parle d’une crue en Loire c’est à Montjean-sur-Loire, toute l’eau qui coule en Loire et ses affluents se retrouve en un seul bras c’est où nous sommes actuellement. Certains courants remontent la Loire par endroits, ils sont dus aux piles de ponts, aux bancs de sable ou aux épaves. Nous approchons une partie où la Loire se divise en deux bras, nous empruntons le bras de droite qui est navigable depuis 1900, auparavant les gabares empruntaient le bras de gauche qui est plus rectiligne. L’île de Chalonnes est la plus grande île sur la Loire, elle fait 14 kilomètres de long pour une superficie de 800 hectares. Nous longeons le village de Montjean-sur-Loire qui a près de 3000 habitants, au XVIIIe et XIXe siècle, c’était le deuxième port sur la Loire après celui de Nantes. Au large de Monjean-sur-Loire croisaient 14000 bateaux par an, les bateaux transportaient de 40 à 80 tonnes de marchandises du vin, de la chaux, du sable, du sel, du sucre, du café, du cacao, de la porcelaine, de la ferronnerie, des cacahuètes, de la noix de coco, des peaux d’oranges etc. Depuis 12 ans, aucun bateau de commerce ne navigue sur la Loire à cause du manque d’eau. Les cacahuètes servaient à faire de l’huile à Château-Gonthier, les peaux d’oranges allaient à Angers pour les usines Cointreau et les noix de coco étaient utilisées pour fabriquer des chapelets. Saumur était devenu la capitale du chapelet, tout en étant un fief protestant pour dire que l’argent n’a pas d’odeur. Une profession a disparu du lit mineure de la Loire ce sont les sabliers, on n’a plus le droit d’extraire un seul grain de sable du fond de la Loire. Le long du quai de Loire à Montjean-sur-Loire sont exposées des statues dont une représente la tête d’un noir, c’est de mauvais goût car le port négrier le plus important était celui de Nantes. Montjean-sur-Loire organise depuis une dizaine d’années un symposium de sculptures monumentales, ce qui fait que les statues sont intransportables alors on les expose où l’on peut. Aujourd’hui il ne reste plus que 20 pêcheurs professionnels, on en a compté jusqu’à 1200 au début du XXe siècle, ce n’est pas par manque de poissons, mais les gens n’aiment plus les poissons avec des arêtes. Les bateaux des pêcheurs professionnels font de 6 à 8 mètres de long, ils ont le nez plat pour accoster plus facilement la rive. Aujourd’hui les bateaux sont propulsés avec des moteurs, En trente ans la vitesse de la Loire est passée de 4 kilomètres heure à 12 kilomètres heure. De décembre au mois de mai on pêche la lamproie qui est une sorte de grosse anguille, c’est un migrateur qui vit en mer et se reproduit en eau douce, elle mesure environ un mètre et pèse 2 kilogrammes. Les lamproies sont vendues dans la région bordelaise et exportées en Espagne et au Portugal. Actuellement on pêche l’alose qui est aussi un poisson migrateur, elle fait partie de la famille de la sardine, elle peut peser jusqu’à 3 kilogrammes. Dans la Loire on pêche également le brochet, le sandre, la Brême, le sardillon, le mulet, le gardon, la perche, l’anguille enfin tous les poissons d’eau douce. Nous apercevons une drôle de construction de 30 mètres de hauteur, c’est un chevalement de puits qui faisait 180 mètres de profondeur. Du fond du puits on a des galeries qui mesuraient jusqu’à 1 kilomètres de long dont certaines passaient sous la Loire et d’ici on extrayait du charbon. Depuis 1740, on a fait appel à la communauté belge pour l’exploitation minière, les belges possédaient une technique qui était d’étayer les galeries à l’époque. Le chevalement de puits a été construit en 1870, depuis l’an dernier ce bâtiment est classé monument historique. Nous passons sous une passerelle construite en 1979, elle a remplacé le bac qui faisait la jonction entre l’extrémité de l’île de Chalonnes et Montjean-sur-Loire ce qui évitait d’aller passer le pont pour se rendre sur la rive à Chalonnes. Pour la petite histoire les bateaux de la Loire ont disparus, c’est à Montjean-sur-Loire qu’ils sont restés le plus longtemps. Pour 3 éléments importants la Loire pour le transport, le charbon comme combustible et la pierre calcaire qui une fois cuite se transforme en chaux. A travers des arbres on distingue un four à chaux, la tour à une porte centrale et 2 portes latérales, ça ressemble à une tour médiévale. La tour est accolée au coteau que l’on profite pour alimenter la tour par le haut, dans ce genre de tour on pouvait charger 70 mètres cubes de matériaux. Une fois allumé le four pouvait fonctionner plus d’un an, pour entretenir le four il fallait qu’un homme se hisse dans le conduit pour nettoyer la robe. Pour faire cette opération, après l’extinction du feu à l’intérieur de la tour, il fallait attendre 3 mois pour que la pierre se refroidisse de plus de 1000 degrés à une température supportable pour l’homme. La chaux était employée dans l’agriculture, la maçonnerie, le traitement des eaux, la sidérurgie, les entreprises sucrières, les tanneries, les cosmétiques et dans bien d’autres domaines. La rive de la Loire est parfois construite d’épis noyés espacés de 50 mètres chacun, cette technique remonte à 1896 et vu les résultats, elle a été étendue entre 1905 et 1920. Les épis noyés ont été mis en place pour faciliter la navigation sur la Loire, Le Rhône et la Loire sont les 2 grands fleuves navigables français qui ont fait la richesse du pays, la durée de transport entre Nantes et Orléans pouvait varier entre 15 jours et 6 mois, tout dépendait du vent, des inondations, du brouillard, des tempêtes dont les creux peuvent atteindre un mètre et l’eau qui était trop basse. La Loire est un fleuve irrégulier dont la hauteur peut varier, les mouilles qui ont une longueur de près de 8 kilomètres de long où il y a suffisamment d’au sont suivies de bas fonds de 300 mètres de long et ainsi de suite. Parfois les mariniers étaient obligés de décharger leurs bateaux, de passer la partie basse du fleuve puis ils rechargeaient la marchandise pour continuer leur trajet. En 1850 est inaugurée la voie ferrée Nantes Paris, c’est le déclin de la batellerie sur la Loire, malgré les épis noyés qui désensable le lit du fleuve et en 1990 s’en est fini de la navigation en Loire. Les rives du fleuve sont le royaume des castors, on aperçoit des chantiers de castors qui se reconnaissent à l’affluence de branchages au sol. Un castor peut sectionner un saule ou un peuplier de 80 centimètres de diamètre, un castor à la queue plate, il pèse jusqu’à 35 kilogrammes, il a les pattes de derrière palmées et les pattes de devant sont quatre fois plus courtes. Les castors ont été tués pour plusieurs raisons, pour leurs 2 glandes qui produisent le castorium utilisé au moyen âge pour le mal de tête, pour leur chair et leur fourrure, pour leur queue que l’on avait le droit de manger pendant les 150 jours maigres de l’époque. En 1900 le castor avait disparu en France, le castor d’Europe qui ne fabrique pas de barrage fut réintroduit dans les années 1970. Du premier octobre au 15 avril on pratique la pêche la plus dangereuse en Loire, c’est la campagne de l’anguille. La pêche s’effectue avec des bateaux qui mesurent 15 mètres de long pourvus à l’arrière de 2 poteaux de 11 mètres de long qui soutiennent un filet de 25 mètres de longueur qui se termine en entonnoir avec une poche. La poche a un diamètre de 1mètre, une longueur de 8 mètres, elle est conçue avec une maille de 12 millimètres. Ces anguilles vont se reproduire dans le golf du Mexique, elles pèsent environ 1 kilogramme mais elles peuvent atteindre jusqu’à 3 kilogrammes, elles sont âgées de 8 à 18 ans. La relève du filet et des poteaux s’effectue plusieurs fois par jour pendant 4 mois, pour pêcher 20 kilogrammes d’anguilles, on récupère de 5 à 6 tonnes de détritus. Les anguilles sont exportées vers l’Allemagne, la Hollande, le Danemark et la Belgique où elles sont fumées, puis on les importe pour les déguster. Les zones de pêche sont louées par l’état, soient à des pêcheurs professionnels ou à des sociétés de pêche à la ligne. La Loire recense de nombreuses îles aux noms évocateurs Belle Ile, L’île aux Moines, la Corse, l’île Charlemagne etc, on peut acheter une île pour 10000 Euros. La plupart de ces îles sont submergées par l’eau pendant les crues, elles on donc une superficie modulable. En 1999 malgré l’alerte donnée par le préfet les digues et les levées de la Loire ont résisté à la tempête, le fleuve est resté 3 mètres en deçà de la hauteur des digues et levées. Dans son lit mineur la Loire s’étend sur 80 mètres de large, mais pendant les crues le lit majeur peut atteindre 3 à 11 kilomètres de large. Les habitants des îles ne changeraient pour rien leur mode de vie malgré tous les aléas, les îliens sont une sorte de communauté ils sont îliens d’abord puis ils appartiennent à une commune. Nous pouvons admirer un héron cendré qui est un échassier, sa nourriture est faite de poissons, de batraciens, des limaces, des mulots, des escargots et des canetons c’est vraiment un opportuniste. Le projet de la passerelle construite en 1979 existait de puis 1842 année où un budget avait été voté par la commune de Chalonnes. Les îliens ne voulait pas d’un second lien de communication avec la rive, ils ont donc refusé pendant plus d’un siècle la réalisation du projet. Après 2 heures de promenade sur la Loire, nous avons rejoint la Pommeraye pour le déjeuner avec de bons coups de soleil. Nous prenons la direction de Saumur pour se rendre à Trélazé, où se trouve une exploitation d’ardoise. Au cours du trajet Yves notre guide de Montjean-sur-Loire nous lit un poème, qui relate la tragédie des jeunes fusillés du cadre de Saumur lors de la seconde guerre mondiale. Arrivés à Trélazé un ardoisier guide nous accueille pour nous raconter l’univers de l’ardoise, qui est extraite en Anjou dans des carrières à ciel ouvert depuis 1312. L’exploitation de l’ardoise à Trélazé remonte à 1406, deux sortes d’ouvriers travaillent dans une ardoiserie les gars d’en bas ou les mineurs, les gars d’en haut les fendeurs sur butte ou les périlleux qui transformaient les blocs de schiste en ardoise de toiture. Nous passons devant un bloc qui pèse 6 tonnes, qui mesure 3 mètres de long, 2 mètres de large et 40 centimètres d’épaisseur. Ce bloc a été extrait à 500 mètres sous terre, le fendeur exécutait 4 opérations le débitage, le quairnage, le fendage et le rondissage. Le débitage consiste à diviser le bloc dans sa largeur du milieu jusqu’au bout, pour effectuer cette tâche on emploie un bouc ou coin que l’on enfonce à l’aide d’une masse. En tapant un grand coup sec ça se sépare tout droit, on dit que l’on a fait un bouc par contre si la rupture n’était pas droite on disait qu’on avait fait une biquette. Puis avec un coin on façonnait des tranches de 8 à 10 centimètres d’épaisseur, pour débiter un bloc de 6 tonnes un fendeur mettait 3 jours de débitage, pour transformer le bloc en ardoise de toiture il fallait 12 jours de travail. Aujourd’hui avec les machines un bloc est transformé en 3 heures, auparavant de l’extraction à l’ardoise il y avait 70% de déchets, aujourd’hui il y en a 95%, les déchets de l’extraction servent à remblayer le fond de la mine. Un fendeur était un tâcheron, qui devait payer son bloc à débiter, il était rémunéré à la fin de son travail. L’extraction à Trélazé s’effectue à 550 mètres sous la terre, le sous-sol est un vrai gruyère avec plus de 350 kilomètres de galeries. Actuellement, il ne reste plus que 2 sites en activité, une mine traditionnelle qui remonte par un ascenseur des blocs de 6 tonnes, une descenderie dont l’inclinaison est de 13% où s’engouffrent des camions chargés de 35 tonnes de matériau. Depuis la nouvelle technique de la descenderie la mine est redevenue rentable, on produit 20000 tonnes d’ardoise par an ce qui représente 90% de l’ardoise française. Le métier de fendeur s’apprenait à partir de 12 ans, pour devenir un bon fendeur il fallait 5 ans d’apprentissage. A son premier jour d’apprentissage le jeune était intronisé par ses pais par la cérémonie du guétrage : qui consistait à envelopper les jambes de guêtres que l’on arrosait de vin rouge. Lors de cette cérémonie, on donnait un nom de seigneurie au futur fendeur, notre guide a été baptisé Rossignol. Notre guide fendeur effectue devant nous toutes les tâches qui transforment un bloc en ardoise de toiture, il s’est préservé avec des guêtres et de lourds sabots en bois. Pendant sa démonstration nous avons pu toucher les outils qu’il employait bouc, pic moyen, coin, masse, marteau, ciseau d’acier trempé appelé cobra, scie etc. Le reparton obtenu du débitage est placé dans l’eau, afin que le schiste garde son humidité. Le reparton est pris en étau par les sabots en bois de Rossignol, à l’aide d’un ciseau il cherche un espace, puis en tournant son outil il décolle les fendilles qui ont 3 millimètres d’épaisseur. En 1915 a été inventé un étau en bois la presse à fendre pour serrer le reparton afin d’en débiter les fendilles, car pendant la première guerre mondiale ce sont les femmes qui sont devenues fendeuses. Les fendilles sont ensuite découpées sur une machine à crémaillère que l’on règle suivant le type d’ardoise à débiter, il existe 18 modèles différents d’ardoise de toiture. Une ardoise de 5 centimètres d’épaisseur peut supporter une charge de 32 tonnes, une toiture en ardoise de 9 millimètres d’épaisseur pèse 100 kilogrammes au mètre carré, l’ardoise résiste aux différences atmosphériques, autrefois les bacs dans les laboratoires étaient en ardoise qui est inattaquable par les produits chimiques, l’ardoise à une flexibilité proche de celle du cuivre, une toiture en ardoise de 3 millimètres d’épaisseur à une longévité de 500 ans. Le travail de l’ardoise est propice à la silicose, les mines ne sont pas sujettes au coup de grisou et la température à l’intérieur de la mine est de 12 degrés. L’Espagne produit 100000 tonnes d’ardoise par an et la France en produit 20000 tonnes, les principaux sites d’extraction sont l’Irlande, le Pays de Galles, l’Angleterre, la Bretagne, la Normandie, la Galice, le Portugal, le Canada, les Etats-Unis et le Brésil. L’ardoise est de différentes couleurs violine au pays de Galles, vert pâle en Angleterre, de la rouge, de la verte et de l’orange. Ensuite nous avons visionné un documentaire sur la société minière actuelle. Aujourd’hui on emploie des machines à fendre à ventouses pour séparer les fendilles, auxquelles sont adjointes des machines à fendre à commandes numériques qui suppriment totalement l’intervention du fendeur, sauf pour le contrôle et l’orientation des fendilles. A la sortie du sciage les repartons sont triés, les parfaitement parallélépipédiques et les autres. Les seconds sont dirigées vers une machine à fendre semi automatique, les premiers 80% de la fabrication sont amenés un à un et automatiquement vers une machine à fendre à commandes numériques, qui en mesure l’épaisseur, calcule le nombres de fendilles que chacun d’eux contient, fend et dirige les fendilles vers un poste de tri. Après avoir été livrée en charrettes, en péniches pour remonter la Loire, en bateaux depuis le port de Nantes, en trains depuis le milieu du XIX.me siècle les ardoises sont maintenant transportées par camions. L’art dans le métier ou l’habilité des artisans couvreurs, l’ardoise créée à plusieurs centaines de mètres sous terre soit enfin avec le soleil au plus haut de nos toits. Ensuite nous avons parcouru l’espace géologie, l’espace où sont réunis tout le matériel d’exploitation les différents casques de mineurs, les outils du fendeur, la boîte à explosifs. Un troisième espace était consacré à tout ce que l’on pouvait faire avec l’ardoise, des maquettes nous expliquaient les différentes toitures de maisons et de clochetons à savoir que l’ardoise est attachée aux linteaux avec des crochets. Nous pouvons aussi apercevoir des bacs de laboratoire, des éviers et leur égouttoir, de l’ameublement de jardins, des potiches, des lampadaires et de nombreux autres objets de décorations et usuels. Après 2 heures de visite nous avons repris la direction de la Pommeraye, c’est toujours avec un magnifique soleil que nous avons terminé la journée dans le parc où nous étions hébergés. Pour notre dernière journée, nous prenons la direction de Saint-André-de-la-Marche pour aller y visiter le musée consacré à la chaussure. Le musée est installé dans une ancienne usine qui fabriquait des chaussures, le musée est géré par une association d’anciens techniciens et ouvriers de la chaussure. En1956 les Mauges avaient 420 usines qui fabriquaient des chaussures, il n’y avait pas de chômage on faisait venir de la main d’œuvre de la Vendée et des Deux Sèvres. A 14 ans les enfants à l’école avaient déjà 3 à 4 propositions d’emplois, ce qui ne les incitait pas à continuer leurs études. Après la première guerre mondiale les femmes restant souvent veuves, elles étaient tentées d’envoyer leurs enfants à l’usine dès l’âge de 12 ans. A Saint-André la chaussure a commencé à faire son apparition vers 1900, monsieur Maurinière avait l’idée de créer une usine, mais n’ayant pas d’argent c’est le curé de la paroisse qui collecta auprès des paroissiens la somme de 10000 francs de l’époque. Cette usine construite employa plusieurs dizaines de personnes, les premiers bénéfices dégagés ont servi à rembourser les donateurs. En 1919 les affaires allant bon train, Monsieur Morinière a construit une seconde usine dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui qui a fonctionné jusqu’en 1990. Les toits des usines de chaussure sont en dents de scie avec de grandes verrières d’un côté afin d’être au jour pour effectuer les travaux minutieux, l’autre côté étant plein afin de procurer de l’ombre l’après-midi. Dans l’usine chaque personne effectuait toujours la même tâche (découpage, montage, piqûre et le finissage etc.), alors que les artisans effectuaient l’ensemble des tâches. Parmi ces artisans il y avait les sabotiers qui pouvaient être 4 ou bien 5 dans le même bourg, pour fabriquer les sabots ils utilisaient comme outils les paroirs, les vrilles, les langues de chat etc. Le sabotier travaillait sur un banc à trois pieds appelé chèvre, les sabots étaient en bois de aulne et de hêtre, nous avons vu une paire de sabots de contrebandiers et de braconniers qui avaient le talon devant afin de tromper les recherches. Pour que le sabot dure plus longtemps on le cerclait lorsque le bois craquait, puis nous touchons les premières chaussures en cuir dont les brodequins. La semelle du brodequin portait des clous à tête carrée au talon, des clous à tête ronde sur le reste de la semelle. Ces chaussures ont été portées pendant des dizaines d’années dans l’armée et la gendarmerie. Alexis Godilleau, le grand industriel de la chaussure a fourni des centaines de milliers de ces chaussures pendant la première guerre mondiale, depuis on a appelé le brodequin du nom de godilleau. Un godilleau comptait 82 clous, à l’armée on ne badine pas avec le cloutage des semelles, s’il manquait un seul clou le soldat était puni. Les clous des chaussures garnissaient les routes et chemins, ce qui provoquaient la crevaison des pneus de bicyclette. Le raphia a été utilisé pour fabriquer les chaussures, nous sommes en possession d’une forme qui a servi à confectionner une paire de chaussures la plus grande du monde qui avait une pointure de 60. Pour travailler le cuir afin de confectionner une chaussure on utilise plusieurs outils pour couper le cuir, le percer avec des alènes, des outils pour coudre des machines à coudre, des fers à lisse et toutes sortes d’autres d’outils. Beaucoup d’ateliers de sous-traitance étaient liés à la chaussure, les fabriques de rivets, de clous, de lacets dont nous avons aperçu une machine qui date de 1880 qui les confectionnait. Certaines chaussures demandaient jusqu’à 60 opérations, avant de confectionner une chaussure l’ouvrier s’exerçait en fabriquant des pantoufles et des espadrilles. Les Mauges recensées de nombreuses tanneries, une tannerie installée en Bretagne fait du cuir avec du poisson qui est ensuite utilisé en maroquinerie. Entre 1850 et 1925, on a fabriqué pour le dimanche même pour les hommes des bottines en peau de chevreau. Dans les années 1960, on a fabriqué des chaussures à bout très pointues comme les santiags en 1970, d’ailleurs la mode actuelle revient à ce type de chaussures. Les formes pour fabriquer les chaussures sont soit en bois ou en aluminium, le cuir est découpé à plat en plusieurs parties la languette, les flancs, les talons etc. Le patron pour la découpe est en carton recouvert de laiton, le coupeur avec des tranchais découpe le tour du gabarit, la coupure à la nain s’effectue encore aujourd’hui pour les chaussures de grandes tailles et les chaussures de luxe faites sur mesure comme à Limoges par exemple. Le patron en carton a été remplacé par l’emporte pièces en métal coupant que l’on introduit dans une presse, c’est le début de la fabrication à la chaîne. Actuellement les découpes se font au laser ou au jet d’eau par des moyens très sophistiqués. Les morceaux de cuir découpés sont ensuite assemblés, c’est le rôle des piqueuses. Avant l’opération de piquage, le morceau de cuir peut subir d’autres travaux dans la machine à tracer, la machine à parer qui désépaissit les bords afin d’éviter les bourrelets. D’autres opérations peuvent également être effectuées comme le rempliage, qui consiste à plier deux bords émincés l’un sur l’autre.
ANJOU: Ancienne province de la France axée sur la Loire, l'Anjou doit son renom à son riche passé historique. La capitale de la région, Angers, ville des arts et des fleurs, réunit les fonctions de ville-marché et de centre administratif. Géographie physique Le territoire de l'Anjou s'étend sur les départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de l'Indre-et-Loire. Région de carrefour, en contact avec les dernières assises du Massif armoricain, à l'ouest, et du Bassin parisien, à l'est, l'Anjou se divise en trois ensembles bien individualisés: l'Anjou noir, à l'ouest, l'Anjou blanc, à l'est, les vallées de la Loire, du Loir, de la Mayenne, de la Sarthe. L'Anjou noir regroupe le bocage Ségréen ou Craonnais, pays de plateaux peu élevés, et les Mauges. Les sols schisteux et humides sont couverts par un paysage de bocage. L'Anjou blanc est formé par les terrains tertiaires du Bassin parisien, parfois fertilisés par des placages de sable. Les vallées de la Loire, du Loir, de la Mayenne, de la Sarthe constituent le cœur de l'Anjou. Économie L'économie de l'Anjou noir est orientée vers l'élevage des bovins et des porcs. Dans l'Anjou blanc, les plateaux du Baugeois, au nord, portent des forêts de chênes et de pins et des cultures arbustives (pommiers, poiriers). Au sud, le Saumurois, plus riche, possède une économie agricole plus diversifiée: riches labours sur les plateaux; vignobles réputés et champignonnières sur les coteaux. Dans les vallées, la douceur du climat et la fertilité des terres alluviales irriguées sont favorables à la culture de légumes, de primeurs et de fleurs (hortensias bleus, porte-graines), ainsi qu'aux pépinières, sans oublier le vin des coteaux de la Loire. Sur les terres les plus riches est pratiqué l'élevage bovin. Cholet, principale ville de l'Anjou armoricain, possède des industries textile (lin, coton), agroalimentaire, chimique. C'est aussi un important marché aux bestiaux. Angers est un grand marché agricole (fruits, légumes, vins d'Anjou) qui a su combiner les activités traditionnelles et les techniques de pointe et l'électronique. Histoire Habitée par les Andecavi, peuple celtique, la région correspondant à l'Anjou est occupée par les armées de César en 57 av. J.-C. et incorporée à la province Celtique puis à la Lyonnaise (dont la capitale est Lugdunum, Lyon). Après avoir subi plusieurs invasions barbares, l'Anjou, à la suite de la bataille de Vouillé (507), est uni au royaume mérovingien. Situé aux confins de l'Aquitaine et de la Bretagne, il acquiert très vite une certaine importance grâce à son rôle stratégique, mais, en contrepartie, il subit maintes fois les attaques des Normands, que Robert le Fort réussit à repousser en 866. Au IXe siècle, l'Anjou est érigé en comté et ses seigneurs, en particulier Foulques III Nerra (972-1040), agrandissent, par achat ou par conquêtes, leur domaine des Mauges, du Saumurois et de la Touraine. À ces provinces, Geoffroy II Martel, fils de Foulques Nerra, ajoute le Vendômois et une partie du Maine. À sa mort, Geoffroy ne laisse aucun fils et c'est son neveu, Foulques IV le Réchin, qui lui succède, fondant ainsi la seconde maison d'Anjou (fin du XIe siècle). Une puissante principauté À partir de cette période, l'Anjou devient une puissante principauté féodale, parfaitement dirigée; il connaît une grande prospérité qui se traduit par les progrès des défrichements et de la viticulture, par l'essor des villes et des foires et par le rayonnement des abbayes romanes. Au milieu du XIIe siècle, l'importance de l'Anjou décuple lorsque Foulques V le Jeune, devenu roi de Jérusalem en 1131, marie son fils Geoffroy V Plantagenêt à Mathilde, fille du roi d'Angleterre Henri Ier Beauclerc. Par ce mariage, Geoffroy aspirait au trône d'Angleterre, mais il obtient seulement le duché de Normandie (1144). En revanche, son fils, Henri II Plantagenêt, devient successivement comte d'Anjou (1151), duc d'Aquitaine (1152) après son mariage avec Aliénor d'Aquitaine, puis roi d'Angleterre (1154). L'Anjou est alors un élément fondamental de l'«Empire Plantagenêt», qui s'étend de l'Écosse aux Pyrénées. La conquête de l'Anjou par Philippe II Auguste (1203) est reconnue par le traité de Chinon (1214). En 1246, il est donné en apanage au frère de Saint Louis, Charles, qui est à l'origine de la deuxième maison d'Anjou. Le pays traverse alors une période de prospérité économique. Les marchands de l'Europe du Nord, qui viennent y négocier le sel et le vin, contribuent à l'essor des ports de la région littorale. Le rattachement à la Couronne Charles et ses successeurs sont surtout préoccupés par leurs aventures méditerranéennes et apportent à l'Anjou la Provence et le royaume de Naples (les Angevins ayant été chassés de Sicile en 1282). Le fils de Charles Ier d'Anjou, Charles II, donne en dot à sa fille Marguerite l'Anjou et le Maine, lors de son mariage avec Charles de Valois (1290). Aussi reviennent-ils à la couronne de France à l'avènement de Philippe VI de Valois (1328). Mais, constitué en apanage par Jean II le Bon pour son fils cadet Louis Ier, l'Anjou est de nouveau associé au royaume de Naples. Durant la guerre de Cent Ans, ses princes seront fidèles à la cause française. À la mort du roi René d'Anjou (1480), chef de la branche aînée, et de Charles du Maine (1481), chef de la branche cadette, Louis XI recueille par succession la majorité des possessions de la maison d'Anjou. Ces dernières appartiennent désormais à la couronne de France. Du XVIe au XVIIIe siècle, plusieurs princes de sang portent le titre de duc d'Anjou: Henri III avant son avènement au trône, son frère François, duc d'Alençon, et le petit-fils de Louis XIV, qui devient roi d'Espagne sous le nom de Philippe V. Durant les guerres de Religion, l'Anjou est dévasté, de 1560 à 1598, et Saumur devient un centre de résistance protestante. Pendant la Révolution, la province est le théâtre de luttes violentes entre les Chouans et les armées révolutionnaires. En 1790, il forme pour l'essentiel le département de Maine-et-Loire, amputé au nord de la Mayenne et au sud de la Vienne. MAISON D’ANJOU: La première maison d'Anjou est issue des vicomtes d'Angers. Le comte Foulques V le Jeune, roi de Jérusalem, se maria deux fois. De lui sont issues deux branches: celle des derniers rois de Jérusalem et celle de la dynastie anglaise des Plantagenêt. La deuxième maison d'Anjou est capétienne. Philippe II Auguste reprit le comté à Jean sans Terre en 1203, et le futur Saint Louis érigea l'Anjou en comté-pairie pour son frère Charles Ier (1246), qui devint roi de Sicile. De cette deuxième maison sont issues les branches de Hongrie, de Naples, de Durazzo et de Tarente. La troisième maison d'Anjou est issue de Charles de Valois, père du roi de France Philippe VI, qui épousa Marguerite d'Anjou-Sicile, petite-fille de Charles Ier. Le Maine et l'Anjou formèrent sa dot. Jean le Bon les donna en apanage à son second fils, Louis Ier d'Anjou, adopté par la branche de Naples, ce qui fut la cause des guerres d'Italie (XVe-XVIe s En route pour le musée du Cointreau à Saint-Barthélemy d’Anjou situé dans la banlieue d’Angers. Le musée se divise en 4 espaces: l’espace produit qui permet de découvrir tout le processus de distillation de la liqueur Cointreau, l’espace entreprise qui nous fait voyager pendant 150 ans, avec l’histoire du Cointreau et de la famille Cointreau, l’espace communication pour s’imprégner de toute la saga publicitaire de la maison Cointreau puis l’espace dégustation afin de savourer la fameuse liqueur. Les différentes étapes de l’élaboration du cointreau sont la sélection des matières premières, la distillation, la finition puis enfin l’embouteillage. Le Cointreau est fabriqué à partir d’écorces d’oranges amères et douces, de sucre, de l’alcool de betterave neutre purifiée à 96 degrés. Les écorces douces proviennent du Brésil et d’Espagne quant aux écorces amères elles sont importées des Caraïbes. Les écorces d’oranges amères est le résultat de la cueillette d’oranges encore vertes, l’écorce étant encore très épaisse elle est très riche en huile essentielle. C’est le mélange des 2 sortes d’écorces douces et amères qui donnent le goût spécifique au Cointreau. Nous sommes dans la salle des alambics qui sont au nombre de 19 où on nous explique l’opération de distillation. On remplit d’immenses containers des écorces d’oranges, de l’alcool et de l’eau que l’on laisse macérer toute une nuit afin d’hydrater les écorces d’oranges. Puis on effectue la distillation qui dure entre 5 et 6 heures, cette opération est réalisée en injectant de la vapeur d’eau à 140 degrés. Les vapeurs d’alcool chargées en huiles essentielles s’échappent de l’alambic par le col de cygne qui surmonte la marmite. Les vapeurs d’alcool circulent dans une colonne ce qui permet de la condenser en liqueur, la distillation se déroule en plusieurs phases dont les premières vapeurs que l’on appelle les crêtes de distillation sont trop chargées en alcool. La crête de distillation ainsi que la queue de distillation qui par contre n’est pas chargée en alcool sont récupérées dans une cuve à part, en fait, on extrait uniquement que le cœur de la distillation. L’alcool distillé appelé (alcoolat) à une teneur en alcool de 86 degrés, c'est l'étape suivante dite finition qui en ajoutant de l'au purifiée donnera une liqueur chargée de 43 degrés d'alcool. Il existe deux sortes d'alambics à colonne à partir de 1970 et à boule qui date des années 1950, tous deux sont situés au-dessus de la marmite. Les alambics sont toujours en cuivre malgré qu'ils soient récents, le cuivre étant un bon conducteur de chaleur. La finition du produit ne se limite pas qu'au coupage de l'alcoolat, on passe le mélange dans une centrifugeuse afin d'enlever les derniers résidus puis vient une seconde phase de coupage où on ajoute du sucre liquide. Après la distillation on vide la marmite où ont macéré les écorces, les opérateurs tirent avec des râteaux les résidus d'écorces dans des brouettes puis ils les transportent dans une cuve creusée dans le sol. La maison cointreau à une politique de recyclage des déchets les écorces d'oranges après distillation sont revendues à des élevages de sangliers ou de bovins pour leur alimentation. Après la certification de l'environnement, l'entreprise s'est engagée sur la certification de la sécurité. Aujourd'hui l'entreprise emploie 220 CDI et 60 CDD, la production annuelle est de 30 millions de bouteilles dont 95% sont exportées. Depuis 150 ans ce sont 4 générations qui portent la liqueur cointreau aux 4 coins du monde, c'est en 1849 à Angers que deux frères Edouard-Jean et Adolphe Cointreau, héritiers d'une ancienne lignée de maîtres boulangers confiseurs décident de devenir distillateurs liquoristes et créent la société Cointreau frères. Ils sont primés à l'exposition universelle de Paris en 1867, Edouard Cointreau successeur dès son retour de la guerre de 1870 continua à développer l'entreprise. C'est au cours de ses nombreux voyages que Edouard Cointreau trouve l'idée d'une liqueur, le coeur en sera l'orange et la couleur cristalline. Dès son mariage en 1875 sa femme devint l'âme de l'entreprise en développant sa politique sociale, quelques mois plus tard Edouard trouve la formule idéale du Cointreau qui ne changera plus. En 1878 lors de l'exposition universelle il obtient sa première médaille pour sa toute nouvelle liqueur, une grande épopée va alors commencer pour la maison Cointreau. La liqueur est contenue dans une bouteille carrée telle un coffre-fort ambré qui l'emporte au-delà des océans. En 1885 face à de nombreuses contrefaçons, il dépose sa marque et fait la promotion de son produit dans le monde entier. Pour la publicité il imagine le célèbre pierrot, la liqueur devient la boisson des rois Edouard VII et Anne d'Autriche succombent à ses charmes. Ses fils Louis et André créent des filiales à travers toute l'Europe puis conquièrent l'Amérique. En 1934 André est seul à la tête de l'entreprise, il est député du Maine et Loire, président des vins et spiritueux il poursuit la modernisation de l'entreprise. Pendant la seconde guerre mondiale l'usine est endommagée, à la libération l'entreprise participe à l'effort de reconstruction de la cité et termine l'agrandissement de la distillerie. Pour son centenaire en 1949 on inaugure les nouveaux bâtiments et on octroie le treizième mois au personnel. C'est alors que la nouvelle génération Pierre, robert et Max sont associés aux affaires. Dans les années 60, Cointreau installe ses bureaux sur la plus belle avenue du Monde les Champs Elysées à Paris, des accords de partenariat sont signés avec les marques Picon, Isara, Saint-James et Rémi Martin. En 1968, on atteint les 12 millions de bouteilles et la distillerie est transférée de Angers à Saint-Barthélemy d'Anjou où la nouvelle distillerie est inaugurée en 1972. Les anciens alambics sont conservés et installés à côté d'une nouvelle chaîne d'embouteillage automatique. Aujourd'hui Pierre Cointreau est président de la société et Robert, son cousin est vice-président d'honneur. En 1990, la société Cointreau a fusionné avec l'entreprise de cognac Rémi Martin qui est devenu la société Rémi Cointreau. Cette nouvelle société a racheté de nombreuses autres entreprises comme des fabricants de jus de fruits, de champagne, de vodka, de vin, de whisky etc. Nous parcourons une passerelle de 170 mètres de long qui surplombe tout l'espace de production, on aperçoit l'espace où l'on effectue la phase de finition puis les lignes d'embouteillages. Tout le long de la passerelle nous découvrons toute la saga publicitaire de la maison Cointreau dont le fameux Pierrot sous toutes ses formes qui fut l'emblème de la maison Cointreau pendant 50 Ans. D'immenses cuves qui contiennent 100000 litres de Cointreau sont dressées dans l'usine. Nous passons devant une vitrine qui renferme 200 contrefaçons de la fameuse bouteille carrée, ces bouteilles représentent tous les procès gagnés. Après le Pierrot, la bouteille fut ornée d'une estampille Cointreau sous laquelle est passé un ruban rouge. L'embouteillage est constitué de 11 lignes entièrement automatisées: le dépalettiseur prend les bouteilles vides sur les palettes pour les disposer sur le convoyeur ou tapis roulant, une machine dispose le ruban rouge sur la bouteille, une autre machine colle l'estampille, la vineuse injecte une goutte d'alcool dans la bouteille pour un dernier nettoyage, la tireuse remplit la bouteille de liqueur et place le bouchon sur le goulot, la sertisseuse bouche la bouteille, l'étiqueteuse ajuste l'étiquette, ensuite les bouteilles sont placées dans des cartons qui seront fermés puis collés et disposés sur des palettes filmées prêtes à être livrées chez le client. Toute cette chaîne est automatisée, elle débite 6000 bouteilles à l'heure. La production annuelle de liqueur est de 12 millions de litres, la maison Cointreau n'a jamais connu de grève. Après une visite de plus d'une heure, nous nous sommes rendus au bar de l'usine où nous dégustons un cocktail à base de Cointreau. Ensuite nous avons rejoint notre hôtel qui se trouve à une trentaine de kilomètres d'Angers et de Cholet, c'est un village de 3000 habitants qui se nomme la Pommeraye. La Pommeraye doit son expansion à son ancien maire qui fut sénateur et président du conseil général du Maine et Loire. Le village est le siège social de 3 grandes entreprises de transports routiers dont une possède plus de 1000 véhicules. La commune possédait un couvent qui comprenait 900 religieuses de la congrégation de la Providence, aujourd'hui le couvent s'est transformé en maison de retraite pour religieuses et religieux. Après la seconde guerre mondiale, l'école laïque a été fermée car une des institutrices avait collaboré avec les Allemands, dans la région les établissements catholiques sont fortement implantés. Jusqu'en 1984 la Pommeraye ne comptait qu'une seule école privée mais depuis l'école laïque a réouvert pour répondre à la demande. La Pommeraye possède un collège privé de 600 places dont les deux tiers sont des enfants de la commune. Exceptionnel pour un village de 3000 habitants, il possède un lycée privé qui offre 200 places ce qui signifie qu'un enfant de la Pommeraye peut être scolarisé de la maternelle à la terminale. Le village est situé sur un promontoire domaine du vignoble d’Anjou, qui domine la vallée où coule la Loire. En route pour le château d’Angers que nous allons visiter avec une guide, qui nous a remis un document en braille relatif à la fameuse forteresse. ANGERS: Chef-lieu du département de Maine-et-Loire, sur la Maine; la ville rassemble 156 327 habitants [1999] (Angevins) et son agglomération 309 370 [1999]. Nœud de communication et centre commercial d'une riche région agricole. Constructions mécanique, électrique et électronique; textile et agroalimentaire; aéronautique. Université catholique ancienne et Université d'État récente. Centre national de la danse contemporaine. HIST. Place forte gauloise, puis cité romaine, plus tard capitale du comté d'Anjou, Angers fut rattaché à la couronne de France en 1480. ARTS. Bâti sur la rive gauche de la Maine, dominant la vieille ville, l'imposant château (reconstruit par Saint Louis au XIIIe s.) abrite un musée de tapisseries (tenture de l'Apocalypse, 1376). La ville possède de belles églises: cathédrale Saint-Maurice (XIIe et XIIIe s.), Saint-Martin (VIe-XIIe siècle), la Trinité (XIIe et XVIe siècle) et de remarquables édifices civils, notamment le palais épiscopal, ancien hôpital Saint-Jean (XIIe siècle), et le logis Barrault qui conserve un ensemble d'œuvres de David d'Angers. Nous abordons le château par une allée, nous franchissons le pont levis qui ne fonctionne plus, qui garantissait la porte de la ville. Le château a été construit en 1232, il occupe une surface de 22000 mètres carrés, le chemin de ronde mesure 1 kilomètre de long. L’ensemble est composé de 17 tours, le dernier duc d’Anjou qui a vécu ici est le roi René. Pendant sept siècles, des milliers de prisonniers ont été détenus dans cette forteresse, les murs font 2,80 mètres d’épaisseur. Nous pénétrons dans la cour du château, un jardin est implanté dans l’enceinte dont les plantes et la vigne sont réchauffées par l’ardoise qui constitue les murs. Les cents pieds de vigne cépage chemin donnent chaque année une centaine de bouteilles de vin blanc, dont la qualité est médiocre. Nous allons gravir par un escalier en colimaçon la tour du moulin, qui est la plus haute et la plus intacte de l’ensemble des 17 tours. Les 16 autres tours ont été endommagées au 16e siècle par ordonnance du roi, l’ordre avait été donné au gouverneur de l’époque le lieutenant Donadieu de Puycharic de détruire la forteresse qui était un sujet de conflit. Donadieu de Puycharic eut une idée géniale, tout en simulant le début de la destruction n’a fait que fortifier la forteresse en élargissant les remparts. La forteresse est construite face à la Maine afin de se défendre contre les Armoricains, les Normandes et les Anglais qui n’ont jamais pu en prendre possession. Dans la chapelle du château ont été détenus ou stockés plus de 500 prisonniers marins anglais, pour pouvoir les «entreposer», on avait construit des mezzanine en bois sur lesquelles on avait disposé des hamacs. Contrairement à un autre prisonnier connu Nicolas Fouquet, qui bénéficiait comme cellule le logis du gouverneur, c’est le chevalier D’Artagnan qui a accompagné le ministre des finances de Louis XIV à Angers. Nicolas Fouquet fut détenu dans la forteresse pendant 3 ans, puis après son procès il a été emprisonné à Paris pendant 19 ans. A partir du XIXe siècle, la forteresse est devenue une base militaire, nous approchons de la tour du moulin dans laquelle étaient détenus des prisonniers de tous genres. La tour est constituée de 3 niveaux, les murs du deuxième étage sont creusés d’ouverture d’archères et de canonnières puis nous arrivons à la plate forme de la tour du moulin. Nous sommes à 50 mètres d’altitude de la base de l’édifice, nous pouvons découvrir une vue panoramique de la ville et de la rivière. Au centre de la tour était disposé le moulin, la Maine est en contre bas du château ce qui fait que l’enceinte est creusée de fossés et non de douves. En fait, le château est construit sur un promontoire, les murs qui protègent le chemin de Ronde sont en ardoise. Le roi René était très apprécié de ses sujets, il est mort assez âgé pour le moyen âge, il était roi de Naples et de Sicile, duc puis comte d’Anjou. N’ayant pas eu d’enfant pour lui succéder, il a légué la tapisserie de l’Apocalypse à la cathédrale d’Angers. Le roi René a logé dans le logis royal qui se trouve dans l’enceinte du château; en empruntant le chemin de Ronde, nous nous dirigeons vers le jardin suspendu. Le roi René est décédé en 1480 à l’âge de 72 ans, son grand-père avait été le commanditaire de l’Apocalypse, il ne voulait pas que la tapisserie arrive entre les mains du royaume de France d’où ses legs. Nous pouvons admirer la cathédrale avec ses deux flèches, le roi René est mort à Aix en Provence. A sa naissance ses parents Yolande d’Aragon et Henri II l’ont prénommé René qui a une signification en latin Renatus, suite à un miracle un enfant mort fut ramené à la vie dont la sensation de renaître qui a donné le prénom René. Adoré par son peuple, René aime son Anjou par sa nature, son arboriculture, sa viticulture avec ses vins d’Anjou d’où son intérêt pour les jardins. Le jardin médiéval suspendu reconstitué en 1950 est constitué de ceps de vignes avec un rosier à chaque rangée afin de prévenir des maladies, d’absinthe, de buis, de la santoline, des campanules et bien d’autres plantes et fleurs. Ensuite, nous nous dirigeons vers la porte des champs en passant devant le logis du gouverneur où était détenu Fouquet, la porte des champs a été construite au XVIe siècle. Le pont-levis a été détruit, sous le porche nous pouvons voir les encoches où glissaient les deux herses au milieu desquelles était suspendu un assommoir. A travers d’allées qui serpentent dans un jardin, nous rejoignons la chapelle qui a servi de lieu de détention. Dans la chapelle sont exposées toutes sortes de matériel carcéral qui relatent sept siècles d’enfermement dans la forteresse du château d’Anjou des entraves de pieds, des colliers d’hommes en fer très lourds, des boulets de canons etc. la forteresse renfermait des prisonniers de guerre, de droit commun et des aliénés au moyen âge. Depuis la fin du XIXe siècle, les prisonniers ont déserté la forteresse pour la prison du Pré Pigeon, qui aujourd’hui est classée comme monument historique. En 1884, les aliénés vont aussi quitter la forteresse pour le nouvel hôpital psychiatrique construit dans la banlieue angevine. Enfin, nous nous dirigeons vers le musée qui renferme la tapisserie de l’Apocalypse, Ce musée contient de nombreux tableaux qui orne la galerie de l’Apocalypse qui a été construite en 1952 pour y exposer en 1954 la tapisserie qui à son origine mesurait 140 mètres de long sur 6 mètres de haut, chaque scène mesurait quant à elle 22,50 mètres de long. Aujourd’hui, la tapisserie est dressée contre un mur de 103 mètres de long, c’est la plus grande tapisserie médiévale au monde. Cette tapisserie n’a été exposée qu’une fois en intégralité lors du mariage des parents du roi René, à Arles en 1400. Sa spécificité est de n’avoir ni d’endroit, ni d’envers, il n’y a aucun nœuds, tout est dissimulé. La tapisserie est constituée de sept tableaux qui représentent chacun une scène, qui nous parle de l’apocalypse selon Saint-Jean. Le commanditaire de ce chef-d’œuvre est Louis Ier, duc d’Anjou, frère de Charles V roi de France au XIVe siècle. Trois noms apparaissent sur les factures: le peintre Hennequin de Bruges, Nicolas Bataille le marchand et Robert Poinçon le lissier, cette commande a été exécutée en 10 ans. L’Apocalypse a subi plusieurs avaries au cours des siècles, pendant la révolution on a découpé la tenture pour des besoins quotidiens, mais certains révolutionnaires vont mettre un terme à la destruction de l’Apocalypse. Dès sa nomination à la cathédrale d’Angers, le chanoine Joubert part à la recherche des pièces disparues. Son travail sera récompensé car il a pu reconstituer 103 mètres de la tapisserie initiale qui en comprenait 140, une scène complète est la propriété d’un riche collectionneur à Washington, une autre se trouve dans un musée à Glasgow. Ces tableaux qui forment l’Apocalypse servaient à décorer et réchauffer l’intérieur des châteaux. Sur ce chef-d’œuvre, nous avons une lecture biblique et une lecture socio-politique, car à l’époque, nous sommes pendant la guerre de Cent ans. Nous avons aussi beaucoup d’informations sur la végétation, on peut également comprendre les différentes échelles sociales par les figures et la façon de s’habiller. Après 2 heures de visite sous un ciel bleu, nous avons rejoint la Pommeraye pour y prendre le déjeuner. En route pour Cholet où nous allons visiter le musée d’art et d’histoire, nous passons devant le musée du textile que nous ne pourrons pas visiter. CHOLET: Chef-lieu d'arrondissement de Maine-et-Loire, sur la Moine, dans les Mauges; 56 320 habitants [1999] (Choletais). Gros marché aux bestiaux. Important centre industriel : textiles (lingerie, mouchoirs, cotonnades, confection), constructions mécaniques, matériel électronique, jouets, travail du cuir (chaussures) et du caoutchouc, conserveries. Musée des guerres de Vendée. Histoire Cholet est située dans une région où l'homme a laissé de nombreuses traces depuis la préhistoire: un cimetière néolithique, réutilisé par les Gaulois puis par les Romains, y fut mis au jour en 1884. La ville s'est formée au Moyen Âge autour de deux noyaux, sur la rive nord de la Moine. Le plus ancien, à l'est, se constitua sur le monticule de Livet autour d'une église fondée vraisemblablement au VIe siècle. Cette agglomération, d'abord appelée Aubigné, devint le bourg Saint-Pierre. Le noyau le plus récent, à l'ouest, est la cité féodale qui se développa au nord du château bâti au XIe siècle sur un escarpement rocheux dominant la rivière, et qui forma la paroisse Notre-Dame (1185). Cette structure demeura inchangée jusqu'à la fin du XVIIe siècle, époque à laquelle le marquis de Broon, seigneur de Cholet, réunit ces deux ensembles urbains par un nouvel axe, la rue des Vieux-Greniers. Un centre textile: Pendant la seconde moitié du XVIIe siècle, Cholet devint un centre important de négoce et de fabrication des toiles. En 1748, un bureau de la Marque y fut institué pour contrôler les produits de la manufacture. À la veille de la Révolution, la ville comptait 8 500 habitants, soit huit fois plus qu'un siècle auparavant. Une ville ravagée par les guerres de Vendée Pendant les guerres de Vendée, Cholet fut le théâtre de plusieurs combats qui provoquèrent sa destruction complète, et dont le plus meurtrier s'acheva par la victoire des républicains, le 17 octobre 1793. Durant ce conflit, la cité perdit plus des trois quarts de sa population: le recensement de 1797 faisait état de 2 162 habitants. L'industrialisation: Au XIXe siècle, les activités de la ville, en particulier l'industrie textile, reprirent rapidement. Le tissage fut mécanisé et concentré dans de grandes usines. Vers 1830, Cholet avait retrouvé sa population d'avant la Révolution; en 1857, elle devint la sous-préfecture du Maine-et-Loire. Le musée d’art et d’histoire de Cholet est implanté dans un ancien centre commercial qui n’a pas eu l’essor escompté, la municipalité a donc racheté le bâtiment puis elle a fait appel à 2 architectes qui ont transformé l’ancien Mag2 en musée. Le volume est divisé en plusieurs salles, la galerie d’art où sont exposés plus particulièrement des tableaux de peintres Choletais un certain Trémoliet, un autre dont le nom est Maindron et un contemporain Monsieur Morellet. Nous nous dirigeons vers la partie du musée Consacrée à l’histoire, pour la petite histoire des mines d’or ont été exploitées jusqu’en 1950 à Saint-Pierre-Montlimar. A la même époque les rues de Cholet ont été dépourvues de leurs pavés, pour remblayer le soutènement, on est allé chercher des remblais qui provenait des mines d’or de Saint-Pierre-Montlimar. C’est pour cela que aujourd’hui on dit que les choletais roulent sur l’or. La visite commence par le XVe siècle, Agnès Sorel était la maîtresse de François II, elle avait une cousine Antoinette de Magnolet qui l’a remplacée dans le lit et le cœur du roi à son décès. Demoiselle de Magnolet tira beaucoup de profit de sa liaison avec le roi qui se maria légitimement pour assurer sa succession, après sa rupture elle serait morte de Chagrin. Agnès de Magnolet s’était constituée une cour après avoir acheté la chatellerie de Cholet en 1460, les rendez-vous amoureux avec le roi François II qui était duc de Nantes se tenaient à Clisson, équidistant des 2 villes. Antoinette de Magnolet a été enterrée au couvent des cordeliers en 1470, pendant les guerres de religion 1568-1592, le couvent va être rasé ainsi que la chapelle où reposait le tombeau de Antoinette de Magnolet, la pierre tombale de la demoiselle de Magnolet sera mis à jour en 1870 et elle est exposée au musée. Pendant son passage à Cholet, elle attira la noblesse ce qui profita en terme économique à la cité. Deux rues portent des noms qui ont attrait à cette époque la rue Bel Ebat, la rue du Petit Conseil et la rue du Grenier à sel. La ville de Cholet est traversée par la Moine, qui au moyen âge délimitait le Poitou et l’Anjou. Le château de Cholet est construit face à la Moine, afin de protéger la ville des poitevins. En 1360, on a créé la gabelle qui était un impôt sur le sel, le Poitou en était exonéré, ce qui favorisait la contrebande. Il faut savoir que la gabelle multipliait le prix du sel par 40, on a donc installé un grenier à sel à Cholet. Un grenier à sel qui est constitué des officiers avec son grainetier, son receveur, un procureur, un avocat etc. vous aviez aussi un dépôt qui devait contenir 2 ans de réserve de sel pour un territoire qui en était le troisième élément, celui de Cholet comprenait 29 paroisses. Les officiers se réunissaient en petit conseil et formaient un tribunal, qui appliquait des sanctions à ceux qui trafiquaient avec le sel. La première fois, c’était une amende de 200 livres qui équivalait à une année de salaire, puis en cas de récidive on appliquait un lys au fer rouge sur l’épaule du contrevenant, puis la troisième sanction était l’envoi à Toulon pour être embarqué à bord de galère du roi. Nous arrivons en 1789 où la gabelle ne suffisait plus pour financer la royauté, Louis XVI et son gouvernement ont eu l’idée de récupérer les biens de l’église. Ces biens vont servir de contrepartie à une nouvelle monnaie l’assignat, la planche à monnaie a tellement tournée que l’assignat perdit beaucoup de sa valeur. Certains initiés ont fait fortune grâce à cette monnaie et l’état n’avait toujours pas d’argent, on a donc lancé les états généraux, la législative puis la convention. Trois dates importantes: le 3 janvier 1793 Louis XVI est décapité, puis on instaure la loi contre les prêtres qui vont être obligés de quitter le territoire national et le 3 mars 1793 c’est la première révolte dans Cholet. Le 14 mars 1793 c’est la prise de Cholet par les vendéens ou le début des guerres de Vendée, qui pour les Choletais se termineront le 14 octobre 1793 par la prise de la ville par les républicains. Nous passons dans une salle où sont exposés tous les tableaux qui représentent les chefs des vendéens, ces tableaux ont été commandés sous Louis XVIII pour les offrir aux familles de ces combattants, les tableaux ont été peints entre 1815 et 1830. Les guerres de Vendée désignent les luttes menées contre la Révolution, à partir de 1793, par les royalistes de l'Ouest. En 1789, la Vendée et les Mauges (sud de l'Anjou) étaient les régions où le régime seigneurial et l'esprit de la féodalité avaient le plus conservé leur aspect traditionnel. Les métairies du Bocage vendéen appartenaient à une noblesse souvent rapace à l'égard de ses tenanciers, mais qui avait le mérite de résider sur ses terres: elle n'aimait pas en sortir et même répugnait à servir dans les armées du roi. Elle avait conservé le gouvernement des affaires locales, qu'elle partageait avec le clergé. En effet, la Vendée était demeurée étrangère à l'indifférence ou à la tiédeur religieuse du XVIIIe siècle. Au contraire, la religion avait gardé des efforts missionnaires du XVIIe siècle une allure colorée et chaude, très différente de la piété sévère des cercles fervents au XVIIIe siècle. On aimait beaucoup les dévotions, particulièrement celle, toute récente, du Sacré-Cœur. La fidélité religieuse et monarchique La société vendéenne demeura dans la France révolutionnaire un îlot de stabilité. L'agitation naquit de l'application des lois révolutionnaires. La Constitution civile du clergé fut appliquée en Vendée comme ailleurs; mais la quasi-totalité de la population suivit les «bons prêtres», hostiles à l'Église constitutionnelle et poursuivis par les nouvelles autorités légales. Une organisation religieuse parallèle, bientôt persécutée, rassembla les Vendéens, épouvantés par la mort de Louis XVI, le 21 janvier 1793. L'exécution du roi atteignit en effet la sensibilité religieuse de la population. Le roi de France n'était pas un vulgaire chef d'État; il demeurait l'oint du Seigneur, et son existence paraissait liée à celle de l'Église. Le soulèvement de 1793 Les sentiments religieux et monarchiques, indissociables, furent à l'origine du soulèvement de mars 1793, bien que l'étincelle qui mit le feu aux poudres fût l'essai de conscription tenté par les autorités républicaines. Il s'agissait de trouver des volontaires pour l'armée ou de faire désigner par la population un contingent d'appelés. Alors, des bandes de jeunes Vendéens se répandirent de village en village et se lancèrent à l'assaut des petites villes où se tenaient les forces républicaines : Cholet et La Roche-sur-Yon furent prises. En quelques jours, la Vendée et les Mauges entraient en dissidence. Les républicains étaient massacrés; on fit disparaître drapeaux tricolores et emblèmes révolutionnaires. Les révoltés arborèrent le drapeau blanc et la fleur de lys, le chapelet et le Sacré-Cœur. L'organisation des forces La Vendée catholique et royale était née. La révolte spontanée avait été paysanne et populaire. Des chefs s'étaient improvisés sur-le-champ, dans le tumulte de la première agitation. Cathelineau était colporteur, Stofflet un ancien soldat devenu garde-chasse. Ici, un perruquier commandait une bande; là, un marchand de volailles. Après leurs premiers succès, dès la mi-mars 1793, les paysans sollicitèrent les nobles, leurs chefs naturels, ceux qui portaient l'épée et auxquels ils étaient habitués à obéir. Sans enthousiasme, contraints en quelque sorte par leurs anciens tenanciers, les nobles se mirent à la tête du mouvement: des gentilshommes campagnards s'amalgamèrent aux chefs plébéiens des débuts. On s'organisa sous le contrôle d'un conseil supérieur, dirigé par l'abbé Bernier, prêtre réfractaire à la Constitution civile du clergé, car les prêtres réfractaires soutenaient inconditionnellement les insurgés. Les trois armées vendéennes Trois armées furent formées: l'«armée d'Anjou», commandée par le marquis de Bonchamps; la «Grande Armée catholique et royale» du Bocage vendéen, animée par Cathelineau et par Maurice d'Elbée, un officier; l'«armée du Marais» sur la côte, dirigée par François de Charette de la Contrie. Les troupes vendéennes pratiquaient l'embuscade; elles se rassemblaient et s'éparpillaient rapidement à travers la campagne. Mais, malgré l'indigence de leur armement, elles devinrent vite capables de batailles rangées. Les troupes républicaines, les «Bleus», composées de volontaires parisiens, pillards et indisciplinés, battirent en retraite. En mai 1793, les Vendéens prirent Thouars et Fontenay-le-Comte; en juin, Saumur et Angers. Ils pensèrent marcher sur Paris, mais ils préférèrent se retourner vers Nantes, où ils échouèrent à la fin de juin. Les «Bleus» conservèrent la ville et les «Blancs» perdirent Cathelineau, blessé mortellement. La défaite L'insurrection demeurait très forte, mais il lui manquait les renforts qu'elle espérait. Aucun des princes exilés, le futur Charles X, par exemple, ne pensa à venir animer le combat. Aucun des évêques émigrés ne vint se placer au milieu des Vendéens. Le 1er août 1793, la Convention ordonna la destruction méthodique des maisons, des récoltes, du cheptel, afin de rendre le pays inhabitable. Elle envoya dans l'Ouest l'armée vaincue à Mayence, qui avait promis à ses vainqueurs, pour avoir sa liberté, de ne pas combattre pendant un an les ennemis de la France. En octobre 1793, sous la direction de Kléber, deux colonnes républicaines, parties, l'une de Nantes, l'autre de Niort, se rejoignirent à Cholet, où les Vendéens furent écrasés et perdirent Bonchamps. Les «Blancs» franchirent la Loire en catastrophe et se dirigèrent sur Granville, sous la conduite de La Rochejaquelein. Les Vendéens espéraient s'emparer de Granville et recevoir des secours de la Grande-Bretagne, mais ils ne purent entrer dans la ville et rebroussèrent chemin jusqu'à la Loire, où les débris de leur troupe furent détruits dans les combats du Mans et de Savenay, en décembre 1793. Autour des chefs rescapés, il n'y eut plus que des îlots de résistance; les représailles commencèrent. Des troupes républicaines, formées en «colonnes infernales» et commandées par Turreau, ravagèrent le pays. À Nantes et à Angers, les contre-révolutionnaires furent, par milliers, guillotinés, fusillés, noyés dans la Loire. À cette Terreur répondit le terrorisme des Chouans qui, en Bretagne et dans l'Ouest tout entier, menaçaient les vies et les biens des républicains. Ils tiraient leur nom du premier d'entre eux, le paysan manceau Jean Cottereau, dit Jean Chouan. La chouannerie bloqua l'administration et l'activité régulières des départements de l'Ouest. Pour en finir, la Convention thermidorienne fit, sur les conseils de Kléber, de larges concessions: amnistie générale, accords de paix signés avec différents chefs vendéens, tolérance religieuse surtout. Les chefs vendéens et les Chouans ne voyaient là qu'une trêve. Mais, pour le gros de leurs troupes, c'était la paix et le retour des «bons prêtres». Quand, en juin 1795, Charette, en Vendée, et Cadoudal, en Bretagne, se révoltèrent à nouveau, le soulèvement fut de faible ampleur. Dans le même temps, les émigrés qui avaient débarqué à Quiberon étaient vaincus et fusillés; l'expédition du comte d'Artois ne dépassa pas l'île d'Yeu (octobre 1795). En février-mars 1796, Stofflet et Charette, qui battaient encore la campagne, furent pris et fusillés. La chouannerie s'éteignait doucement, quand, en 1799, le Directoire la ressuscita en recommençant les persécutions religieuses. Elle eut de nouveaux chefs: Cadoudal, Bourmont, d'Andigné. Dernières phases Il revint à Bonaparte, Premier consul, d'achever la pacification. Il accorda l'amnistie mais se montra impitoyable envers les rares irréductibles. La Vendée demeura calme jusqu'en 1815 ; pendant les Cent-Jours, elle forma une armée royaliste. En 1832, la duchesse de Berry chercha à ranimer les dernières braises vendéennes, mais la Vendée ne se souleva pas pour soutenir le roi légitime. Les révoltes n'étaient plus qu'un souvenir, ravivées cependant par les historiens, et particulièrement lors de la célébration du bicentenaire de la Révolution de 1789. Nous circulons ensuite au milieu de vitrines qui renferment des armes vendéennes des faux emmanchées verticalement, des fourches, des pointes, des épées des fusils et toutes sortes d’armes. Nous découvrons un tableau qui a créé la polémique depuis son exposition au musée des généraux vendéens en 1993, c'est un tableau académique car il est structuré avec deux côtés distincts, c'est un tableau réaliste par les détails du prêtre attaché à l'arbre, de la femme allongée qui est morte, c'est un tableau romantique avec le sens des ruines, il est aussi manichéen dans la mesure où l'on va opposer les bons républicains aux méchants vendéens. C'est une immense toile qui jusqu'à son exposition au musée des généraux vendéens était roulée dans les réserves du musée de Cholet, certains choletais n'ont pas accepté que l'on expose ce tableau dédié aux généraux vendéens car le peintre a représenté les massacres des vendéens sur les républicains. Le 19 décembre 1793 la bataille de Torfou a été gagnée par les femmes, une armée française encerclée a du capituler à Mayence, comme punition on l'envoya combattre en Vendée. Les mayençais étaient bien habillés et bien commandés par des chefs militaires ce qui fait que dans un premier temps les vendéens vont reculer. Devant cette attitude les femmes vont prendre des bâtons et menacer leurs maris s’ils ne retournent pas au combat, poussés par leurs femmes les Vendéens reprennent un regain de courage et enfoncent et repoussent les mayençais. Un tableau représente le plan de Cholet après la prise de la ville par les républicains, le 17 octobre 1793, on aperçoit le château avec son toit détruit, les premières maisons de Cholet toujours des fermes, un enclos qui est un cimetière avec ses tombes, un moulin à vent qui se trouve à l'emplacement de l'église du sacré coeur, la déroute des vendéens est représentée par une charrette qui roule à toute vitesse pour traverser la Loire. Nous passons devant la statue de Bonchamps qui a demandé grâce pour les prisonniers républicains, le sculpteur est David d'Angers dont un de ses aïeuls faisait partie des prisonniers à qui Bonchamps a sauvé la vie. Nous avons parlé des généraux, des femmes, maintenant nous allons parler des enfants le petit Barrat, qui était originaire de Palaiseau. Il était venu avec le général Desmarets pour s'occuper de son cheval, une nuit il est surpris dans une clairière par un groupe de vendéens, qui lui demande de crier "vive le roi".Le garçon cria "vive la république", aussitôt il sera transpercé de coups de baïonnettes. Desmarets va envoyer un compte rendu à paris, Robespierre va se servir de ce cas pour faire un discours enflammé à la tribune de la convention. Le petit Barrat va devenir le héros républicain, dans le musée il est représenté en général de cavalerie. Un tableau évoque les mariages républicains, on mettait dans une barque un curé et une bonne soeur nus qui étaient attachés entre eux, puis au milieu de la Loire, on ouvrait la trappe sous l'embarcation c'était une façon d'économiser une balle. L'horrible est peut-être le suicide du général Boulin, encerclé par les vendéens il se tira une balle sous le menton, il ne voulait pas tomber vivant aux mains des vendéens car il portait un pantalon en peau de vendéen tannée. Il a existé une tannerie de peau humaine à Clisson, au musée d'art et d’histoire de Nantes on y voit une peau humaine tannée. Dans une vitrine on distingue un crâne humain, c'est le crâne de Stofflet, il était d'Europe centrale et a participé à la prise de Cholet en 1793. Entre 1794 et 1796 il va faire le coup de main dans la région de Cholet, trahi par l'abbé Bernier il est traduit devant un tribunal, condamné à mort il sera fusillé à Angers. A cette époque à Angers, un médecin farfelu voulait savoir dans quel coin du cerveau, pouvait bien se trouver la glande qui empêchait les Vendéens d'accepter les idées de liberté, égalité et fraternité. Le crâne va rester dans la famille Stofflet dans du formol, ça va passer par testament de père en fils à condition que le fils soit médecin. Aujourd'hui la famille ne comprend plus de médecin, alors le crâne de Stofflet est en dépôt précaire au musée des généraux vendéens. Nous passons devant des vitrines qui renferment des souvenirs de la restauration 1815-1840, c'est Louis XVIII, Charles X et Louis Philippe vont se succéder, envoyés en exil à la suite de quelques révolutions dont celle de 1830. Pendant la restauration les gouvernements sont redevables auprès des vendéens et ils les récompensent par des fusils d'honneur, de l'argent et les albums des copies des tableaux des généraux vendéens seront vendus au profit des vendéens. Une grande statue représente le Vendéen, elle était dressée dans un carrefour de Cholet, mais certains ne voulait plus voir ce symbole du passé l'ont plastiqué, reconstituée la statue a trouvé sa place au musée. La tête du vendéen est une copie de la tête de la statue de Jeanne d'Arc qui se trouve à Rouen. Dans sa main gauche, le Vendéen tient un coeur, dans l'autre main arrachée il tenait une faux emmanché verticalement. Nous arrivons dans la salle qui se réfère à 1914, un régiment installé à Cholet en 1870 et dissout après la première guerre mondiale, le 77e régiment d'infanterie qui à l'origine devait préserver Cholet de tous soulèvements. Ce régiment s'est illustré au cours de la première bataille de la Marne, le terme (bleu) vient de la couleur bleue des pantalons qui avait remplacé la couleur garance trop voyante, alors on savait tout de suite où se trouvait les nouveaux arrivants qui portaient le pantalon bleu. Cholet possède un aérodrome depuis 1910, il est à l'emplacement où se tenait le terrain de manoeuvre du 77e d'infanterie. En 1910, un certain Roland Garros est venu à Cholet pour passer son brevet de pilote, il a participé à la guerre de 1914, il est mort 5 semaines avant l'Armistice abattu dans son avion. Une société aérienne était aussi installée à Cholet pendant un temps, elle transportait par ailleurs l'équipe de basket de Cholet lors de ses déplacements. Une figure de Cholet monseigneur Luçon qui a été curé de notre dame de Cholet, ensuite il a été cardinal de Reims dans les années 1905 au moment de la séparation de l'église de l'état. On lui a donc demandé à récupérer le reliquaire, qui renfermait la sainte ampoule contenant l’huile sainte qui sert pour oindre les rois de France. On lui a demandé le reliquaire qu'il a donné mais il a gardé la sainte ampoule que l'on a retrouvé quelque temps après. Si par hasard un roi en France voulait être oint et sacré, ça serait grâce à monseigneur Luçon. Après avoir fait le plein d'histoire vendéenne nous avons rejoint la Pommeraye, nous sommes passés à Saint-Pierre Montlimar où se trouvent le siège social de la société Eram, les entrepôts qui alimentent les magasins et toute l’activité administrative et commerciale de la marque. Le retour à la Pommeraye c’est passé avec des commentaires avisés et coquins du troubadour Phony, sans oublier son ami d’enfance Jean-Jacques. En route pour le musée des traditions et des anciens métiers à Saint-Laurent–la-Plaine, ce musée a été créé en 1975 dans l’ancien presbytère.A l’intérieur du musée le revêtement du sol est en tommettes (pierres cuites) afin de donner un côté XIXe siècle au bâtiment. Dans une salle nous apercevons tout ce qui concerne la bureautique et l’imprimerie, où se côtoient des machines à écrire du début du XXe siècle et des machines d’imprimerie qui remontent à la fin du XIXe siècle. En continuant notre circuit nous pouvons découvrir des objets en broderie des bavoirs, des coiffes, des habits ecclésiastiques et toutes sortes de costumes. Une salle renferme les objets de passementerie, rubans et galons qui autrefois ornaient les vêtements ce qui revient à la mode, aujourd’hui la passementerie est réservée aux décors intérieurs rideaux, ameublement etc. Nous circulons au milieu de matériels usuels comme des cardes pour carder la laine, un appareil qui fouette avec des lanières la fourrure afin de la nettoyer. Ensuite nous déambulons dans un espace réservé aux machines à tisser, c’est le royaume de Jacquard. Les matières utilisées par ces machines étaient le coton, le lin, la soie, pour constituer un ruban une machine à tisser utilise jusqu’à 16 fils commandés par une carte perforée. Nous pénétrons dans la cour de l’ancien presbytère où coule une fontaine, puis nous apercevons un énorme marteau emmanché d’un tronc d’arbre qui était activé par la force hydraulique, ce marteau servait à marteler le cuivre pour confectionner des chaudrons. Sous un hangar sont exposés toutes sortes de charrettes, de cycles du XIXe siècle puis nous nous dirigeons dans d’autres dépendances. Nous découvrons la fabrique d’un sabot avec tous les outils nécessaires pour sa confection, nous découvrons également les rudiments de la cordonnerie du début du XIXe siècle. A cette époque le soulier gauche et le pied droit étaient identique, on inter changeait chaque jour les chaussures pour les faire à son pied. Un espace est consacré à la ciergerie, certains cierges sont décorés, la décoration était obtenue dans un bain d’eau chaude où l’artisan modelé son cierge à l’aide de pinces spéciales. Nous entrons dans le domaine de la forge où sont disposés tous les outils utilisés par le forgeron, une odeur de graisse se dégage de cet endroit. Le village possédait beaucoup de maisons des câlins qui n’étaient pas des maisons de passe, mais la contraction de cave et lin, c’étaient les maisons des tisserands. Les tisserands travaillaient le lin dans leurs caves, ce métier a eu une grande réputation avec les fameux mouchoirs de Cholet qui a fait la richesse des Mauges. Aujourd’hui pour acquérir un mouchoir en lin de Cholet, il ne reste plus qu’un site de production qui se trouve au musée du textile à Cholet. Les tisserands en 1880 sont devenus les ouvriers des usines de chaussures, en 1990 le Maine et Loire produisait le quart des chaussures françaises, aujourd’hui beaucoup d’usine délocalisent leur production dans les pays où la main d’œuvre est moins chère. Ensuite nous sommes dans l’environnement de la lingère, nous pouvons remarquer toutes sortes de fers à repasser installés sur une cuisinière du XIXe siècle. Nous pénétrons dans une pièce transformée en salle de classe où sont exposés des pupitres avec leurs encriers, l’estrade où trône le bureau du maître avec la bouteille d’encre, des porte-plume avec leurs plumes Sergent Major, des buvards, un tableau où est inscrit à la craie blanche une règle de morale, un bonnet d’âne, une règle est placée dans un coin de la classe où l’élève était agenouillé comme punition, un grand poêle est dressé au fond de la classe. Puis nous visitons une habitation du XIXe siècle où tout se passait dans la même pièce seule à être chauffée, sur la tables est installé le couvert, au bout de la table se trouve une chaise sur laquelle est posée la chemise du chef de famille. Le chef de famille mange en face de la porte d’entrée avec son fusil à portée de la main, une lampe à pétrole est suspendue au milieu de la pièce. Un lit à baldaquin est situé dans le coin de la pièce, une pierre d’évier est installée sous la fenêtre avec son seau pour aller chercher l’eau au puits ou à la fontaine la plus proche. Nous sortons du musée qui propose 1000 mètres d’exposition, nous nous dirigeons vers l’église qui est attenante de l’ancien presbytère, nous marchons à travers de matériels vinicoles des cuves, des pressoirs, des alambics à Cognac, des alambics ambulants qui circulaient de ferme en ferme. Aux abords de l’église est installée une immense roue à aube, qui entraîne un immense axe qui servait à faire fonctionner une scierie dans les Vosges. Enfin nous pénétrons dans une remise où sont stockés du matériel agricole machine à battre à vapeur, une auge en bois qui servait à piler les ajoncs, des chariots dont les roues en bois atteignent près de 2 mètres de haut, un motoculteur de 1930 et de nombreux autres charrois. C’est à midi pétante au clocher de l’église que notre voyage dans le XIXe siècle s’est terminé, nous avons rejoint la Pommeraye pour y prendre le déjeuner. Du vignoble d’Anjou aux coteaux du Layon, ces deux vignobles sont distants de 7 kilomètres. Pour rejoindre Chalonnes, nous circulons sur la route empruntée pour la course de côte automobile qui compte pour le championnat de France. LA Loire qui traverse Chalonnes est située à 60 mètres en contrebas de Pommeraye, au cours de notre descente nous apercevons des carrières de chaux. Nous arrivons dans la vallée de la Loire où les terres sont inondables, la plaine est ensemencée de blé. Nous traversons la ville de Chalonnes pour rejoindre le caveau où nous attend le petit train touristique qui va nous faire découvrir le vignoble des coteaux du Layon. Chalonnes a 6000 habitants, la ville remonte au temps des gaulois, à l’époque médiévale Chalonnes était la propriété de l’évêque d’Angers. L’économie locale est représentée par l’usine Eram et l’entreprise Balland-Bucher qui fabrique du matériel viticole. Nous serpentons dans les rues de Chalonnes dont les spécialités culinaires sont le brochet au beurre blanc, les rions (des petits morceaux de cochon, le pâté aux prunes et la fameuse saucisse au vin blanc que l’on peut déguster lors de la fête des vins qui se déroule tous les derniers week-end de février. Nous roulons dans la rue des Cordiers, auparavant cette rue était le lieu où les gens transformaient le chanvre pour confectionner des cordages, des sacs ou des vêtements. En 1960 dans la vallée de la Loire, on cultivait encore 400 hectares de chanvre, aujourd’hui on cultive du maïs, beaucoup de fleurs séchées et des melons. Nous apercevons une place dont Louis XIV en instaura le champ de foire au XVIIe siècle, actuellement 3 cafés subsistent à cet endroit qui en a compté une vingtaine. L’hôtel de ville a été construit en 1860 sous Napoléon III, nous franchissons la Loire grâce au pont suspendu construit en 1948 qui est un des premiers ponts suspendus par câbles construis en France. Nous empruntons les quais de Chalonnes en bordure de Loire qui mesure 600 mètres de long, des jalons relatent les grandes crues de la Loire qui a un débit qui peut varier de 40 à 7000 mètres cubes par seconde. Le niveau du fleuve peut aller de moins 1,20 mètre à plus 6,80 mètres, ce qui fait un écart de 8 mètres de hauteur. Au milieu de la Loire se situe l’île de Chalonnes qui comprend 300 habitants, le chanvre à complètement disparu de l’île qui recouvrait la moitié de sa superficie. Gilles de ray le fameux barbe bleue s’est marié à Chalonnes le 22 juin 1422 avec sa cousine Catherine de Thouars. Les 3 grandes crues mémorables sont celles de 1910, 1936 et celle de 1982 qui est encore dans la mémoire de tous les habitants de Chalonnes. Une voie romaine traversait la Loire à Chalonnes, pendant l’été on peut encore apercevoir quelques rochers qui signifient la présence de cette voie de communication. Notre moyen de locomotion le petit train est le résultat de l’association de 6 viticulteurs, qui l’ont acheté pour faire découvrir leur vignoble et leur production. La gare de Challonnes est située sur la ligne entre Angers et Cholet qui a été ouverte en 1848, le quartier de la gare quant à lui date des années 1950. Nous quittons Chalonnes pour aborder les vignes, nous traversons le petit village de la Croix-Brouillay, c’est ici que fut construit le premier puits de charbon au XIV.me siècle. Un des concessionnaires de la mine était le comte de Lascaze qui, avec son père, avait accompagné Napoléon à Sainte-Hélène. Le charbon était expédié par voie ferrée depuis Chalonnes, puis nous commençons la route du vignoble. Le vignoble angevin représente 20000 hectares, qui produisent plus un million d’hectolitres de vin. A Chalonnes, la vigne représente 170 hectares répartis sur 18 vignerons, la production est de part égale entre le blanc, le rosé et le rouge. Le rendement de rouge est de 2 bouteilles par cep de vigne, celui du blanc coteau du Layon est d’une bouteille par cep de vigne d’où l’écart de prix à la vente. En Anjou 50% des vignerons vinifient eux même leur vin, il faut savoir que la vigne peut pousser de 10 centimètres par jour à certaines époques. Au mois de juin on effectue le palissage de la vigne, nous approchons du village de Dardenay qui était aussi un village de mineurs. En 1750 la région possédait 36 puits de charbon dont 2 qui atteignaient 560 mètres de profondeur. Les vignes sont le royaume du rosier, nous passons devant chez un horticulteur qui cultivent des plantes d’ornement et des semis. Aujourd’hui la vigne est plantée avec l’aide d’un laser, les rangées sont espacées de 2 mètres ainsi que chaque cep, ce qui nous donne 5000 pieds à l’hectare en Anjou. Il faut savoir que c’est 6000 pieds à l’hectare dans le Muscadet et 10000 pieds dans le bordelais. Dans la région existent 3 sortes de moulins dont celui à tour apparu en Anjou au XIVe siècle, ce type de moulin avait uniquement le toit qui pivotait. Les moulins ont fonctionné jusqu’en 1922, ils ont servi à la résistance au cours de la seconde guerre mondiale et comme repères pour l’aviation. L’herbe envahie la vigne où elle est tondue, sa présence empêche la terre de descendre en bas de la pente, qui dans les coteaux du Layon peut atteindre 30 à 40% La tonte amène des matières organiques au sol, cette technique permet une diminution de 50% de désherbant utilisé. Il existe plusieurs cépages le cabernet rouge ou le cépage blanc sec, le chenin qui est vendangé manuellement. En général les vendanges débutent au mois d’octobre, à la machine 3 hommes vendangent 3 hectares en une journée, pour la même superficie manuellement il faut 8 hommes et une semaine pour effectuer le même travail. Le chenin se ramasse à sa macération (pourriture noble), on peut effectuer plusieurs passage dans une vigne pour faire la récolte du raisin. De novembre en février on taille la vigne, en avril et mai on fait l’ébourgeonnage, au mois de juin c’est le palissage qui consiste à remonter les fils de fer, en juin on fait les passages dans la vigne et on tond l’herbe, pendant l’été on laisse la vigne pousser et le raisin mûrir. Des anciennes cabanes en pierre qui servaient autrefois de reposoir et d’entrepôt sont parsemées au milieu des étendues de vignes. Certains carrés de vigne ont 80 ans, à partir de 30 ans la vigne a des racines de un mètre de longueur ce qui fait qu’elle trouve sa nourriture dans le sol et qu’elle ne crève jamais. Nous découvrons la vallée de Rochefort avec son pont qui enjambe la Loire où circulent les trains de la ligne Angers Cholet. Cette vallée en 1982 était transformée en un immense lac, une charrue et un pressoir ornent un rond point. Nous approchons de Chalonnes dont le territoire héberge 6 fours à chaux, la chaux servait à faire du mortier, pour adoucir la terre surtout en Bretagne. Le chaux fournier l’ouvrier du four disposait de la paille, du sarment et des bûches à la base du four pour allumer le feu. Après la mise à feu on disposait une tonne de charbon puis 2 tonnes de pierre calcaire, la pierre calcaire se décomposait et se transformait en chaux. La cendre et la chaux se séparaient automatiquement à la base du four, au fur et à mesure que la cuisson faisait baisser le niveau de matériau, on ajoutait du charbon et de la pierre calcaire pour perpétuer le processus. En fin d’activité le puits de charbon doit être rebouché, pour être plus productif les ouvriers jetaient des piquets de bois dans le puits qui s’enchevêtraient ce qui provoquait un bouchon. Le bouchon faisait économiser de la terre à injecter dans le puits ce qui favorisait économiquement l’ouvrier, mais, la conséquence c’est que plusieurs décennies plus tard, on a construit des habitations sur ces anciens puits qui s’affaissent au gré du temps. Nous voici au belvédère qui est le point culminant de Chalonnes 66 mètres au-dessus de la Loire, une tour y est construite qui servait au propriétaire terrien de surveiller ses ouvriers à la tâche. Depuis le haut de la tour on peut découvrir 17 clochers des communes avoisinantes, puis nous redescendons sur la ville. Nous effectuons un transfert du petit train à notre bus, nous nous rendons dans une cave particulière pour une dégustation. Nous avons droit à la visite de la cave depuis l’arrivée du raisin, les différentes vinifications des vins blancs, rosés et rouges. Pendant l’élevage du vin le viticulteur goûte son nectar presque quotidiennement afin de contrôler sa maturité. Une fois que le vin est bien structuré, on effectue le décuvage, puis vient le conditionnement. Le domaine s’étend sur 18 hectares de vigne, en plus du couple de viticulteurs 2 employés travaillent Toute l’année. Toute la production est vendue aux particuliers dont une grande partie aux visiteurs de la cave drainés par le petit train. Le domaine commercialise uniquement du vin en AOC d’Anjou comme les coteaux du Layon, il existe aussi un crémant d’Anjou. Après la visite la propriétaire des lieux nous a proposé une dégustation sans modération, elle était assistée pour le service par nos 5 guides angevins qui ont su nous faire savourer les différents vins. Bien désaltérés nous avons fait nos emplettes, puis le visage rougit par le soleil et la fraîcheur de la cave nous avons repris la direction de la Pommeraye. Après le petit train en route pour embarquer sur le bateau afin de découvrir l’environnement de la Loire, c’est à Montjean-sur-Loire que débute notre promenade fluviale. Nous naviguons sur le lit mineur de la Loire qui fait 100 mètres de large, alors que le lit de la Loire atteint 600 mètres. La Maine qui coule à Angers est le tronc commun de la Mayenne, du Loir et de la Sarthe qui se jette dans la Loire. Nous apercevons un grand banc de sable où séjournent des sternes, ils parcourent 10000 kilomètres pour venir se reproduire ici, leur zone d’hivernage se situe entre l’équateur et le Sahara. On les appelle hirondelles de mer, ce sont des oiseaux piscivores qui lors de leur prélude à l’accouplement, la femelle répond favorablement aux avances du male lorsque celui-ci a réussi à pêcher 3 poissons. La femelle pond ses œufs à même le sable, c’est la chaleur emmagasinée par le sable qui va couver les œufs. Pour rafraîchir la chaleur des œufs, en plein été le sable peut atteindre 50 degrés, les parents font des va et vient dans le fleuve pour humidifier leur plumage afin de tempérer les œufs. Nous croisons une reproduction de gabare qui est accostée au bord du fleuve, ce genre d’embarcation a navigué sur la Loire du XVIIe au XIXe siècle. Les planches de la gabare ne sont pas placées bord à bord, mais à Clain c'est-à-dire qu’elles se chevauchent. Ces bateaux avaient un mât qui pouvait atteindre 10 mètres de hauteur et une voile, la longueur d’une gabare pouvait varier entre 14 et 30 mètres. Pour passer sous les ponts les mâts étaient articulés, pour avoir moins de perte de temps au passage des ponts, on avait inventé la technique du train de gabares qui comprenaient de 6 à 10 gabares accrochées l’une à l’autre. Lors du passage d’un pont la première gabare baissait son mât et les autres continuaient à pousser. La manœuvre se répétait à chaque gabare en approche du pont, ce qui fait que le train de gabare était toujours en action lors du passage sous un pont. Depuis 1863 quand on parle d’une crue en Loire c’est à Montjean-sur-Loire, toute l’eau qui coule en Loire et ses affluents se retrouve en un seul bras c’est où nous sommes actuellement. Certains courants remontent la Loire par endroits, ils sont dus aux piles de ponts, aux bancs de sable ou aux épaves. Nous approchons une partie où la Loire se divise en deux bras, nous empruntons le bras de droite qui est navigable depuis 1900, auparavant les gabares empruntaient le bras de gauche qui est plus rectiligne. L’île de Chalonnes est la plus grande île sur la Loire, elle fait 14 kilomètres de long pour une superficie de 800 hectares. Nous longeons le village de Montjean-sur-Loire qui a près de 3000 habitants, au XVIIIe et XIXe siècle, c’était le deuxième port sur la Loire après celui de Nantes. Au large de Monjean-sur-Loire croisaient 14000 bateaux par an, les bateaux transportaient de 40 à 80 tonnes de marchandises du vin, de la chaux, du sable, du sel, du sucre, du café, du cacao, de la porcelaine, de la ferronnerie, des cacahuètes, de la noix de coco, des peaux d’oranges etc. Depuis 12 ans, aucun bateau de commerce ne navigue sur la Loire à cause du manque d’eau. Les cacahuètes servaient à faire de l’huile à Château-Gonthier, les peaux d’oranges allaient à Angers pour les usines Cointreau et les noix de coco étaient utilisées pour fabriquer des chapelets. Saumur était devenu la capitale du chapelet, tout en étant un fief protestant pour dire que l’argent n’a pas d’odeur. Une profession a disparu du lit mineure de la Loire ce sont les sabliers, on n’a plus le droit d’extraire un seul grain de sable du fond de la Loire. Le long du quai de Loire à Montjean-sur-Loire sont exposées des statues dont une représente la tête d’un noir, c’est de mauvais goût car le port négrier le plus important était celui de Nantes. Montjean-sur-Loire organise depuis une dizaine d’années un symposium de sculptures monumentales, ce qui fait que les statues sont intransportables alors on les expose où l’on peut. Aujourd’hui il ne reste plus que 20 pêcheurs professionnels, on en a compté jusqu’à 1200 au début du XXe siècle, ce n’est pas par manque de poissons, mais les gens n’aiment plus les poissons avec des arêtes. Les bateaux des pêcheurs professionnels font de 6 à 8 mètres de long, ils ont le nez plat pour accoster plus facilement la rive. Aujourd’hui les bateaux sont propulsés avec des moteurs, En trente ans la vitesse de la Loire est passée de 4 kilomètres heure à 12 kilomètres heure. De décembre au mois de mai on pêche la lamproie qui est une sorte de grosse anguille, c’est un migrateur qui vit en mer et se reproduit en eau douce, elle mesure environ un mètre et pèse 2 kilogrammes. Les lamproies sont vendues dans la région bordelaise et exportées en Espagne et au Portugal. Actuellement on pêche l’alose qui est aussi un poisson migrateur, elle fait partie de la famille de la sardine, elle peut peser jusqu’à 3 kilogrammes. Dans la Loire on pêche également le brochet, le sandre, la Brême, le sardillon, le mulet, le gardon, la perche, l’anguille enfin tous les poissons d’eau douce. Nous apercevons une drôle de construction de 30 mètres de hauteur, c’est un chevalement de puits qui faisait 180 mètres de profondeur. Du fond du puits on a des galeries qui mesuraient jusqu’à 1 kilomètres de long dont certaines passaient sous la Loire et d’ici on extrayait du charbon. Depuis 1740, on a fait appel à la communauté belge pour l’exploitation minière, les belges possédaient une technique qui était d’étayer les galeries à l’époque. Le chevalement de puits a été construit en 1870, depuis l’an dernier ce bâtiment est classé monument historique. Nous passons sous une passerelle construite en 1979, elle a remplacé le bac qui faisait la jonction entre l’extrémité de l’île de Chalonnes et Montjean-sur-Loire ce qui évitait d’aller passer le pont pour se rendre sur la rive à Chalonnes. Pour la petite histoire les bateaux de la Loire ont disparus, c’est à Montjean-sur-Loire qu’ils sont restés le plus longtemps. Pour 3 éléments importants la Loire pour le transport, le charbon comme combustible et la pierre calcaire qui une fois cuite se transforme en chaux. A travers des arbres on distingue un four à chaux, la tour à une porte centrale et 2 portes latérales, ça ressemble à une tour médiévale. La tour est accolée au coteau que l’on profite pour alimenter la tour par le haut, dans ce genre de tour on pouvait charger 70 mètres cubes de matériaux. Une fois allumé le four pouvait fonctionner plus d’un an, pour entretenir le four il fallait qu’un homme se hisse dans le conduit pour nettoyer la robe. Pour faire cette opération, après l’extinction du feu à l’intérieur de la tour, il fallait attendre 3 mois pour que la pierre se refroidisse de plus de 1000 degrés à une température supportable pour l’homme. La chaux était employée dans l’agriculture, la maçonnerie, le traitement des eaux, la sidérurgie, les entreprises sucrières, les tanneries, les cosmétiques et dans bien d’autres domaines. La rive de la Loire est parfois construite d’épis noyés espacés de 50 mètres chacun, cette technique remonte à 1896 et vu les résultats, elle a été étendue entre 1905 et 1920. Les épis noyés ont été mis en place pour faciliter la navigation sur la Loire, Le Rhône et la Loire sont les 2 grands fleuves navigables français qui ont fait la richesse du pays, la durée de transport entre Nantes et Orléans pouvait varier entre 15 jours et 6 mois, tout dépendait du vent, des inondations, du brouillard, des tempêtes dont les creux peuvent atteindre un mètre et l’eau qui était trop basse. La Loire est un fleuve irrégulier dont la hauteur peut varier, les mouilles qui ont une longueur de près de 8 kilomètres de long où il y a suffisamment d’au sont suivies de bas fonds de 300 mètres de long et ainsi de suite. Parfois les mariniers étaient obligés de décharger leurs bateaux, de passer la partie basse du fleuve puis ils rechargeaient la marchandise pour continuer leur trajet. En 1850 est inaugurée la voie ferrée Nantes Paris, c’est le déclin de la batellerie sur la Loire, malgré les épis noyés qui désensable le lit du fleuve et en 1990 s’en est fini de la navigation en Loire. Les rives du fleuve sont le royaume des castors, on aperçoit des chantiers de castors qui se reconnaissent à l’affluence de branchages au sol. Un castor peut sectionner un saule ou un peuplier de 80 centimètres de diamètre, un castor à la queue plate, il pèse jusqu’à 35 kilogrammes, il a les pattes de derrière palmées et les pattes de devant sont quatre fois plus courtes. Les castors ont été tués pour plusieurs raisons, pour leurs 2 glandes qui produisent le castorium utilisé au moyen âge pour le mal de tête, pour leur chair et leur fourrure, pour leur queue que l’on avait le droit de manger pendant les 150 jours maigres de l’époque. En 1900 le castor avait disparu en France, le castor d’Europe qui ne fabrique pas de barrage fut réintroduit dans les années 1970. Du premier octobre au 15 avril on pratique la pêche la plus dangereuse en Loire, c’est la campagne de l’anguille. La pêche s’effectue avec des bateaux qui mesurent 15 mètres de long pourvus à l’arrière de 2 poteaux de 11 mètres de long qui soutiennent un filet de 25 mètres de longueur qui se termine en entonnoir avec une poche. La poche a un diamètre de 1mètre, une longueur de 8 mètres, elle est conçue avec une maille de 12 millimètres. Ces anguilles vont se reproduire dans le golf du Mexique, elles pèsent environ 1 kilogramme mais elles peuvent atteindre jusqu’à 3 kilogrammes, elles sont âgées de 8 à 18 ans. La relève du filet et des poteaux s’effectue plusieurs fois par jour pendant 4 mois, pour pêcher 20 kilogrammes d’anguilles, on récupère de 5 à 6 tonnes de détritus. Les anguilles sont exportées vers l’Allemagne, la Hollande, le Danemark et la Belgique où elles sont fumées, puis on les importe pour les déguster. Les zones de pêche sont louées par l’état, soient à des pêcheurs professionnels ou à des sociétés de pêche à la ligne. La Loire recense de nombreuses îles aux noms évocateurs Belle Ile, L’île aux Moines, la Corse, l’île Charlemagne etc, on peut acheter une île pour 10000 Euros. La plupart de ces îles sont submergées par l’eau pendant les crues, elles on donc une superficie modulable. En 1999 malgré l’alerte donnée par le préfet les digues et les levées de la Loire ont résisté à la tempête, le fleuve est resté 3 mètres en deçà de la hauteur des digues et levées. Dans son lit mineur la Loire s’étend sur 80 mètres de large, mais pendant les crues le lit majeur peut atteindre 3 à 11 kilomètres de large. Les habitants des îles ne changeraient pour rien leur mode de vie malgré tous les aléas, les îliens sont une sorte de communauté ils sont îliens d’abord puis ils appartiennent à une commune. Nous pouvons admirer un héron cendré qui est un échassier, sa nourriture est faite de poissons, de batraciens, des limaces, des mulots, des escargots et des canetons c’est vraiment un opportuniste. Le projet de la passerelle construite en 1979 existait de puis 1842 année où un budget avait été voté par la commune de Chalonnes. Les îliens ne voulait pas d’un second lien de communication avec la rive, ils ont donc refusé pendant plus d’un siècle la réalisation du projet. Après 2 heures de promenade sur la Loire, nous avons rejoint la Pommeraye pour le déjeuner avec de bons coups de soleil. Nous prenons la direction de Saumur pour se rendre à Trélazé, où se trouve une exploitation d’ardoise. Au cours du trajet Yves notre guide de Montjean-sur-Loire nous lit un poème, qui relate la tragédie des jeunes fusillés du cadre de Saumur lors de la seconde guerre mondiale. Arrivés à Trélazé un ardoisier guide nous accueille pour nous raconter l’univers de l’ardoise, qui est extraite en Anjou dans des carrières à ciel ouvert depuis 1312. L’exploitation de l’ardoise à Trélazé remonte à 1406, deux sortes d’ouvriers travaillent dans une ardoiserie les gars d’en bas ou les mineurs, les gars d’en haut les fendeurs sur butte ou les périlleux qui transformaient les blocs de schiste en ardoise de toiture. Nous passons devant un bloc qui pèse 6 tonnes, qui mesure 3 mètres de long, 2 mètres de large et 40 centimètres d’épaisseur. Ce bloc a été extrait à 500 mètres sous terre, le fendeur exécutait 4 opérations le débitage, le quairnage, le fendage et le rondissage. Le débitage consiste à diviser le bloc dans sa largeur du milieu jusqu’au bout, pour effectuer cette tâche on emploie un bouc ou coin que l’on enfonce à l’aide d’une masse. En tapant un grand coup sec ça se sépare tout droit, on dit que l’on a fait un bouc par contre si la rupture n’était pas droite on disait qu’on avait fait une biquette. Puis avec un coin on façonnait des tranches de 8 à 10 centimètres d’épaisseur, pour débiter un bloc de 6 tonnes un fendeur mettait 3 jours de débitage, pour transformer le bloc en ardoise de toiture il fallait 12 jours de travail. Aujourd’hui avec les machines un bloc est transformé en 3 heures, auparavant de l’extraction à l’ardoise il y avait 70% de déchets, aujourd’hui il y en a 95%, les déchets de l’extraction servent à remblayer le fond de la mine. Un fendeur était un tâcheron, qui devait payer son bloc à débiter, il était rémunéré à la fin de son travail. L’extraction à Trélazé s’effectue à 550 mètres sous la terre, le sous-sol est un vrai gruyère avec plus de 350 kilomètres de galeries. Actuellement, il ne reste plus que 2 sites en activité, une mine traditionnelle qui remonte par un ascenseur des blocs de 6 tonnes, une descenderie dont l’inclinaison est de 13% où s’engouffrent des camions chargés de 35 tonnes de matériau. Depuis la nouvelle technique de la descenderie la mine est redevenue rentable, on produit 20000 tonnes d’ardoise par an ce qui représente 90% de l’ardoise française. Le métier de fendeur s’apprenait à partir de 12 ans, pour devenir un bon fendeur il fallait 5 ans d’apprentissage. A son premier jour d’apprentissage le jeune était intronisé par ses pais par la cérémonie du guétrage : qui consistait à envelopper les jambes de guêtres que l’on arrosait de vin rouge. Lors de cette cérémonie, on donnait un nom de seigneurie au futur fendeur, notre guide a été baptisé Rossignol. Notre guide fendeur effectue devant nous toutes les tâches qui transforment un bloc en ardoise de toiture, il s’est préservé avec des guêtres et de lourds sabots en bois. Pendant sa démonstration nous avons pu toucher les outils qu’il employait bouc, pic moyen, coin, masse, marteau, ciseau d’acier trempé appelé cobra, scie etc. Le reparton obtenu du débitage est placé dans l’eau, afin que le schiste garde son humidité. Le reparton est pris en étau par les sabots en bois de Rossignol, à l’aide d’un ciseau il cherche un espace, puis en tournant son outil il décolle les fendilles qui ont 3 millimètres d’épaisseur. En 1915 a été inventé un étau en bois la presse à fendre pour serrer le reparton afin d’en débiter les fendilles, car pendant la première guerre mondiale ce sont les femmes qui sont devenues fendeuses. Les fendilles sont ensuite découpées sur une machine à crémaillère que l’on règle suivant le type d’ardoise à débiter, il existe 18 modèles différents d’ardoise de toiture. Une ardoise de 5 centimètres d’épaisseur peut supporter une charge de 32 tonnes, une toiture en ardoise de 9 millimètres d’épaisseur pèse 100 kilogrammes au mètre carré, l’ardoise résiste aux différences atmosphériques, autrefois les bacs dans les laboratoires étaient en ardoise qui est inattaquable par les produits chimiques, l’ardoise à une flexibilité proche de celle du cuivre, une toiture en ardoise de 3 millimètres d’épaisseur à une longévité de 500 ans. Le travail de l’ardoise est propice à la silicose, les mines ne sont pas sujettes au coup de grisou et la température à l’intérieur de la mine est de 12 degrés. L’Espagne produit 100000 tonnes d’ardoise par an et la France en produit 20000 tonnes, les principaux sites d’extraction sont l’Irlande, le Pays de Galles, l’Angleterre, la Bretagne, la Normandie, la Galice, le Portugal, le Canada, les Etats-Unis et le Brésil. L’ardoise est de différentes couleurs violine au pays de Galles, vert pâle en Angleterre, de la rouge, de la verte et de l’orange. Ensuite nous avons visionné un documentaire sur la société minière actuelle. Aujourd’hui on emploie des machines à fendre à ventouses pour séparer les fendilles, auxquelles sont adjointes des machines à fendre à commandes numériques qui suppriment totalement l’intervention du fendeur, sauf pour le contrôle et l’orientation des fendilles. A la sortie du sciage les repartons sont triés, les parfaitement parallélépipédiques et les autres. Les seconds sont dirigées vers une machine à fendre semi automatique, les premiers 80% de la fabrication sont amenés un à un et automatiquement vers une machine à fendre à commandes numériques, qui en mesure l’épaisseur, calcule le nombres de fendilles que chacun d’eux contient, fend et dirige les fendilles vers un poste de tri. Après avoir été livrée en charrettes, en péniches pour remonter la Loire, en bateaux depuis le port de Nantes, en trains depuis le milieu du XIX.me siècle les ardoises sont maintenant transportées par camions. L’art dans le métier ou l’habilité des artisans couvreurs, l’ardoise créée à plusieurs centaines de mètres sous terre soit enfin avec le soleil au plus haut de nos toits. Ensuite nous avons parcouru l’espace géologie, l’espace où sont réunis tout le matériel d’exploitation les différents casques de mineurs, les outils du fendeur, la boîte à explosifs. Un troisième espace était consacré à tout ce que l’on pouvait faire avec l’ardoise, des maquettes nous expliquaient les différentes toitures de maisons et de clochetons à savoir que l’ardoise est attachée aux linteaux avec des crochets. Nous pouvons aussi apercevoir des bacs de laboratoire, des éviers et leur égouttoir, de l’ameublement de jardins, des potiches, des lampadaires et de nombreux autres objets de décorations et usuels. Après 2 heures de visite nous avons repris la direction de la Pommeraye, c’est toujours avec un magnifique soleil que nous avons terminé la journée dans le parc où nous étions hébergés. Pour notre dernière journée, nous prenons la direction de Saint-André-de-la-Marche pour aller y visiter le musée consacré à la chaussure. Le musée est installé dans une ancienne usine qui fabriquait des chaussures, le musée est géré par une association d’anciens techniciens et ouvriers de la chaussure. En1956 les Mauges avaient 420 usines qui fabriquaient des chaussures, il n’y avait pas de chômage on faisait venir de la main d’œuvre de la Vendée et des Deux Sèvres. A 14 ans les enfants à l’école avaient déjà 3 à 4 propositions d’emplois, ce qui ne les incitait pas à continuer leurs études. Après la première guerre mondiale les femmes restant souvent veuves, elles étaient tentées d’envoyer leurs enfants à l’usine dès l’âge de 12 ans. A Saint-André la chaussure a commencé à faire son apparition vers 1900, monsieur Maurinière avait l’idée de créer une usine, mais n’ayant pas d’argent c’est le curé de la paroisse qui collecta auprès des paroissiens la somme de 10000 francs de l’époque. Cette usine construite employa plusieurs dizaines de personnes, les premiers bénéfices dégagés ont servi à rembourser les donateurs. En 1919 les affaires allant bon train, Monsieur Morinière a construit une seconde usine dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui qui a fonctionné jusqu’en 1990. Les toits des usines de chaussure sont en dents de scie avec de grandes verrières d’un côté afin d’être au jour pour effectuer les travaux minutieux, l’autre côté étant plein afin de procurer de l’ombre l’après-midi. Dans l’usine chaque personne effectuait toujours la même tâche (découpage, montage, piqûre et le finissage etc.), alors que les artisans effectuaient l’ensemble des tâches. Parmi ces artisans il y avait les sabotiers qui pouvaient être 4 ou bien 5 dans le même bourg, pour fabriquer les sabots ils utilisaient comme outils les paroirs, les vrilles, les langues de chat etc. Le sabotier travaillait sur un banc à trois pieds appelé chèvre, les sabots étaient en bois de aulne et de hêtre, nous avons vu une paire de sabots de contrebandiers et de braconniers qui avaient le talon devant afin de tromper les recherches. Pour que le sabot dure plus longtemps on le cerclait lorsque le bois craquait, puis nous touchons les premières chaussures en cuir dont les brodequins. La semelle du brodequin portait des clous à tête carrée au talon, des clous à tête ronde sur le reste de la semelle. Ces chaussures ont été portées pendant des dizaines d’années dans l’armée et la gendarmerie. Alexis Godilleau, le grand industriel de la chaussure a fourni des centaines de milliers de ces chaussures pendant la première guerre mondiale, depuis on a appelé le brodequin du nom de godilleau. Un godilleau comptait 82 clous, à l’armée on ne badine pas avec le cloutage des semelles, s’il manquait un seul clou le soldat était puni. Les clous des chaussures garnissaient les routes et chemins, ce qui provoquaient la crevaison des pneus de bicyclette. Le raphia a été utilisé pour fabriquer les chaussures, nous sommes en possession d’une forme qui a servi à confectionner une paire de chaussures la plus grande du monde qui avait une pointure de 60. Pour travailler le cuir afin de confectionner une chaussure on utilise plusieurs outils pour couper le cuir, le percer avec des alènes, des outils pour coudre des machines à coudre, des fers à lisse et toutes sortes d’autres d’outils. Beaucoup d’ateliers de sous-traitance étaient liés à la chaussure, les fabriques de rivets, de clous, de lacets dont nous avons aperçu une machine qui date de 1880 qui les confectionnait. Certaines chaussures demandaient jusqu’à 60 opérations, avant de confectionner une chaussure l’ouvrier s’exerçait en fabriquant des pantoufles et des espadrilles. Les Mauges recensées de nombreuses tanneries, une tannerie installée en Bretagne fait du cuir avec du poisson qui est ensuite utilisé en maroquinerie. Entre 1850 et 1925, on a fabriqué pour le dimanche même pour les hommes des bottines en peau de chevreau. Dans les années 1960, on a fabriqué des chaussures à bout très pointues comme les santiags en 1970, d’ailleurs la mode actuelle revient à ce type de chaussures. Les formes pour fabriquer les chaussures sont soit en bois ou en aluminium, le cuir est découpé à plat en plusieurs parties la languette, les flancs, les talons etc. Le patron pour la découpe est en carton recouvert de laiton, le coupeur avec des tranchais découpe le tour du gabarit, la coupure à la nain s’effectue encore aujourd’hui pour les chaussures de grandes tailles et les chaussures de luxe faites sur mesure comme à Limoges par exemple. Le patron en carton a été remplacé par l’emporte pièces en métal coupant que l’on introduit dans une presse, c’est le début de la fabrication à la chaîne. Actuellement les découpes se font au laser ou au jet d’eau par des moyens très sophistiqués. Les morceaux de cuir découpés sont ensuite assemblés, c’est le rôle des piqueuses. Avant l’opération de piquage, le morceau de cuir peut subir d’autres travaux dans la machine à tracer, la machine à parer qui désépaissit les bords afin d’éviter les bourrelets. D’autres opérations peuvent également être effectuées comme le rempliage, qui consiste à plier deux bords émincés l’un sur l’autre.