Ile de France
Séjour en île de France du 18 Au 27 juin 2005.
Le séjour est proposé par le réseau rencontre de Montpellier organisé par madame Granelle, nous sommes 34 personnes dont 8 handicapés visuels qui embarquent dans l’autocar driver par Thierry.
Île-de-France
Région administrative de France (12 008 km2 ; 10 900 000 hab.).
La Région groupe, outre le département de Paris, sa capitale, les trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) et les quatre départements de la grande couronne (Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Yvelines).
Le cadre naturel
L'Île-de-France est dépourvue de limites naturelles et n'épouse pas les contours historiques de la province qui fut jadis le noyau de la future France. La Région est beaucoup plus importante par sa situation et par son poids économique et démographique, que par sa superficie. En 1990, 19 % de la population française était ainsi concentré sur 2,2 % du territoire. Comprenant la capitale du pays, elle occupe le centre du plus grand carrefour des plaines françaises (le Bassin parisien), le principal bassin fluvial du pays et le fond de la cuvette où voisinent les confluents de l'Yonne, de la Marne et de l'Oise avec la Seine. Faiblement accidentée par des alignements de hauteurs anticlinales, parallèles à la direction générale de la Seine, l'Île-de-France est assainie par un anneau de grandes forêts, véritable ceinture verte de
260 000 ha. Ces massifs boisés délimitent autant de petits " pays " très individualisés, où un contraste est également sensible entre les paysages des plateaux limoneux et ceux des vallées plus ou moins encaissées. Bien que le nom d'Île-de-France ne soit apparu qu'au début du XVe siècle, la région était le cœur du domaine royal des Capétiens depuis 887. Aujourd'hui, paradoxalement, la plus ancienne région de France a du mal à trouver son identité. En fait, toute la vie de l'Île-de-France est marquée par l'influence de Paris. 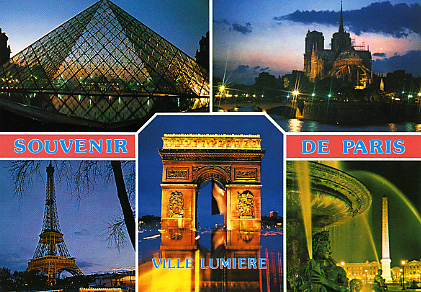 Population et activités économiques
Population et activités économiques
Population
Le pouvoir d'attraction de la capitale est en effet très puissant : elle attire non seulement les provinciaux mais les étrangers (un tiers de ceux qui résident en France habitent la région parisienne). Aujourd'hui, le quart de la population de la Région se concentre dans les départements des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis et plus de 20 % dans la seule capitale. L'urbanisation s'étend considérablement :
Entre 1850 et 1990, la population a été multipliée par 4,5 ; la superficie urbanisée par 65. La grande couronne est celle dont la population augmente le plus aujourd'hui ; la petite couronne progresse légèrement tandis que Paris se vide de ses habitants, nombre de Parisiens allant s'installer en grande couronne (phénomène dit de rurbanisation).
Activités économiques
La répartition des emplois est très particulière. La population agricole ne représente que 0,4 % de la population active, mais les exploitations agricoles représentent encore près de 50 % de la superficie régionale : céréaliculture et betterave à sucre de la Brie, du Mantois, du Hurepoix et des confins de la Beauce ; horticulture (40 % de la main-d'œuvre agricole francilienne) et maraîchage dans les interstitiels de l'urbanisation, dans la vallée de la Seine et sur les plateaux de Saclay et d'Orly.
L'industrie a joué un rôle majeur dans le développement de l'agglomération au XIXe siècle, se déployant le long de l'axe de la basse Seine (Le Havre, Rouen) et de l'axe septentrional (Oise et canal de Saint-Quentin apportant le charbon nécessaire à la production d'énergie), tous deux doublés et triplés par les voies ferrées puis par les autoroutes. C'est ainsi que la quasi-totalité de l'industrie automobile s'est initialement installée à Paris. De manière générale, les industries franciliennes reposent souvent sur la recherche et l'innovation technologiques. Depuis les années 1950, les usines cèdent la place aux sièges sociaux, à la recherche et aux organes de commercialisation ; sur les 25 % d'emplois industriels, la moitié ne participent pas directement à la production.
À ces emplois industriels en " col blanc " s'ajoute l'énorme pourcentage d'emplois tertiaires : secteur public et parapublic de l'État et des collectivités territoriales ( plus d'un million d'emplois), tertiaire marchand (services aux entreprises, commerce de gros et de détail, ingénierie), qui fournit plus de la moitié de l'emploi régional total.
L'Île-de-France bénéficie ainsi d'une tradition de centralité et d'une concentration de moyens, de population et de pouvoir exceptionnels (la Bourse de Paris traite 98 % des transactions françaises).
Ces chiffres ne doivent pas faire oublier l'hétérogénéité de la Région Île-de-France, qui fait en permanence l'objet de plans d'aménagement et de rééquilibrage plus ou moins efficaces. L'espace parisien est largement saturé (problèmes de circulation et d'habitat), ce qui bénéficie à la croissance de la périphérie : la création de villes nouvelles (Marne-la-Vallée, Cergy-Pontoise, Évry, Melun-Sénart Saint-Quentin-en-Yvelines), rendue possible par le développement d'axes de communication (autoroutes A1, A10, A13, A4 ; RER et extension de certaines lignes de métro), a tenté de résoudre ce problème en cherchant à déconcentrer emplois et logements en grande couronne. La réussite est inégale. Des pôles de concentration apparaissent également : la " cité scientifique sud " (Saint-Quentin-en-Yvelines, Gif-sur-Yvette, Orsay, Saclay, Massy) associe recherche, production et enseignement et regroupe 10 000 entreprises ; la Défense, à l'ouest, regroupe 2,5 millions de m2 de bureaux ; à l'est, la ville nouvelle de Marne-la-Vallée a été dotée d'une cité scientifique (la cité Descartes) et accueille le parc de loisirs de Disneyland-Paris. Le parc d'exposition de Villepinte et la zone d'activités Paris-Nord II accueillent de nombreux organes de stockage et de redistribution ; la vallée de la Seine en aval de Paris conserve un rôle de production important.
Problèmes sociaux et environnementaux
La croissance vertigineuse de l'agglomération parisienne s'est toutefois traduite par nombre de problèmes tant sociaux qu'environnementaux. Des quartiers entiers de banlieue, mal conçus et trop vite construits, sont ainsi devenus des lieux de mal vivre et de violence. L'État, associé aux collectivités locales, a envisagé des plans de développement social des quartiers (DSQ). Des quartiers entiers ont par ailleurs été livrés à la démolition (cité des Quatre Mille à La Courneuve).
Par ailleurs, l'agglomération souffre des effets de la pollution (notamment atmosphérique), due pour l'essentiel à la circulation automobile.
Le Livre blanc du Bassin parisien, établi par la DATAR en 1992, insiste sur la nécessité de maintenir ou d'aménager une " trame verte ", constituée d'une ceinture verte à une distance variant entre 10 et 30 km de Paris et d'espaces protégés en Île-de-France ou sur ses marges.
(1) Nous prenons la direction de Paris en passant par le centre, nous gravissons le col de l’escalette puis nous traversons le tunnel de la vierge qui débouche sur le plateau du Larzac. Nous traversons le Tarn à Millau en empruntant le viaduc de Millau, qui a été construit en 3 ans et dont la vie a été programmée pour 120 Ans. Le viaduc est constitué de 30000 tonnes d’acier, il a une longueur de 2500 mètres et relie le massif central à la Méditerranée. La dilatation de l’ensemble est de 1,5 mètre sur toute sa longueur, l’autoroute A75 est l’autoroute la plus haute d’Europe le point culminant dépassant 1300 mètres d’altitude. Nous circulons sur l’autoroute gratuite alors que la traversée du viaduc est payante, nous faisons la pause déjeuner à Issoire où nous en profitons pour aller jeter un petit coup d’œil à son église. Ensuite nous reprenons la route, nous abordons Saint-Amand en Montrond qui est le véritable centre de la France géographique, nous approchons de Orléans où nous allons dîner. Après un bon repas nous effectuons notre dernière étape, qui nous conduit à Versailles, c’est au 12 coups de minuit que nous prenons place à l’hôtel le Versailles situé à proximité de la place d’armes du célèbre château.
(2) Nous prenons la direction du Bourget où se déroule le salon de l’aéronautique, nous passons par Paris que nous contournons par le périphérique, nous sortons à la porte de la Chapelle nous apercevons le fameux stade de France. Le clou du salon est le plus gros avion du monde qui est au stade des essais le A380, c’est aussi le lieu de mémoire des frères Montgolfier, des pionniers de l’aviation Blériot, Mermoz, Garros, Saint-Exupéry, etc. Le musée de l’aviation retrace l’apparition de l’armée de l’air dans les guerres mondiales de 14-18 et 39-45, la fabuleuse aventure de la Caravelle, le premier homme dans l’espace 1961 Youri Gagarine sans oublier la petite chienne Laïka qui l’avait précédé. Comment oublier le premier pas sur la lune en 1969 de Neil Armstrong et de l’équipage de la fusée Apollo, le splendide Concorde est son pilote d’essai Turka à savoir que 16 Concordes ont été construits dans le monde. Après un gigantesque embouteillage et une cohue indescriptible nous sommes enfin arrivés à prendre place dans un petit train qui nous fait découvrir le salon. Nous passons devant le musée de l’aviation, les fusées Ariane, les avions de l’armée de l’air française et italienne, les Airbus 380, 340 et 318. Nous pouvons admirer l’avion Tahiti qui est décoré de fleurs, nous roulons au milieu d’avions russes avant de circuler dans un champ de fusées. Nous passons devant les avions mirages Dassault, maintenant nous pénétrons dans l’espace des hélicoptères qui sont de toutes les couleurs, puis nous apercevons l’avion Rafale de chez Dassault, les avions Falcone ne sont guère loin des avions militaires. Nous contournons le hangar du ministère de la Défense, après un circuit de 45 minutes nous reprenons place dans notre autocar pour aller déjeuner dans un restaurant situé en bout des pistes de l’aéroport du Bourget. L’aviation a débuté au XVIII.me siècle avec les frères Montgolfier, la fin du XIX.me siècle a vu la naissance du premier avion, en 1930 a été construit le Zepling qui a été abandonné après le drame de 1937 qui est la première grande catastrophe de l’aviation civile. Après le repas nous avons assisté à une représentation des avions en vol depuis le restaurant, ensuite nous avons pris la direction de Poissy pour aller visiter la villa Savoye. Cette villa a été construite par le Corbusier en 1928, elle lui avait été commandée par monsieur et madame Savoye qui étaient les propriétaires d’une grande société d’assurance qui existe toujours. Le cadre a tout de suite plu au jeune architecte le Corbusier âgé de 40 ans, nous sommes sur une colline qui auparavant dominait la Seine. Très riche les Savoye avaient tous loisirs à se faire construire une villa dont toutes les règles de l’urbanisme ne leur étaient pas imposées. C’est seulement au cinquième projet que le Corbusier a conquis ses commanditaires, les travaux ont commencé en 1929 pour se terminer en 1931. Le Corbusier a donc composé avec l’influence de la nature, de la campagne, de la lumière, du soleil pour faire l’habitat d’un jeune couple est d’un adolescent. Cette villa est la maison secondaire des Savoye, elle est donc consacrée aux réceptions, nous pénétrons dans le salon de réception. Auparavant depuis le salon on pouvait admirer la vallée de la Seine, en 1960 on a construit un collège qui a pris 6 hectares des 7 hectares de la propriété. La villa devait être rasée, un collectif s’est créé afin de la sauvegarder, c’est André Malraux ministre de la culture à cette époque qui a classé la villa Savoye comme monument architectural. Pour cacher les terrains de sports et les clôtures du collège, on a planté des arbres qui aujourd’hui cachent la perspective de la vallée de la Seine. Les murs sont en béton armé percé de bandeaux qui éclairent l’intérieur, les cloisons sont en verre ce qui donne au salon situé au nord de la villa une parfaite luminosité. Une terrasse fait office de jardin suspendu ornée de bacs à fleurs qui dominent la campagne. Le Corbusier est l’un des précurseurs de l’architecture en béton armé, dont la cité de la radieuse ou du (fada) à Marseille. Nous montons à l’étage par une rampe qui est la colonne vertébrale de la villa, elle nous amène à un solarium. La rampe était l’accès des maîtres, alors que la cage d’escalier était réservée aux services. Le Corvusier voulait donner du mouvement dans l’architecture d’où la prépondérance de la rampe d’accès dans la villa, nous rentrons dans une chambre dont le parquet est d’origine, la salle de bains se trouve dans la chambre sans aucune cloison c’est très avant-gardiste pour l’époque. Les murs sont agencés de rangements intégrés, Le Corbusier s’est régalé pour réaliser cette construction de maîtres, son rêve c’est d’avoir construit la cité radieuse tout de suite après guerre après le bombardement du vieux port à Marseille. Il voulait donner aux habitants du quartier un environnement futuriste. Hélas aujourd’hui la cité radieuse est la propriété de docteurs, de professions libérales mais le succès de l’ensemble à évincer la population de l’ancien quartier. Malheureusement ses successeurs n’ont pas eu sa réussite, ils ont utilisé le béton armé pour faire de l’habitat social qui ressemble plus à de la cage à lapins où beaucoup ont le mal d’y vivre.
Enfin nous reprenons place dans notre autocar pour descendre dans la vallée de la Seine à Conflans sainte Honorine, nous embarquons à bord d’un bateau pour naviguer sur la Seine. Nous passons devant la zone bateaux logement créée en 1993, les anciens mariniers déboursent 45 euros par mois pour bénéficier du droit de s’ammarrer tandis que les autres habitants doivent s’acquitter de 140 euros de mensualité. Nous abordons un village de retraités de la batellerie, les bateaux sont retirés de l’eau chaque 6 ans afin de consolider et repeindre leurs coques. Nous pouvons admirer une forêt qui a été plantée de 3125 arbres d’essences différentes, nous passons devant un château construit en 1850, qui est aujourd’hui le musée de la batellerie. Auparavant la ville de Conflans était un village de pêcheurs et de paysans, un remorqueur datant de 1904 est amarré en bord de Seine, nous apercevons également un remorqueur de 1950 de la famille des tritons qui est aussi destiné à la visite du musée. Nous pouvons voir une tour datant du XIII.me siècle dans laquelle a été cachés les restes de la vierge Sainte Honorine, qui a donné son nom à la ville de Conflans. Toutes les berges de la Seine sont équipées de bites d’amarrage, le transport fluvial est le transport le plus économique et écologique. Tout au long de notre promenade nous admirons une multitude de bateaux de couleurs différentes sont décorés avec goût, nous passons devant un chantier naval qui depuis la loi de 1990 s’occupe aussi de la destruction de bateaux. Nous arrivons au confluent avec l’Oise, nous croisons une barge de transport qui peut être soit tractée ou poussée par un remorqueur. Nous abordons une petite île qui est le paradis des grues des poules d’eau, des oies, des hérons etc, l’île est plantée d’une forêt nous pouvons la visiter à pieds. Nous arrivons au port de plaisance de Andrésy, un bon nombre de pêcheurs s’adonnent à leur passion, ils retirent le poisson de l’eau, le mesure et le remette à l’eau. En 1936 une base nautique a vu le jour à cet endroit, en 1950 toutes les activités nautiques ont été supprimées. Tous les bateaux sans exception doivent porter un nom, ainsi que sa longueur, sa largeur et son tonnage. Auparavant les bateaux étaient tirés par des chevaux d’où la nécessité des chemins de halage, dans l’approche des ports se sont même des hommes qui faisaient office de tracteurs ce labeur s’appelait le halage à la bricole. Beaucoup de péniches sont transformées en bateaux restaurants, au temps de la gloire de la batellerie il existait des bateaux alimentation ou épicerie fluviale. Nous passons devant l’ancienne bourse d’affrètements, elle est bâtie sur pilotis, elle a été supprimée le premier janvier 2000. Nous apercevons de nombreuses guinguettes en bord de Seine, les enfants des mariniers poursuivaient leur scolarité en internat. Pendant leurs études ils apprenaient leur futur métier la navigation, nous passons sous la passerelle Saint-Nicolas qui est le patron des mariniers. A conflans Sainte-Honorine se trouvent un bateau chapelle, un bateau pompier et un bateau de la gendarmerie. Après 45 minutes de navigation nous avons débarqué sur la terre ferme, en autocar nous avons rejoint Versailles pour le dîner et un repos bien mérité.
(3) Nous prenons la route pour la forêt de Fontainebleau, qui est la forêt privilégiée des rois pour la chasse. Fontainebleau a toujours été le terrain d’entraînement de la cavalerie puis des militaires par la suite, la ville de Fontainebleau a été construite pour répondre à l’hébergement de l’escorte royale. Fontainebleau est devenu très vite l’endroit favori de la chasse, François I, Henri IV, Louis XIV et Napoléon I chacun transforme et agrandit le château. La formation de la forêt de Fontainebleau remonte à des milliers d’années, qui s’étend aujourd’hui sur 25000 hectares. Des grottes, des roches, du sable et du calcaire constitue la forêt tout à fait unique en France. Dans cette forêt vivent plus de 6500 espèces d’animaux, cette faune ne fait pas trop de bruit mais nous pouvons en apercevoir lors de promenades forestières. Le domaine de Fontainebleau forme un foyer artistique original et unique, qui a vu défiler 14 souverains. Les jardins et parc ont été dessinés par le Notre, le domaine est au cœur de la ville de Fontainebleau qui mérite une visite. Aujourd’hui la forêt est parcourue par les passionnés d’équitation, l’école spéciale militaire qui est devenue Saint-Cyr était installée à Fontainebleau. Le centre Europe de l’OTAN a été basé à Fontainebleau de 1947 à 1967, ce qui donna à la ville un visage Cosmopolite. La région de Fontainebleau est le paradis des escaladeurs, des randonneurs et des cavaliers de l’île de France. Nous passons à Milly la Forêt ville de Jean Cocteau, la menthe poivrée est la plante emblématique de la forêt, nous traversons Danmarie-les-Lys.Arrivés au domaine du château de Fontainebleau nous parcourons les jardins composés de pelouses, de bosquets et de bassins d’eau. Nous commençons la visite du palais qui a été érigé au XVI.me siècle pour les chasses à court, il a été commandité par François I. Déjà au moyen âge le roi Saint-Louis venait chasser à Fontainebleau, nous découvrons un tableau représentant Louis XIV lors d’une chasse à cour. Louis XIV aimait beaucoup vivre à Versailles, mais il préférait venir chasser à fontainebleau. Napoléon I a accueilli le pape avant son couronnement comme empereur, lors de la cérémonie officielle à notre dame de Paris, c’est lui-même Napoléon qui a posé la couronne sur sa tête. Napoléon a vécu à Fontainebleau avec l’impératrice Joséphine et l’impératrice Marie-Louise, nous sommes dans la galerie des assiettes témoigne de l’art italien. Les assiettes sont directement encastrées dans les murs, C’est François I qui a fait entrer l’art italien de la renaissance à Fontainebleau, à remarquer que tous les autres souverains successifs vont continuer cette tradition. Certaines assiettes représentent la forêt de Fontainebleau, l’origine de Fontainebleau provient de la contraction du nom de la fontaine qui appartenait à Monsieur Bléot. Nous pénétrons dans la galerie François I, qui témoigne en France du style renaissance apporté par les artistes italiens, nous pouvons admirer le magnifique escalier en fer à cheval qui est l’accès principal du palais. C’est d’ailleurs depuis cet escalier que Napoléon I a fait ses adieux à ses troupes en 1814 avant de partir en exil à l’île d’Elbe. Nous sommes dans la galerie François i, qui venait d’essuyer son échec de Pavie en 1525 après sa victoire de Marignan en 1515. Pour rebondir de la défaite il a décidé de construire ce palais, dans la galerie François I 2 fresques représentent les symboles de la monarchie française. Le F pour François i, la salamandre animal qui peut traverser le feu qui symbolise le pouvoir de François I, des casques militaires pour l’esprit de conquérant, des éléphants pour la sagesse royale, la représentation de François I habillé tel un empereur. Le stuc est très présent dans cette galerie, François I était tellement fier de sa galerie qu’il était le seul à en avoir la clé, elle mesure 60 mètres de long pour 6 mètres de large. Sa chambre était à proximité de sa galerie, François I est représenté dans un tableau où nous pouvons voir sa corpulence imposante, il mesurait 1,93 mètres. François I avait fait venir Léonard de Vinci dans son château d’Amboise, il décéda tout près du château de Fontainebleau qu’il n’a jamais vu terminer, Léonard de Vinci était pensionné de François I qui a d’ailleurs acquis la fameuse Joconde aujourd’hui exposée au musée du Louvre. Depuis la galerie nous découvrons les parcs et bassins du palais, des chandelles éclairaient le palais qui était chauffé par de nombreuses cheminées dont le bois de chauffage provenait de la forêt toute proche. François I est devenu roi à l’âge de 20 ans, il était soutenu par sa mère Louise de Savoie et par sa sœur Margueritte de Navarre. François I a fait entrer les dames à la cour, il était très galant, sa maîtresse vivait à Fontainebleau. Nous circulons dans la salle des gardes, le parquet a été posé sous Louis Philippe réalisé en bois précieux acajou, citronniers etc des motifs décorent le parquet en harmonie avec les motifs du plafond. Le plafond est de style à la Française avec des poutres à solive, au-dessus d’une cheminée nous apercevons le portrait de Henri IV un des créateurs du palais qui s’était attaché des services d’artistes français et flamands formés à l’art italien. Nous pénétrons dans la salle de bal où l’on donnait des concerts, les musiciens étaient installés sur une estrade, la couleur dominante de cette salle est le brun orné à la feuille d’or. La salle comprend des arcades car auparavant c’était une loggia, les fleurs de lys sont très présentes qui répondent à la présence des rois de France. Henri II a achevé la salle de bal afin d’attirer la cour, lui aussi a fait appel aux artistes italiens. Les fresques sont de couleurs vertes et rouges, deux fresques représentent la présence de Diane de Poitiers la maîtresse du roi Henri II. La dernière cérémonie qui a eu lieu dans cette salle de bal a été pour honorer les ambassadeurs de Siam actuellement Thaïlande par Napoléon III et l’impératrice Eugénie, qui ont été les derniers souverains à habiter le palais. Nous déambulons dans une salle où 3 lettres sont entrelacées le D de Diane, le H de Henri II et le C de Catherine de Médicis la femme légitime du roi. A la mort de Henri II lors d’un tournoi Catherine de Médicis va échanger son château de Chaumont-sur-Loire, contre, le magnifique château de Chenonceaux que Diane de Poitiers possédait. Cette salle est très lumineuse, elle mesure 30 mètres sur 12 elle est superbement décorée. Nous découvrons la chambre de la maîtresse de François I, qui est décorée de figures très longilignes. Cette chambre a été transformée par Louis XV afin d’y installé un escalier, Louis XV n’hésitait pas à remanier le palais pour montrer sa présence. Nous nous dirigeons vers le donjon Saint-Louis, qui est un vestige de l’ancienne forteresse, qui était construite au moyen âge, c’est Henri IV qui a fait décoré le donjon. Une cheminée en marbre est surmontée par la statue équestre de Henri IV, puis nous pénétrons dans la chambre où naquit le fils de Henri IV et de Marie de Médicis, le futur Louis XIII. La reine devait accoucher en public, car la cour devait s’assurer que le futur roi de France était bien légitimé de la reine. Nous traversons le salon de conseil des rois décoré sous Henri IV, puis nous pénétrons dans la chambre des reines de France qui a été occupée de Margueritte de France l’épouse de Saint-Louis jusqu’à Marie de Médicis épouse de Henri IV. C’est une grande pièce où est installée une cheminée renaissance, le stuc et des fresques décorent la chambre. La chambre du roi était située entre la chambre de la reine et celle de sa maîtresse, les murs de la chambre de la reine sont recouverts de tapisseries des gobelins afin de préserver du froid. La chambre de la reine est meublée de mobilier du XVII, XVIII et XIX.me siècle nous pouvons y remarquer des canapés, des fauteuils, des secrétaires et des cabinets tous en bois précieux comme l’ébène. Ensuite nous pénétrons dans une immense galerie de réception depuis laquelle nous découvrons le jardin de Diane, elle a été construite sous Henri IV qui était jaloux de la galerie de François I. Elle est donc plus vaste, elle mesure 80 mètres de long et 7 mètres de large. Nous ne pouvons pas y circuler, car la galerie a été transformée en bibliothèque par Napoléon III, qui renferme des ouvrages d’origine ayant appartenu à Napoléon I et Napoléon III, la bibliothèque contient 16000 ouvrages. Nous arrivons dans la partie occupée par Napoléon I, tout d’abord nous traversons le petit appartement occupé par les dames qui longe le jardin de Diane. Napoléon entre ses campagnes n’a résidé que 170 jours à Fontainebleau où il a vécu des moments tragiques mais également des joies comme la naissance de son fils le futur roi de Rome dont la mère était Marie Louise. Les dames aimaient ce petit appartement décoré avec beaucoup de finesse, l’impératrice Joséphine, l’impératrice Marie-Louise, la reine Marie-Adélie la femme de Louis Philippe et l’impératrice Eugénie ont apprécié cet endroit. La reine Marie Antoinette a beaucoup séjourné dans cette chambre, elle délaissait Versailles et ses fastes pour venir se ressourcer le week end à Fontainebleau. Les dames recevaient dans cet appartement où elles offraient des collations et s’adonnaient aux jeux, la décoration est réalisée avec des tapisseries tissées avec de la soie. Nous traversons la salle du trône où Napoléon I donnait ses ordres à ses ministres, le mobilier est d’époque dont le trône de l’empereur. Le trône est décoré d’abeilles, le symbole qui caractérise le courage, la famille et le travail. Un lustre immense est suspendu au plafond de cette salle impériale, Napoléon était très respectueux de la décoration des anciens hôtes du palais. Il a conservé dans la salle du trône le plafond de la chambre qu’occupait auparavant Louis XIII, le portrait de Louis XIII décore la salle du trône. Nous déambulons dans l’appartement de Napoléon I, son bureau de travail puis sa chambre. Son lit était très petit car il dormait assis, Napoléon I dormait 5 heures par nuit, la nuit il se promenait dans le jardin de Diane avant de se mettre au travail. Dans son cabinet de travail se trouve un lit de camp pour faire la sieste entre 2 réunions de travail, des fauteuils pommier avec des petits bancs afin qu’il puisse étendre les jambes tout en étant devant la cheminée. Nous nous arrêtons dans le salon particulier de l’empereur qui est décoré de couleur flamboyante pourpre et rouge, au milieu du salon se trouve un guéridon sur lequel selon la tradition Napoléon I aurait signé son acte d’abdication. L’acte sera signé le 6 avril 1814, il tente de se donner la mort à Fontainebleau dans la nuit du 11 au 12 avril, il part en exil à l’île d’Elbe le 20 avril 1814. De retour de l’île d’Elbe ce sont les 100jours, il est vaincu à Waterloo, ensuite il est exilé définitivement par les anglais à Sainte-Hélène où il décède en 1821. Napoléon a marqué son séjour à Fontainebleau, il avait des goûts moins luxueux que ses prédécesseurs, nous pouvons d’ailleurs voir sa modeste salle de bains. Napoléon déjeuner en 10 minutes, il était friand de veau Marengo pour sa victoire sur les autrichiens, le parmesan dont il parsemait ses macaronis et le Gevrey Chambertin. Enfin nous prenons un escalier qui nous conduit à la chapelle de la Trinité, une musique d’ambiance nous accueille. Aujourd’hui la chapelle est le lieu où se donnent des concerts, le culte n’est dispensé que le jour de la fête de la Trinité. L’orgue du XVIII.me siècle se trouve derrière l’autel, c’est l’époque où le petit roi de France, Louis XV 15 ans va épouser une duchesse polonaise, fille du roi de Pologne. Le mariage sera célébré dans cette chapelle en 1725, Louis Philippe va également marier son fils aîné dans cette chapelle en 1837. Napoléon III sera quant à lui baptisé dans ce lieu, la chapelle de la trinité remonte à l’époque de Saint-Louis. Sous Saint-Louis les moines de l’ordre de la trinité étaient présents au monastère établi à cet endroit, qui est devenu ensuite une chapelle. La chapelle a été décorée à plusieurs époques successives, le gigantisme de la voûte a été peint par un artiste français Martin Tréminet qui avait étudié son art à Rome. Les souverains s’installaient dans la tribune royale, qui était accessible depuis les appartements que nous avons visités précédemment, ils dominaient la cour et se trouvaient par la même plus près de Dieu. De part et d’autre de l’autel se trouvent des balcons, où étaient installés les musiciens. L’autel du XVII.me siècle est en marbre, deux tableaux représentent la Trinité, deux statues sont placées de chaque côté de l’autel. L’une représente Charlemagne avec les traits de Henri IV premier empereur de l’occident, l’autre représente Saint-Louis avec le visage de Louis XIII. Bien sûr Henri IV et Louis XIII ont marqué Fontainebleau, mais, les souverains les plus importants restent François I et Napoléon I. Aujourd’hui Fontainebleau fête la Saint-Louis mais pas la révolution française, Fontainebleau est dans un écrin de verdure voué à la musique et à l’art Italien.
Après le repas au château de Vaux-le-Vicomte, nous visitons le château de Fouquet, qui a été emprisonné par Louis XIV par jalousie de son ascension et par le mépris de Colbert. Nicolas Fouquet est né à Paris en 1615, il descend d’une lignée de riches magistrats. L’emblème des Fouquet est un écureuil, leur devise est « jusqu’où ne monteraient-ils pas ». Nicolas Fouquet les incarne par sa fulgurante réussite sociale et financière. A l’âge de 35 ans il devient procureur général du parlement de Paris, première cour de justice du pays. Il est aussi un investisseur avisé qui fait fructifier ses entreprises financières maritimes et coloniales. Fidèle à la monarchie, son art de vivre, son rôle de mécène des arts et lettres, sa force de misanthrope font de lui un homme d’exception. En 1743 le cardinal Mazarin Premier ministre du jeune roi Louis XIV et de sa mère la régente Anne d’Autriche, nomme Fouquet surintendant des finances. Il doit rétablir la confiance des épargnants et de mettre à terme la faillite de l’état. En 1655 Fouquet décide d’édifier une demeure digne de son prestige, il choisit Vaux-le-Vicomte. Nous sommes dans la chambre de Fouquet, que le superintendant du roi a prodigieusement décoré. Cette ornementation reflète les choix esthétiques du maître de maison, les beautés sont propices à lui faire oublier les calomnies de Colbert. Il les néglige, estimant que sa fidélité et son dévouement à la couronne sont ses meilleures protections. Ne vient-il pas d’avancer au roi une somme considérable, celle qu’il a retirée de la vente de sa charge de procureur du roi. Cet acte le prive désormais de l’immunité judiciaire attachée à cette charge, Louis XIV a voulu retourner à Vaux pour pouvoir y admirer les derniers embellissements. Le roi n’a pas apprécié le tonnerre d’applaudissements adressé à Fouquet pour l’inauguration de son château, Louis XIV n’acceptait les honneurs ou félicitations qu’à son honneur. C’est à Vaux que le jeune Louis XIV âgé de 22 ans est né dans son esprit, le projet de Versailles qu’il confiera à l’équipe de Fouquet. Fouquet ne savait pas que depuis la mort de Mazarin le 3 mars 1661, le roi et Colbert avaient monté un complot contre lui pour cette fête, qui s’est déroulée le août 1661. A 2 heures du matin Nicolas Fouquet rejoint sa chambre comblé de bonheur, la soirée a été merveilleuse, il s’endort serein sans se douter que son arrestation soit imminente. Un stratagème est mis en place pour éloigner Fouquet du milieu parisien, le roi se rend en Bretagne où il convoque les ministres et la cour. C’est à Nantes le 5 septembre 1661, que Fouquet est arrêté par le célèbre D’Artagnan, une escorte conduit à Paris le superintendant immédiatement jeté à la Bastille. Un tribunal de 23 juges, tous choisis par Colbert pour leur hostilité à Fouquet est chargé de mener le procès du grand argentier, Le procès durera 3 ans, Colbert escamote des pièces en falsifie d’autres, prive Fouquet de défenseur et tente même de subordonner des juges qui ne se laissent pas tous impressionner. L’un d’eux D’Ormesson déclare « la cour rend des arrêts, non des»services » Fouquet se défend lui-même, le verdict sera clément. Fouquet est condamné au bannissement donc libre, à condition de quitter la France pour toujours. Le roi bafoué par cette sentence utilise son droit souverain pour aggraver le châtiment, au nom de secret d’état qu’il aurait connaissance, Fouquet est emprisonné à vie, il moura en prison en 1680. La deuxième femme de Fouquet est issue d’une famille de parlementaires, elle lui a donné 4 enfants. Après la sentence elle est exilée, elle fait preuve d’un courage et d’une fermeté admirable, après 10 ans d’éloignement elle peut revenir à Vaux. Secondée par son fils aîné le comte de vaux, ce n’est qu’après 15 ans d’emprisonnement que le roi laisse Madeleine Fouquet rendre visite à son mari. Les enfants seront mis à l’écart de la cour jusqu’à la mort de Louis XIV, le comte de Vaux meurt en 1705 sans postérité. Sa mère décide de vendre la propriété au plus glorieux chef militaire du temps le maréchal de Villard, nous sommes dans la chambre de madame Fouquet dont le mobilier est celui qui l’a entourée. Nous continuons la visite du château, nous apercevons le portrait de César de Coizeule duc de pralat qui a acheté Vaux en 1764, il était ministre des affaires étrangères et ministre de la marine un peu plus tard. Si les Villard ont conservé l’architecture intérieure de Levau, le duc de Pralat va demander à son architecte Berthier de moderniser le premier étage. Les pièces sont alors divisées, les sols de pierre et de carrelage sont remplacés par du parquet ce qui nécessite moins de chauffage. Les Choiseul étaient très près de la population, c’est pour cela que le château a été épargné pendant la révolution, en 1793 on ordonna le départ de la propriété pour la destruction. La comtesse de Pralat bien conseillée demande un délai et sollicite la commission des arts, celle-ci recommandera la conservation du château. Vaux reste la propriété des Choiseul Pralat jusqu’en 1875, mais ils n’y séjourneront plus guère après le drame de 1847. Cette année là le cinquième duc assassine son épouse, fille du maréchal Sébastiani puis il met fin à ses jours. Alfred Sommier un riche industriel de raffinerie de sucre a racheté le château à la fin du XIX.Me siècle, il consacre une grande partie de son temps et de ses efforts à la résurrection de Vaux. Il est assisté par l’un des meilleurs architectes de l’époque Hyppolite Détailleur. Les plus importants travaux du château concernent les toitures et les plafonds du rez-de-chaussée. Les poutres vermoulues sont remplacées par des charpentes métalliques, certains gros murs intérieurs seront reconstruits de la cave au grenier. Les communs complètement tombés en ruine sont rebâtis, Alfred Sommier remeuble le château dans le goût du XVII.me siècle car les pralat n’ont laissé 2 tables, quelques tableaux, des statues et un corps de bibliothèque. La restauration du château malgré la tâche ne durera que 25 ans, à sa mort en 1925 Alfred Sommier à effacer 2 siècles de dégradation. Vaux a retrouvé sa splendeur, Aimé sommier le fils d’Alfred sommier aidé par sa remarquable épouse achèveront la réfection des jardins et complèteront les intérieurs. En 1965 grâce au petit fils d’Alfred Sommier le domaine sera épargné par le tracé d’une autoroute qui devait le couper en deux, depuis le domaine est classé au titre des monuments historiques. Nous sommes passés dans la rotonde salle de réception dont le plafond n’a jamais été terminé, Puis nous avons descendu un escalier qui nous a conduit dans de superbes caves voûtées où se reposaient de nombreux tonneaux de vin. Ensuite nous avons parcouru le domaine en voiturettes électriques, nous avons roulé au milieu de jardins, de bosquets, de bassins d’eau, de grottes tout en gravissant des petites collines et en longeant des canaux. Pour finir notre visite nous avons parcouru le musée des équipages voué au cheval où sont exposées toutes sortes de carrosses, de charrettes, de voitures, et tout ce qui concerne le harnachement du cheval. Tout poussiéreux nous avons pris la direction de Barbizon pour y aller dîner, Barbizon est situé entre la forêt de fontainebleau et la plaine de la Brie. Le bourg n’est qu’une longue rue d’anciens ateliers transformés en musées, de galeries d’art et de restaurants. Barbizon compte 1500 habitants, les peintres Millet et Rousseau étaient liés par une grande amitié, les 2 peintres reposent côte à côte presque sur le même rocher. Les écrivains suivent les peintres est Barbizon devient à la mode, nous apercevons des clairières où les peintres postimpressionnistes venaient s’installer pour peindre la nature. Pour la petite histoire aujourd’hui Barbizon peut s’enorgueillir de compter 4 députés de l’île de France qui résident dans la commune, sans oublier la mère de Mazarine si cher à François Mitterrand.
(4) Nous prenons la direction de Saint-Germain en Laye pour se rendre à la maison Monte Christo construite par Alexandre Dumas père, la villa se trouve dans la côte de Monte Christo qui conduit de Marly-le-Roi à la vallée de la Seine. Alexandre Dumas conquis par cette colline a eu l’idée de construire un château renaissance, il a fait appelle à l’architecte Hyppolite Durand. Il lui commanda un petit château qu’il appellera Monte Christo, un pavillon dit le château d’If pour s’isoler afin de créer son œuvre, un parc parsemé de jardins, de bosquets, de cascades, de grottes et d’une porte d’accès. Pour accéder à la propriété nous passons sous une arche construite en forme de grotte, nous nous dirigeons vers le pavillon (château d’If, sur lequel il fera graver dans la pierres ses 500 titres de volumes dont le fameux (les trois mousquetaires). En fait se sont 98 titres qui sont réellement gravés aujourd’hui, le nom de la propriété château de Monte Christo a été donné par une de ses amies. Madame Mélin femme d’un comédien qui venait lui rendre visite, arrivé en train à Marly-le-Roi, elle dit au cocher « chez monsieur Dumas ». Le cocher ne connaissait pas, il demanda une adresse, la femme lui dit « mais le château de Monte Christo » le cocher conduit alors sa cliente chez Alexandre Dumas. Arrivée madame Mélin raconta Dumas son histoire, il trouva que c’était une bonne idée, il baptisa le château d’en bas le château de Monte Christo et le petit château est devenu le château d’If. L’île de Monte Christo est située au large de la Corse, ses visiteurs pour le saluer venaient au château d’If qui était son bureau de travail. Son bureau était constitué d’une planche posée sur 2 tréteaux, il écrivait tout le temps, par conséquent il passait la plupart de son temps ici. Comme il entreprenait tout en même temps, il avait décidé pour ne pas se tromper d’écrire les pièces de théâtre sur des feuilles jaunes, des feuilles bleus pour les romans et les feuilles roses pour tout le reste. Il avait un fichier de tous ses personnages de romans afin de ne pas les faire agir quand ils sont morts, quoiqu’il arrivait à ressusciter des personnages tués lors de complot. Dumas écrivait de la main droite, il saluait de la main gauche, la maison était toujours envahie d’amis, d’amis des amis, de parasites c’était la vie de Bohème. Dumas a beaucoup gagné d’argent avec ses romans, mais, il a beaucoup dépensé. On l’appelait panier percé, à quoi il répondait « oui mais ce n’est pas moi qui ait fait tous les trous ». Depuis le château d’If nous apercevons en contre bas le château de Monte Christo, Deux tours terminées par de petits clochetons entourent l’escalier d’accès, sur les tours nous pouvons distinguer un petit rond dans lequel est inscrit (A suivi de 2 D. Ces lettres signifient soit Alexandre Dumas suivi du D car son grand-père était Davy de la Paterie ou alors D comme Dumas fils qui commençait à être connu. Nous descendons la pente pour accéder au château de Monte Christo, Davy de la Patrie était un noble pas très riche qui vivait en Normandie. Il décide de faire fortune en achetant une plantation à Saint-Domingue, il fait travailler les gens pour cultiver le coton et le tabac. Davy de la Paterie va rencontrer une jeune esclave noire qui s’appelle Marie Cécette avec laquelle, il va avoir une liaison et plusieurs enfants. Un des enfants thomas Dumas âgé de 15 ans qu’il aimait bien, il le ramène en France après le passage d’un ouragan et la mort de Marie Cécette. Thomas Dumas était donc métisse, il voulait rentrer dans les dragons de la reine. Son père davy de la Paterie lui dit, je veux bien que tu sois soldat, mais, sous le nom de Dumas car Marie Cécette appartenait au maître, elle était de la maison du maître Dumas. Thomas de la Paterie est dons rentré dans les dragons sous le nom de thomas Dumas, il va épouser une française. Ce qui fait que Alexandre Dumas fils de Thomas Dumas est quarteron, il avait le teint basané, les cheveux crépus et les yeux bleus. Alexandre Dumas étant jeune était très mince et séducteur, il était très gentil, il avait une collection de maîtresses qu’il abandonne sans se fâcher avec des mots d’amour adorables. Nous commençons la visite par une salle qui recense les portraits de ses ancêtres, nous apercevons thomas Dumas qui est devenu général, il va épouser sa femme en 1792 à Villers coteret. Ils vont avoir une fille Marie Alexandrine en 1793, notre illustre personnage va naître en 1802. Thomas Dumas suite à ses campagnes militaires va décéder en 1806, madame Dumas est donc obligée de tenir un café pour subvenir à ses dépenses. Alexandre Dumas ne poursuivra pas d’études, à l’âge de 14 ans il entre chez un notaire pour exercer le métier de saute ruisseaux ou coursier. Pendant ses courses il chasse car c’est un très bon chasseur, ce qui remplit la marmite de la famille Dumas. Un peu plus tard il va à Paris rencontré un comédien nommé talmat, qui avait rénové la façon de parler. Dumas lui dit qu’il voulait être poète, talmat le baptisa poète au nom de Corneille, Dumas embrassa tout de suite son nouveau métier. Il demande à sa mère le peu d’argent qu’il lui reste, il vend son chien, il vent de petits objets pour payer l’aller simple à Paris. Il va jouer une partie de billard avec le cocher, qu’il gagne ce qui fait qu’il a le voyage gratuit. Pour payer l’auberge il chasse pour ramener du gibier le soir, il est très débrouillard. Il a à peine 20 ans, il ne connaît encore personne, mais, un ami de son père le général font l’introduit comme secrétaire chez le duc d’Orléans. Il s’ennuyait quelque peu il décide donc de fréquenter le théâtre, sa chance il rencontre Charles Nodier qui est bibliothécaire de l’arsenal. Il invite Dumas dans son salon où se côtoient Hugo, Chateaubriand, Musset, Lamartine, George Sende etc, il rencontre tous ces personnages, en plus il est protégé par une charmante dame femme d’un officier dont il aura une liaison. Très cultivée sa protectrice va le présenter dans les salons mondains où elle va l’éduquer, car si il savait chasser et lire étant fils de militaire et sa mère n’ayant pas d’argent Alexandre Dumas était un peu rude. Il s’est marié en 1840 avec la mère de Alexandre Dumas fils, ils ont divorcé en 1844 lassée qu’elle était des liaisons de son mari. Un acte notarié permettait au Dumas de prendre le titre de marquis de la Paterie, ce qu’ils n’ont jamais fait, mais, la femme de Alexandre Dumas a pris le titre après son divorce où elle s’en est allée vivre en Italie. Aujourd’hui il n’y a plus de descendance de la famille Dumas, nous accédons dans un salon où sont exposées toutes sortes d’objets ayant appartenu à Alexandre Dumas ainsi que des affiches et la plupart de ses œuvres. Nous pouvons y découvrir le grand dictionnaire de la cuisine, dont Alexandre Dumas a écrit à la fin de sa vie. Il a beaucoup voyagé en prenant des recettes de cuisine aux 4 coins du monde, on y trouve la recette de pied d’éléphant farci pas très simple à préparer, mais, on trouve également le veau à la ficelle, le veau à la chipolata, etc. Ce dictionnaire a été écrit dans les années 1869, 1870 années de sa mort, c’est donc Anatole France qui a publié ce dictionnaire. Dans son œuvre dédié à la cuisine, Alexandre Dumas n’hésitait pas à se mettre aux fourneaux, afin de préparer un repas pour 50 personnes, il savourait à écrire qu’ils en étaient venus 500. Alexandre Dumas a inauguré cette maison En 1847, il avait réuni un grand nombre de convives à un grand déjeuner champêtre. Il avait commandé 1000 bouteilles de vin, qu’il avait chassé pendant 3 jours pour que le traiteur prépare de succulents pâtés de sangliers, de chevreuil etc. Dans cette maison il donnait aussi des bals costumés, le tour des fenêtres du salon sont décorés de sculptures en papier mâché réalisées par des amis peintres décorateurs de théâtre. Le premier roman de Dumas est publié en 1830, les pièces de théâtre de Dumas duraient pour certaines plus de 6 heures. Tous les journalistes le caricaturent, la critique se moquait beaucoup de lui. Il défrayait la chronique de tous les journaux, il faisait la une des magazines sur sa vie privée tout au long de l’année. Alexandre Dumas fils a surtout été connu pour sa dame aux camélias, néanmoins il est rentré à l’Académie française, il dépensait moins d’argent que le père et il était plus fidéle avec ses épouses. Dumas achète le terrain de sa propriété en 1844, la construction commence en 1846 mais il dépense tellement d’argent, en 1848 il est obligé de vendre le mobilier puis en 1849 il cède la totalité de la maison. Monsieur Doyen un de ses amis lui rachète sa propriété, il ‘autorise à camper avant qu’il s’exile à l’étranger poursuivi qu’il était par ses créanciers. Loin de la France il a continué à écrire, il envoyait ses textes à Paris afin qu’ils soient publiés. Après monsieur Doyen 10 propriétaires différents ont acquis la propriété, c’est l’association des amis d’Alexandre Dumas qui ont racheté la propriété pour en faire un musée, l’association demanda à Jacques Chirac, que le corps de Alexandre Dumas soit transféré au Panthéon. Alexandre Dumas est l’auteur français qui a été le plus traduit et le plus lu au monde, il est entré au Panthéon en 2002. Le maire de Villers cotteron où il était enterré n’était pas très content, Alain Decaux et Jacques Chirac ont fait des allocutions. Ensuite nous avons pris la direction de Chatou pour aller déjeuner sur l’île des impressionnistes, qui fait parti des villages des boucles de la Seine qui ont vu s’épanouir la florissante peinture impressionniste de Monet, de Renoir, de Pissarro etc. Chatou est un petit coin de paradis niché au cœur de la verdure, qui a toujours été prisé des canotiers, des pêcheurs, des gastronomes qui venaient apprécier l’auberge du père Fournet où nous allons prendre le repas. Chatou a également attiré les écrivains Zola, Flaubert ou Maupassant qui venaient se divertir aux jeux nautiques et bucoliques. Nous apercevons un ancien pont à arches qui s’arrête au milieu de la Seine, de nombreux peintres peignent en bordure de La Seine.
Après un excellent repas nous prenons la route de Marne la Coquette, où se situe le premier institut Pasteur au monde. L’institut se trouve dans un parc magnifique, c’est Napoléon III qui a acheté 63 hectares pour y construire un petit château. Pour faire plaisir à l’impératrice Eugénie il lui a fait construire une ferme, malheureusement pour la belle Eugénie, Napoléon III a réquisitionné la ferme pour loger sa garde. Il a fait placé les officiers à l’étage, il a fait transformé le rez-de-chaussée en écurie en ouvrant de grandes portes afin qu’un homme puisse y rentrer à cheval. Ce bâtiment s’est donc appelé le bâtiment des 100 gardes, En 1871 après la défaite contre les Prussiens, le château a été détruit. Le toit du bâtiment des 100 gardes était en piteux état, le terrain était complètement à l’abandon. Napoléon III et Eugénie étaient partis en exil en Angleterre, c’est en 1884 que l’institut Pasteur s’est installé à Marne la Coquette. A cette époque Louis Pasteur était administrateur d’une école, il avait un tout petit laboratoire sous les toits de l’école. Il commençait ses travaux sur les maladies virulentes dont la rage, à 2 pas de l’école il possédait une animalerie avec des chiens enragés qui aboyaient tout le temps, des poules qui dégageaient une odeur nauséabonde. Les parisiens ne voulaient plus de Pasteur comme voisin, le gouvernement lui a donc proposé cet endroit. Conquis par l’environnement Pasteur a accepté de venir s’installer ici, il demanda de l’argent au gouvernement pour restaurer la toiture. L’animalerie a pris place dans l’écurie, à l’étage le laboratoire s’est constitué, pasteur s’est gardé une place pour son appartement dans lequel il est décédé. Louis Pasteur est né à Dole en 1822, enfant il dessinait à merveille, nous apercevons une aquarelle de sa mère qu’il a peinte à l’âge de 13 ans. Son père qui était tanneur n’appréciait pas le métier d’artiste, il voulait que son fils soit professeur. Louis était très intelligent, il va passer 2 baccalauréats celui de lettres et de mathématiques. Il passe le concours pour entrer à l’école normale où il est reçu quatrième, il va à Paris pour suivre ses études à la Sorbonne en ayant obtenu une bourse. Pasteur va tomber amoureux de la chimie, il sera donc chimiste et professeur de chimie dont son premier poste sera à Strasbourg.A Strasbourg il rencontre Marie Laurent qu’il va épouser, nous pouvons dire qu’à côté du grand homme Louis Pasteur il y avait une femme fantastique Marie Laurent. En 1884 il était entouré de 4 autres personnes Joubert, Chamberland, Roux et Crivy avec lesquels il va s’occuper des maladies des animaux. C’est le ministère de l’agriculture qui va demander à Pasteur de se pencher sur ce fléau des maladies des animaux, car après la guerre contre les prussiens la démographie est galopante, la France est frappée par des épidémies animales et il faut faire manger les français. Il y a le choléra de la poule, les moutons ont la maladie charbonneuse, les cochons étaient atteints de la maladie du rouge et du porc ça devenait catastrophique. Pour la maladie de la poule Pasteur met dans un flacon bouché par du coton, une sorte de bouillon de poule et quelques gouttes de sang de poule malade, il laisse incuber toute la nuit. Le lendemain il soustrait quelques gouttes du flacon dans une seringue, il administre une piqûre à une poule saine qui meurt de choléra. Pasteur est ravi car dans sa bouteille il a vraiment le responsable de la maladie, il confie à Chamberland le soin de cultiver la culture pendant une quinzaine de jours. Le jeune Chamberland avait oublié la potion de Louis Pasteur, qui constate que les bactéries sont mortes, curieux Pasteur décide d’injecter ces vieilles bactéries à une poule. La poule ne meurt pas, il cultive de nouveau des bactéries fraîches qu’il injecte à 50 poules dont la rescapée, 49 poules meurent sauf celle à qui il a injecté les vieilles bactéries auparavant. Louis Pasteur avait donc inventé les anticorps, la vaccination était née. Louis Pasteur dans la foulée a trouvé le vaccin de la maladie charbonneuse du mouton, que l’on connaît aujourd’hui sous le nom d’anthrax la fameuse bactérie utilisée par les terroristes. Ensuite Pasteur s’attaque à la rage qui détruit le système nerveux, il découvre le virus de la rage 50 ans avant l’invention du microscope, sur les conseils de son ami Ranchet médecin il décide d’infiltrer au jeune Joseph Munster le vaccin contre la rage. Après 14 piqûres le jeune Munster est sauvé, pour remercier Louis Pasteur il sera pendant 50 ans concierge à l’institut Pasteur. Joseph Munster finira dramatiquement, il voulait empêcher les allemands pendant la seconde guerre d’accéder à la crypte où reposait Louis Pasteur, les allemands le fusillèrent sur place. Après ses découvertes Louis Pasteur était vénéré par tout le monde, il voulait construire un institut de la rage, il reçut de l’argent de toute part et de toute origine. Au lieu de construire l’institut contre la rage, on a construit l’institut Pasteur de paris qui sera inauguré en 1888. Pasteur atteint d’hémiplégie surveillait toujours les travaux de son laboratoire, le docteur Roux inventa en 1889 le vaccin contre la diphtérie. Le docteur Roux utilisa le sang de cheval, qui contenait des anticorps capables de neutraliser le poison de la diphtérie. Ensuite est arrivé le vaccin contre le tétanos, beaucoup de poilus de la guerre de 14-18 ont eu la vie sauf grâce à la sérothérapie contre le tétanos. Monsieur Calmet est allé au Viet nam pour réaliser la sérothérapie contre le venin du serpent, là aussi on utilisait le sérum de cheval comme infiltration à l’homme. Le vœu de Louis Pasteur est que tout le monde puisse se faire soigner, c’est pour cela que les vaccins et la sérothérapie seront gratuites, grâce à une vaste souscription du journal le Figaro dont le directeur était le frère de Monsieur Calmet. A l’institut Louis Pasteur de Marne la coquette, on a compté jusqu’à 400 chevaux afin de fabriquer les sérums pour lutter contre la rage, la diphtérie, le tétanos, le venin du serpent, la peste etc. Ensuite nous avons parcouru l’appartement modeste de Louis Pasteur, nous sommes passés devant sa chambre dans laquelle il est mort. Après nous avons repris notre autocar pour rejoindre le musée Renault à Boulogne Billancourt, nous apercevons la tour Eiffel puis nous franchissons la Seine au pont de Saint-Cloudet nous voici à l’île Seguin où se trouve le musée Renault. Nous sommes dans un ancien hôtel particulier, qui a servi de club pour jouer aux cartes, au bridge, au billard dans la salle d’accueil c’était un bar. Des soirées dansantes étaient aussi organisées dans ce lieu, devenu trop petit on a construit un bâtiment moderne. L’hôtel étant devenu libre, Monsieur Artuis créateur de la société d’histoire Louis Renault a demandé d’utiliser le rez-de-chaussée de l’ancien club pour en faire un musée, ce qui lui fut accordé. Ce musée est animé par des bénévoles, il retrace toute la vie de l’entreprise Renault. Louis Renault est issu d’une famille de 5 enfants, dont 3 frères sont restés louis, Fernand et Marcel. A son retour de l’armée en 1898 Louis Renault décide de créer un atelier de construction de voiturettes sur le terrain familial, la voiturette a été présentée à Noël 1898. Il a reçu 12 commandes fermes, pendant l’année 1899 ce sont 71 voiturettes qui sortiront des ateliers de Boulogne Billancourt. Au début ce sont ses frères qui l’ont aidé financièrement, la famille Renault était dans la fabrique des boutons. Depuis ce petit atelier l’usine Renault a grandi jusqu’en 1939, au début de la seconde guerre l’usine Renault était construite sur 110 hectares. L’usine représentait un quart de la superficie de la ville de Boulogne Billancourt, le principe de Renault pour grandir son usine était d’encercler les gens qui étaient autour de lui. Renault n’était pas sociable, pour venir à ses fins, il n’hésitait pas à faire des essais de poids lourds en les faisant tourner autour d’un pâté de maisons. Louis Renault voulait dépendre de personne, en 1900 il a commencé les compétitions automobiles, il a gagné des grands prix, En 1903 il participe à Paris Madrid, il s’arrête à Bordeaux lorsque son frère Marcel s’est tué. Choqué Louis Renault a arrêté la compétition, c’est son mécanicien et pilote François Size qui lui a dit de faire de la compétition s’il voulait vendre des voitures. Louis Renault ne s’est pas laissé influencé, François Size est donc devenu pilote officiel et il a continué à gagner des courses. Louis Renault à continuer à construire des voitures, pendant la première guerre mondiale il a été nommé responsable des armements pour toute la région parisienne. Pour lui construire des obus et des canons c’était bien, mais, il manquait des moyens pour aller sur le front. Il a donc construit le premier char FT17, il a donc gagné beaucoup d’argent ce qui lui a permis d’acheter toute l’île Seguin. Monsieur Seguin était tanneur, il a vendu son île en parcelles, Louis Renault a donc acheté l’île au fur et à mesure. Louis Renault n’était pas sociable, mais, social car il confiait les parcelles de l’île Seguin à ses ouvriers afin qu’ils viennent s’y détendre. Louis Renault s’est marié après la première guerre mondiale, il a eu un fils Jean-Louis. Dans les années 1920 il a acheté 11 domaines agricoles en Normandie, qui représentés 1700 hectares composés de forêts, de prairies, de terres céréalières et maraîchères et avec un cheptel d’animaux de toutes sortes. Les produits de ses fermes viande, beurre, fromage, farine, légumes et fruits étaient vendus aux coopératives ouvrières de ses usines qu’il avait créées pendant la guerre. Dans ses usines il construisait le moindre accessoire qui compose une voiture, par contre il n’a jamais produit de vitres. Il avait acheté des forges en Lorraine et dans la vallée de la Tarentaise, de ses forêts il exploitait le vois nécessaire à la construction d’automobiles, il exploitait des forêts d’hévéas pour le caoutchouc afin de fabriquer les pneus. Il voulait tout maîtriser, il a même créé sa banque personnelle. Dans les années 1930 il était en concurrence avec André Citroën qui venait de créer son entreprise, cette confrontation accélèrera les prouesses techniques des 2 constructeurs jusqu’à la mort de André Citroën en 1935. Du scorie de ses forges Renault fabriqua des briques pour construire de nouveaux bâtiments, le surplus était d’ailleurs vendu à Citroën. Il fabriquait aussi de la ouate pour l’intérieur des véhicules, dont la surproduction était négociée avec les hôpitaux de Paris. Louis Renault s’est attaché la collaboration de l’ingénieur Béziers, l’inventeur de la machine à transfert, l’automatisation de la construction automobile était donc née. Selon ses besoins Louis Renault achetait une machine, il la faisait démonté par ses ateliers puis la faisait dessiner et remonter par ses bureaux d’études, alors il pouvait en fabriquer le nombre nécessaire pour ses usines. En 1939 les Allemands lui proposa soit de construire des camions allemands dans ses usines ou ils transféraient ses machines et ses ouvriers en Allemagne pour construire des camions. Louis Renault choisit de rester à Boulogne Billancourt, les ouvriers s’évertuaient d’imagination pour saboter le travail, les usines de l’île Seguin ont subi 3 bombardements pendant la seconde guerre mondiale. En cachette dans les sous-sols de l’usine, grâce à Béziers Renault a réussi à construire la fameuse 4 chevaux dont la réclame était 4 chevaux, 4 portes, 4 cylindres et 4 places. Madame Renault pendant l’occupation circulait au nez et à la barbe des allemands en 4 chevaux, pour se rendre de l’usine de Boulogne Billancourt à son appartement situé avenue Foch, confondaient-ils la 4 chevaux à la Volkswagen. Louis Renault est mort au cours de l’année 1944, madame Gallice la seule à n’avoir pas vendu sa parcelle à l’insociable Renault qui avait du lui construire une passerelle afin qu’elle use de son droit de passage décida alors de vendre sa propriété à la nouvelle régie Renault. A la libération tous les biens industriels de Renault ont été nationalisés pour commerce avec l’ennemi, madame Renault et son fils Jean-louis conservèrent les biens privés l’appartement rue Foch à Paris, les 11 domaines normands, la propriété de la presqu’île de Gien et le château de Chauzé. L’état aida la régie Renault pour se reconstruire des dégâts causés par la guerre comme il l’a fait pour bien d’autres entreprises, la régie Renault a continué son essor industriel. Nous pouvons citer comme grande réussite la 4L, Toute la gamme des voitures commençant par R et maintenant les modèles du 3.me millénaire. Tout au long de son histoire Renault a construit des voitures, des camions, des tracteurs agricoles, des machines outils, des rames de métro à pneus, des autorail et des moteurs de bateaux, aujourd’hui Renault emploie 135000 personnes dans le monde. A partir de 1950 Renault s’est délocalisé à Flins, à Cléon etc, l’île Seguin est un fantôme qui suscite de pharaoniques projets immobiliers, culturels et commerciaux mais rien de bien sérieux pour le moment. Un grand bâtiment blanc est encore occupé aujourd’hui, il renferme la sacro-sainte communication du groupe Renault qui comprend de luxueux bureaux, des salles de conférences de toutes tailles ainsi que la fondation du patrimoine Renault qui gère entre autre les 700 véhicules de la marque au losange. Ensuite nous avons déambulé dans le musée où sont présentés des moteurs et des boîtes de vitesse en coupe, des outils de précision, de l’outillage mécanique et de nombreuses maquettes de voitures renault. Enfin nous avons rejoint Versailles pour aller dîner et prendre un repos plus que mérité.
(5) Aujourd’hui nous consacrons notre journée à la visite du château de Versailles, nous commençons notre découverte par le parlement. Nous sommes dans la galerie qui retrace l’existence de la vie parlementaire en France, Versailles est le château de l’absolutisme traduit par Louis XIV, mais c’est aussi le berceau de la naissance de l’assemblée nationale. Les locaux du musée de l’assemblée nationale ont une superficie de 25000 M2, le musée se transforme en lieu de travail lorsque les parlementaires doivent se réunirent pour modifier la constitution française. Depuis le5 octobre 1958 naissance de la 5.me république les parlementaires se sont réunis 13 fois à Versailles, le dernier congrès du parlement a eu lieu le 28 février dernier. L’ensemble des parlementaires vienne à Versailles car l’hémicycle du parlement peut contenir les 908 députés et sénateurs, le palais Bourbon pouvant contenir 600 personnes et le sénat ne peut accueillir que 300 personnes. Le parlement ou salle du congrès de Versailles a été construite en 1875, la même année L’amendement de Henri Vallon va se jouer à une voix près pour la république. Lors des congrès les parlementaires sont placés par ordre alphabétique et non par couleurs politiques, nous pouvons avoir un député communiste assis à côté d’une sénatrice UMP. Le débat ayant eu lieu au parlement et au sénat, au congrès à Versailles n’intervient que le vote. Nous apercevons un portrait de Louis XVI qui a accepté la convocation des états généraux proposés par Necker et une affiche de 1789 qui invite les privilégiés du royaume à participer au vote. Les états généraux n’avaient pas été réunis depuis 1614, ils se tiennent dans une salle située à 2 kilomètres du château. On attend beaucoup des états généraux auxquels les députés vont venir avec des doléances des sujets du roi, les députés sont répartis ainsi : 300 représentent le clergé, 300 la noblesse et 300 le tiers état. En faite le discours de Necker ministre des finances de Louis XVI, ce n’est pas pour annoncer de bonnes nouvelles mais pour augmenter les impôts. Six semaines plus tard le 6 juin 1789 les députés du tiers état veulent un partage du pouvoir, comme en Angleterre et reprendre les thèmes de Montesquieu, qui parlaient de séparation de pouvoir avec l’exécutif représenté par le roi et un pouvoir législatif réservé aux députés et un pouvoir judiciaire représenté par les magistrats. Bien sùr Louis XVI et ses 2 frères refusèrent cette hypothèse, le 20 juin le roi fait fermer les portes, il met en place la garde royale, les représentants du tiers état vont se réunir dans une autre salle. Ils vont faire le serment du jeu de paume, ils vont jurer de ne pas se séparer avant d’avoir apporté une constitution au royaume de France. Le 23 juin Louis XVI annonce qu’il ne veut pas de constitution et d’assemblée nationale, il demande aux députés de se séparer, les députés du tiers état déterminé vont rester. Louis XVI quitte la salle, le représentant du roi scande à la tribune écoutez le roi, séparez-vous, à quoi Mirabeau va lancer : Nous sommes ici, nous ne sortirons que par la force des baïonnettes. Devant la détermination des députés 4 jours plus tard il acceptera l’assemblée nationale c’est le début de la monarchie constitutionnelle qui prend la place de la monarchie absolue. L’assemblée nationale deviendra constituante, les députés étaient élus pour 2 ans le président quant à lui était élu pour 15 jours pendant les 10 années de la révolution. Pendant cette période il y a eu 193 présidents, alors que Jean-Louis Debré le président actuel n’est que le 243.me président de l’assemblée nationale. Le détenteur de longévité est Jacques Chavan Delmas qui est resté 16 ans au perchoir, Edouard Herriot est tout de même resté 11 ans à la présidence du palais Bourbon. Le premier président a été Jean Sibert-Bailly celui qui a pris la parole au serment du jeu de paume, il deviendra par la suite le premier maire de Paris à partir de juillet 1789. La révolution va commencer après le renvoi de Necker, le peuple en veut au roi, le 14 juillet on se révolte toute la France s’embrase, si la révolution dure si longtemps c’est parce qu’il y a autant de monarchistes que de révolutionnaires. L’assemblée nationale constituante est mise en place, elle va durer 2 ans pendant laquelle au mois d’août on vote la loi de l’abolition des privilèges. Le 26 août c’est la déclaration des droits de l’homme et des citoyens, le 6 octobre Louis XVI quitte le château de Versailles. Il se rend au palais des tuileries, le château de Versailles sera alors abandonné c’est Louis Philippe qui va le restaurer à partir de 1848. Les députés quant à eux quittent Versailles en novembre 1789, après avoir mi-fin aux privilèges on met fin aux duchés, au comté c’est comme cela que l’on va créer les départements et communes. Nous pouvons consulter la carte de France de 1790 qui comptait 83 départements, les départements du sud-est n’étaient encore pas rattachés à la France. Versailles a vu la naissance du parlementarisme, la première constitution a été signée par Louis XVI aux tuileries le 14 septembre 1791, C’est après sa fuite et son arrestation à Varennes qu’il perd la confiance des français, il sera mis en résidence surveillée. Après la signature de la première constitution, l’assemblée législative va suivre avec de jeunes élus inexpérimentés, elle va durer moins d’un an, le 10 août 1792 on y met un terme. Suite à l’assaut des parisiens contre le palais des tuileries, 900 gardes suisses du roi seront massacrés, le roi et sa famille vont se réfugier dans la salle du Logogrammes. La salle dans laquelle les députés décident de suspendre le roi, il reste en otage, l’assemblée nommera les ministres, c’est la fin de la monarchie constitutionnelle qui n’aura duré que 3 ans. Ensuite c’est la première république avec trois périodes la convention, le directoire et le consulat, deux périodes la convention, le directoire sous la révolution française, la convention période de terreur avec Robespierre, Danton, Marat, Saint-Just, Camille Desmoulins et bien d’autres. Les premiers députés touchaient 558 livres par mois, la loi des suspects date du 17 septembre 1793,toutes personnes suspectées être anti révolutionnaires seront arrêtées, jugées puis exécutées la même journée par un tribunal révolutionnaire. En 14 mois se sont 40000 victimes dont 17000 guillotinées, c’est vraiment une épuration il suffit de dénoncer quelqu’un comme suspect et il subit la sentence. Les deux frères Robespierre et Saint-Just feront partie des victimes de leur propre loi, On met fin à la terreur, quelques mois après c’est la mort de la convention, c’est la mise en place du directoire. Le pouvoir exécutif est dirigé par 5 directeurs, le législatif voit la naissance du bicamérisme soit 2 chambres, le conseil des 500 députés et le conseil des anciens qui devaient avoir 40 ans être mariés ou veufs. Les députés avaient l’initiative des lois, en revanche les anciens acceptaient ou refusaient les lois. Le directoire se passait bien jusqu’à ce que 2 directeurs préparent un coup d’état, il s’agit de lessieursmmmmm Cellies et Duclos, ils vont utiliser le général Bonaparte qui s’est illustré pendant les campagnes d’Italie entre 1796 et 1797. Bonaparte est très bien vu par les Français, mais aussi par son armée, le 18 et 19 brumaire de l’an VIII c’est le coup d’état. Bonaparte prend donc le pouvoir, il est bousculé par les députés à la tribune de l’assemblée nationale, tout avait été prévu, son frère Lucien 24 ans était président du conseil des 500. Lucien Bonaparte est sorti à l’extérieur pour dire à l’armée que l’on voulait assassiner leur général et qu’il fallait évacuer la salle. Le général Murat fait intervenir les militaires, la plupart des députés vont s’enfuir, mais une centaine sera rattrapée dans la forêt de Saint-Cloud, ils prépareront la loi qui mettra fin au directoire que les anciens devaient signer. Nous pouvons voir la loi qui a été signée par 61 anciens, Bonaparte devient premier consul, consul à vie puis empereur des français. Nous continuons à déambuler dans le musée, Bonaparte était un dictateur qui a tout de même mis en place le baccalauréat, le code civil, le code des armées la légion d’honneur, le cadastre et bien d’autres choses. Sous les 15 ans de règne de Napoléon les députés ne siégeaient que 6 à 8 semaines par an, le pouvoir législatif était très réduit, Bonaparte décidait de tout. A la suite de son exil à l’île d’Elbe Bonaparte sera remplacé par le frère de Louis XVI le comte de Provence choisit par les sénateurs, qui deviendra Louis XVIII. Louis XVIII va régner pendant 10 ans avec l’interruption des 100 jours à partir de mars 1815, durant laquelle Napoléon reprendra le pouvoir avant d’être définitivement exiler à l’île Sainte-Hélène où il mourra. En 1824 C’est la continuité de la restauration sous Charles X, pendant la restauration c’est le suffrage censitaire, ce sont les riches qui peuvent voter et les très riches peuvent être élus. Pour voter, il faut avoir 30 ans et payer 300 francs, pour être éligible il faut avoir 40 ans et payer 1000 francs, à savoir que 300 francs équivalait à 300 jours de travail d’un ouvrier ce qui fait qu’il y avait peu de votants. Charles X Veut abandonner le drapeau tricolore pour le drapeau blanc, le bleu et le rouge évoquent paris Saint-Denis et Saint-Martin, c'est-à-dire les couleurs du peuple emprisonne comme dans un étau le blanc qui est le symbole de la monarchie. Charles X devient impopulaire, c’est le taulée général, Fin juin 1830 ce sont les trois glorieuses où le peuple est dans la rue. Charles X est obligé d’abdiquer, Louis Philippe prend le pouvoir pendant 18 ans, il sera le dernier roi de France. On entre dans une période de prospérité, le suffrage censitaire est toujours en vigueur, en 1848 le peuple réclame le suffrage universel. Louis Philippe le refusera, ce sera donc la révolution de 1848 et le peuple aura le droit de vote, on passera de 230000 électeurs avec l’ancien suffrage à 9 millions avec le suffrage universel masculin où tout citoyen vaut une voix. En 1848 le premier président de la république sera Napoléon III, en 1851 il fait un coup d’état et rétablit qu’une chambre de 750 députés. Le président était élu pour 4 Ans non reconductibles, Napoléon III avait eu 6 refus de la part des députés afin d’abolir cette loi ce qui motiva son coup d’état. Il fait intervenir l’armée, il renvoie les députés, il est plébiscité par des élections où la question était « Voulez-vous le retour de l’empire « le choix était vite fait car les bulletins étaient très visibles et les isoloirs n’existaient pas. En 1870 c’est la défaite contre les Prussiens, la 3.m’ républiques est proclamée, elle deviendra effective En 1875 suite à l’amendement de Henri vallon qui passe à une voix de majorité. A partir de 1875 les présidents de la république vont laisser les parlementaires faire leur travail, qui va apporter une grande évolution au niveau des lois sociales et des libertés. Loi Jules Ferry 1880-1882, la loi des associations 1905, il a fallu attendre le XX.me siècle soit plus d’un siècle après la révolution de 1789 pour que les conditions de vie des citoyens soient améliorées. La 3.me république sera en vigueur jusqu’en 1940, date à laquelle le maréchal Pétain prend les pleins pouvoirs. Ensuite nous nous sommes installés dans l’hémicycle de la salle de congrès, où l’on nous a diffusé un film sur le parlementarisme français, on nous a décrit le décor de la salle qui peut contenir 1700 personnes. Nous avons écouté des bribes de discours tenu par Mirabeau, Charles X, Gambetta envers mac Mahon (il faudra se soumettre ou se démettre), Jules Ferry, Aristide Briand, Simone Weil. Robert Badinter. Georges Clemenceau, Léon Blum, Danton qui retraçaient les 216 années du parlement français. Ensuite nous avons continué notre conférence confortablement assis dans les fauteuils de nos chers représentants. La salle du congrès a été érigée à l’emplacement d’une ancienne cour intérieure, pour que la constitution soit modifiée, il faut que 60% des parlementaires vote la nouvelle constitution. Puis nous avons circulé dans le hall de réception et les bureaux des plus hauts représentants de l’état, nous pouvons apercevoir les bustes ou tableaux des députés qui ont marqué les 5 républiques. Gambetta qui a été présidant de l’assemblée nationale sous la 3.me république, Edouard Herriot 52 ans maire de Lyon, plusieurs fois député et 11 ans de présidence de l’assemblée nationale. Si la décoration de la salle du congrès est en trompe l’œil, ici c’est du vrai marbre, on le doit à Louis Philippe lors de la rénovation du château antérieure à la construction du parlement 1875. Nous pénétrons dans un bureau décoré à la feuille d’or, où pendant le congrès du parlement le président du sénat reçoit ses invités avant de rejoindre l’hémicycle. Lors du congrès il n’a pas un rôle important, il est assis au premier rang de la salle du congrès, étant le deuxième personnage de France il a son bureau à Versailles. Le président du sénat peut devenir président de la république par intérim, donc il ne peut pas présider le pouvoir législatif. Nous pouvons admirer un tableau qui représente le sénat et le palais du Luxembourg, de la vaisselle en porcelaine de sèvres est exposée sur une table. Cette vaisselle a 150 ans, elle est dorée à l’or fin, ce sont des pièces uniques que l’on trouve dans les différents ministères, à l’Elysée, à l’assemblée nationale et au sénat. L’assiette vaut 1200 euros, si par malheur lors du service on casse une assiette, les morceaux sont renvoyés à Sèvres afin que la pièce soit restaurée. Nous parcourons le bureau du président de l’assemblée nationale, qui lui préside la réunion des députés et sénateurs, on appelle ce bureau le bureau de l’investiture. Lorsque les présidents de la république étaient élus à Versailles de Jules Grévy 1879 à René Coty 1953, les présidents fraîchement élus venaient dans ce bureau. Le président du congrès, qui était sous la 3.me et 4.me république le président du sénat remettait le procès verbal de leur investiture. Le musée du parlement se trouve dans les anciens appartement de Monsieur, le frère de Louis XVI le comte de Provence qui deviendra Louis XVIII. Après 2 heures de vie politique, nous circulons dans les jardins du domaine de Versailles à bord d’un petit train. Avant la révolution le domaine de Versailles couvrait 7800 hectares soit la surface actuelle de Paris, il était entouré d’un mur de 43 kilomètres. Aujourd’hui le parc du château de Versailles ne couvre plus que 800 hectares, le parc est un musée exceptionnel en plein air constitué par le petit parc qui s’étend de la terrasse du château au grand canal, le grand parc traversé par la grande allée, les jardins et musées du Trianon, le hameau de Marie Antoinette, le petit Trianon construit sous Louis XV par Gabriel en 1761 fut offert à Marie Antoinette par louis XVI en ces termes. « Vous aimez les fleurs et bien j’ai un bouquet à vous offrir c’est le petit Trianon » A proximité elle fit construire par Richard mique en 1783 un hameau de 12 maisons aux toits de chaume laiterie, pêcherie, grange, moulin et ferme. Le temple de l’amour édifié en 1778 au cœur des jardins de la reine est entièrement réalisé en marbre blanc. Le palais du grand Trianon tient son nom de terre acheté par Louis XIV en 1668, édifié en 1687 par Mansart, il est entouré de jardins dans lequel le roi aimait se reposer, il a été utilisé par tous les souverains jusqu’à Napoléon III en 1870. Une partie du grand Trianon est devenue la résidence du président de la République et de ses hôtes, superbement restauré, il est un complément indispensable à la visite du château. Il surplombe le grand canal dessiné par le Nôtre en 1668 d’une superficie de 24 hectares son périmètre est de 6 kilomètres, sa construction dura 4 ans. Sous Louis XIV le grand canal était une véritable mer miniature avec 9 navires, un vaisseau de 32 canons, une felouque napolitaine, des gondoles offertes par le doge de Venise et une galère. Le bassin de Neptune fut construit sous Louis XIV par le Nôtre, c’est le plus grand du parc avec 99 jets d’eau. Au centre se trouve Neptune le dieu de la mer régnant sur les flots, en face DU BASSIN Neptune se trouve le bassin du dragon dont le jet le plus grand des bassins du parc s'élève à 27 mètres. Enfin 30 minutes de promenade à travers le domaine, nous avons rejoint le restaurant situé en face du château pour y déjeuner.
Le but de l’après-midi est la visite de la chapelle royale et les appartements du roi, nous commençons par un atelier qui nous familiarise avec les techniques de l’architecture et de l’ameublement.
Ensuite nous pénétrons dans la chapelle royale où Louis XIV venait entendre la messe tous les jours, c’est-à-dire qu’il ne communiait pas, la communion était réservée aux 5 grandes fêtes religieuses. La chapelle mesure une cinquantaine de mètres de haut, à l’étage se tenait le roi, ainsi il se trouvait entre dieu et les hommes. Les ducs et les princes assistaient à la messe aux côtés du roi, la chapelle est décorée de pierre, de marbre et de bronze. Elle mesure 60 mètres de long, le plafond est en peinture sur toile (toiles marouflées) qui résistent mieux que les fresques dans les régions humides. Le sol est décoré grâce au différentes couleurs de marbre, nous pouvons découvrir le L pour Louis, des fleurs de lys et des couronnes, la chapelle a été construite en dix ans. Nous sommes maintenant dans la chambre du roi qui mesure 12 mètres de haut et dont la surface est de 90 M2 le chauffage est assuré par 2 immenses cheminées. Louis XV trouvait cette chambre trop grande et froide, il a donc aménagé une chambre plus intime. Les murs sont décorés à la feuille d’or, de bois sculpté, de colonnes carrées ou pilastres dressées tout au long du mur. Un balustre sépare l’alcôve royale du reste de la chambre qui n’est pas sacré, le matin le roi se réveille dans son lit toujours seul, s’il veut aller voir une dame c’est lui qui se déplace par galanterie. Il se lève à 8 heures, les plus hauts dignitaires de la cours et un prêtre viennent prier à son lever. Ensuite un chirurgien, des médecins et d’autres dignitaires viennent lui dispenser une toilette sèche en le frictionnant avec de l’esprit de vin dilué dans un peu d’eau, car à cette époque on pensait que l’eau du bain rentrait dans le corps. Puis on aidait le roi à se changer, il pouvait se changer 10 fois par jour, il se rase un jour sur deux, on lui passe une perruque courte qui est plus facile pour finir de s’habiller. Le roi prend son petit déjeuné du pain, de l’eau, du vin, du café, voire de l’infusion de sauge. Il termine de s’habiller, en procession il va assister à la messe au retour de laquelle il préside le conseil des ministres. Le midi il déjeune dans sa chambre où les dames ne sont pas admises, l’après-midi chasse à cour, à 17 heures retour au château pour un petit conseil des ministres. A 22 heures c’est le dîner où on a le droit de regarder le roi manger, enfin c’est le couché du roi avec le même cérémonial que le lever. Nous nous dirigeons vers la galerie des glaces toujours poursuivis par des touristes chinois, les miroirs sont de fabrication française grâce à la méthode de coulage sur table de plomb. Auparavant avec la méthode italienne du verre soufflé, on ne parvenait pas à fabriquer de grands miroirs. Les miroirs sont entourés de marbre français, la galerie des glaces sert à l’apparat depuis laquelle nous pouvons admirer la perspective des parcs et jardins du domaine. Elle servait de salle des pas perdus avant d’accéder aux appartements du roi et de la reine. La galerie mesure 73 mètres de long sur 12 mètres de large, elle subit en ce moment sa première restauration depuis le XVIIIème siècle qui a commencée, il y a dix ans et qui doit se terminer en 2010. L’architecte de la galerie des glaces est Jules Ardouin Mansard qui est aussi celui de la chapelle, à l’époque de Louis XIV la galerie le mobilier de la galerie était en argent. Après 2 heures de visite, nous prenons notre autocar en direction de Paris où nous allons assister à un spectacle de chansonniers au théâtre des 2 ânes. Nous dînons dans un restaurant près de la place de Clichy où nous dégustons une soupe à l’oignon au son du pianiste interprétant les airs de Paris. Puis nous avons poursuivi la soirée au spectacle (en attendant Sarco) où nous ont ravi Jean Amadou, Michel Guidoni, Bernard Mabille et Pierre Douglas et une jeune humoriste. Sur le chemin du retour à Versailles Thierry nous a fait découvrir les monuments illuminés de Paris la nuit, c’est après les 12 coups de minuit que nous arrivons à notre hôtel.
(6) En route pour la Picardie nous prenons la route de Chantilly, le nom de Chantilly remonte à l’époque Gallo-Romaine. Pour la petite histoire ce midi nous déjeunerons au restaurant du château qui est installé sous les voûtes ancestrales des cuisines de l’illustre cuisinier Vatelle. Vatelle s’est suicidé à Chantilly, voyant que la marée n’arrivait pas pour préparer le repas royal. Tous les grands écrivains du XVIIème siècle dont Molière qui obtint du grand Condé l’autorisation de représenter Tartuffe, il fut suivi par Boileau, Racine, Madame de Lafayette et Madame de Sévigné, Bossuet, Fénelon et la Bruyère. Au moyen âge la maison fortifiée devient château fort appartenant au bouteiller, chargé des caves du roi au temps des capétiens, il était aussi grand conseillé de la couronne. En 1386 la terre passe au chancelier d’Orgemont qui reconstruit le château, le sous-bassement féodal a supporté les 3 édifices postérieurs. En 1450 un baron de Montmorency épouse la dernière des Orgemont, Chantilly entre dans l’illustre famille pendant 2 siècles. En 1528 le château est démoli, à sa place on élève un palais de style renaissance française. Sur l’île voisine est construit un charmant castel qui existe encore aujourd’hui et que l’on nomme le petit château, les 2 châteaux étaient séparés par un large fossé aujourd’hui comblé. De nouveaux jardins sont dessinés, les plus grands artistes interviennent, Charles Quint ne peut cacher son admiration quand il visite Chantilly. En 1567 à 75 ans Yan de Montmorency rentre en campagne contre les protestants, il trouve la mort à la bataille de Saint-Denis. Henri IV séjourne souvent à Chantilly auprès de son compagnon d’arme Henri I.er de Montmorency fils du grand connétable, à 54 ans Henri IV s’éprend de la fille de son hôte âgé de 15 ans. On arrange son mariage avec Henri Bourbon de Condé garçon timide et gauche, auquel ils espèrent trouver un mari complaisant. Le lendemain des noces Condé amène sa femme en province Henri II leurs ordonne immédiatement de revenir le couple se réfugie à Bruxelles sous la protection du roi d’Espagne, le Vert galant menace, il va jusqu’à demander l’intervention du pape, mais il meurt assassiné par Ravaillac, les fugitifs peuvent rentrer en France, Henri II de Montmorency poussé par Gaston d’Orléans frère de Louis XIII se révolte contre Richelieu, il est vaincu à Castelnaudary. Le dernier des Montmorency sera décapité à Toulouse en 1632, pour se faire pardonner, il lègue au cardinal 2 statues de d’esclaves de Michel-Ange aujourd’hui au Louvre, des copies sont exposées à Chantilly. Charlotte de Montmorency et son mari Henri II de Bourbon de Condé héritent alors de Chantilly en 1643, la famille profite des victoires militaires du fils le futur grand Condé pour accroître une fortune considérable jusqu’à la révolution. Le grand Condé embellit le château avec la fougue et la maîtrise qui le caractérisaient lors de ses campagnes militaires, en 1662 il fait intervenir le Nôtre et Chanzet pour modifier le parc et la forêt. Les pièces d’eau dont les jets laissent stupéfait Louis XIV, qui à Versailles les voudra plus imposant quelque soit les contraintes techniques. Aujourd’hui une grande partie des jardins et bois de Chantilly subsiste depuis l’époque du grand Condé, qui ont suscité plus de 20 Ans de travaux. Le grand Condé meurt à Fontainebleau en 1686, son arrière-petit-fils Monsieur le Duc artiste ayant le goût du faste Louis Henri de Bourbon donne à Chantilly un très vif éclat, il fait construire les grandes écuries chef d’œuvre du XVIII.me siècle et créée une manufacture de porcelaine disparue en 1870. Le château d’Enghien est construit en 1769 par louis Joseph de Condé, son premier occupant sera son petit-fils le duc d’Enghien qui vient de naître. Le père du nouveau-né à 16 ans et le grand-père en a 36, le jeune prince va périr tragiquement en 1804, enlevé au duché par la police française, il sera fusillé dans les fossés de Vincennes par Bonaparte. Pendant la révolution le château est rasé, le petit château quant à lui échappe à la destruction, à son retour d’exil Louis Joseph âgé de 78 ans revient à Chantilly avec son fils, la douleur est terrible car leur château est ruiné, le parc est saccagé, il décide de remettre la propriété sur pied.
Arrivés à Chantilly nous avons parcouru les grandes écuries où sont logés les chevaux du musée du cheval de Chantilly, toutes les races de chevaux, de poneys et de Leyland sont représentés la plupart sont d’origine d’Espagne ou du Portugal. Chaque cheval a sont box, quand ils arrivent au musée de l’équitation ils sont âgés de 3 ans, leurs litières sont faites de paille ou de copeaux. Ensuite nous assistons à une épreuve de dressage pendant laquelle la cavalière nous raconte, la vie du lieu et sa passion pour le cheval. Nous sommes dans l’ancienne cour des cheniers transformée en carrière, pour y installer un manège à ciel ouvert avec une piste de cirque de 13 mètres de diamètre. Sans prétention équestre le but de la représentation est donné par l’institut de France qui gère le musée, c’est avant tout un musée pédagogique donc nous allons assister aux bases de l’équitation. Les écuries des princes de Condé ont été construites afin de recevoir 240 chevaux destinés à la chasse à cour et à l'attelage, comme son nom l’indique la cour des cheniers était le lieu où étaient concentrés les 500 chiens nécessaires à accompagner 5 équipages de chasse à cour. Auparavant il y avait une grande et jolie fontaine qui servait comme abreuvoir aux chevaux, elle était aussi le cadre dans lequel les princes de Condé aimaient recevoir leurs visiteurs. Ils en profitaient pour leur faire apprécier leur cavalerie de chasse à cour et d’attelage, de nombreux personnages sont donc venus se détendre à Chantilly pendant les fêtes organisées par les princes de Condé dont Louis XV, Frédéric II de Prusse et le futur pape Paul I. Le dernier agencement des écuries on le doit au dernier propriétaire le duc d’Aumal, qui a créé l’institut de France pour accueillir les chevaux de course. Les grandes écuries furent épargnées de la démolition lors de la révolution, grâce à l’armée de Napoléon qui les avait réquisitionnées pour héberger leurs chevaux. Le musée de l’équitation est ouvert au public depuis 1982, depuis 1834 existe près des grandes écuries le fameux hippodrome de Chantilly. Chaque année début juin se déroule sur cet hippodrome le prix de Diane, le prix du Jockey club réservé aux chevaux de 3 ans. Chantilly est devenu un centre d’entraînement où dans la forêt nous pouvons voir plus de 3000 chevaux sur les 180 kilomètres de pistes s’entraîner tous les jours. Chantilly est reconnu comme la capitale mondiale du cheval de course, tout en nous narrant l’historique des grandes écuries nous avions droit à la présentation de 2 chevaux un d’origine espagnole et l’autre arabe qui étaient les races privilégiées des princes de Condé. Le code de dressage entre l’homme et le cheval se fait d’aides naturelles : les jambes, les mains par l’intermédiaire des rennes et du mors, du poids du cavalier suivant sa position. Aux aides naturelles s’adjoignent des aides de travail que l’on manie avec douceur se sont : la cravache et les éperons. Toutes ces aides rassemblées et bien utilisées pare le cavalier les chevaux nous ont fait un show où nous les avons vus marcher, trotter, galoper, faire des pas chassés, se coucher, s’asseoir, s’étirer les articulations, se rouler et bien sûr saluer la foule. Pour arriver à ce travail qui prend de nombreuses heures de dressage le cavalier emploie le meilleur stratagème qui est de donner des gourmandises au cheval pomme, carotte ou sucre, comme le cheval a beaucoup de mémoire il exécute à merveille les ordres de son cavalier. Après 45 minutes de spectacle nous avons pris place dans un petit train pour sillonner le parc du domaine, nous avons aperçu le petit château du XVI.me siècle construit par le connétable Yan de Montmorency ministre de François I. Puis nous avons pu admirer le grand château reconstruit après la révolution 1870-1875 par l’architecte Daumet pour le duc d’Orléans fils de Louis Philippe. Nous contournons la statue du connétable exécutée en 1886, puis nous longeons le château d’Enghien (1769), où sont situés les appartements de l’institut de France au sein duquel siègent l’académicien et ancien ministre Alain Decaux et Yvon Gataz l’ancien président du CNPF. Nous circulons dans le parc du XVII.me siècle dessiné par le Nôtre, nous découvrons la cabotière qui est un bâtiment (1680) dédié au botaniste du grand Condé qui se nommait Cabot. Nous sommes dans un immense jardin où a été constitué un jeu de l’oie et ses 69 cases en milieu naturel, nous profitons de l’ombre de la forêt, nous débouchons sur l’orangerie XVIII.me siècle, le jardin est orné de nombreuses statues et d’allégories. Au loin nous découvrons le pas de tir des princes de Condé, nous passons devant la ménagerie qui est une réserve du zoo de Vincennes, nous contournons une des 7 chapelles de Chantilly construites par le connétable pour offrir un pèlerinage à la population. Nous arrivons à des cascades artificielles créées sur la Nonette affluent de l’Oise, une dérivation a permis de construire un canal de 2,5 kilomètres de long pour une largeur de 30 mètres sur lequel vivent de nombreux oiseaux aquatiques. Nous traversons un village construit pour la réception champêtre au XVIII.me siècle, c’est ce hameau que Marie-Antoinette créera en 1783 au domaine de Versailles. Nous sommes dans un jardin chinois, puis nous passons devant un vivier construit près d’une cascade, nous circulons au milieu des statues du grand Condé, de le Nôtre, de Molière et de la Bruyère avant de terminer notre circuit dans le parc de Chantilly. Ensuite nous avons pris le repas au château de Chantilly là où Vatelle exerçait ses talents de cordon bleu, puis nous sommes allés jouer aux courses à l’hippodrome. Pour terminer notre journée à Chantilly nous avons navigués sur le canal du parc du château à bord d’un bateau électrique, notre promenade fluviale s’est terminée sous un orage. En début de soirée nous avons repris le chemin de Versailles où nous avons pris le repas.
(7) Nous prenons la direction de Saint-Denis où nous attendent des visites culturelles sur l’industrie, le sport et l’histoire des rois de France. Le musée Christofle retrace l’évolution de l’entreprise de 1830 à nos jours, c’est un musée privé de l’orfèvrerie le seul en France avec ceux d’Arbois et de Montpellier qui abord ce thème. Le recensement des pièces de collection a commencé en 1971, le musée a été ouvert au public en 1993 et repensé en 2002. Le musée se compose de 4 parties : le hall d’accueil réservé aux fondateurs, aux présidents et aux directeurs généraux de l’entreprise Christofle, la salle 2 retrace la période 1830 1880 au milieu de laquelle se trouvent des vitrines des différents mouvements artistiques de l’époque l’orientaliste, le naturaliste, le japoniste, la salle 3 évoque la période 1880 jusqu’à la première guerre mondiale avec l’avènement de l’art nouveau, la salle 4 représente la période récente. Charles Christofle est né à Lyon en 1805, très jeune il est monté à Paris pour être apprenti bijoutier chez son beau-frère. Il épousa la fille de sa sœur il est donc devenu associé de son beau-père, il prend la succession de l’entreprise en 1837. Nous apercevons des photos du stand Christofle de des expositions de Paris 1867 et 1889 avec la tour Eiffel. Charles Christofle avait tout compris de la réclame, comme le prouve les catalogues, les affiches et les annonces de l’époque. Un éditorial de Emile Zola fait allusion entre Charles Christofle et les dames, il tirait à chaque parution de catalogue 500000 exemplaires. Le musée est construit sur le site de 2 hectares de l’usine, c’est le seul vestige industriel qu’il reste de la plaine Saint-Denis (du Landy). Le site situé entre la porte de la chapelle et le stade de France, en 1850 regorgeait d’industries lourdes dont les pianos Pleyel, aujourd’hui une seule cheminée subsiste celle de la pharmacie centrale. Les 3 cheminées de l’entreprise Christofle ont été démolies après l’abandon du traitement du nickel. En 1933 après la fermeture de l’usine de Paris, toute la production était réalisée à Saint-Denis. En 1970 on délocalise la production industrielle en Normandie à Lienville qui emploie aujourd’hui 250 personnes, le site de Saint-Denis est réservé au siège administratif et à la haute orfèvrerie qui emploie 300 personnes. Saint-Eloi est le patron des orfèvres, dans le hall est dressé le buste de Charles Christofle composé de 300 pièces de la production Christofle. Le président actuel Moldo Borletti a été nommé en 1993, il est né en 1967 ce qui en fait le plus jeune président de la dynastie. Nous apercevons le buste de Henri Douillet neveu donc beau-frère de Charles Christofle, Henri Douillet a été très important dans l’évolution de l’usine, il était ingénieur, normalien, chimiste et grand créateur. Nous pouvons aussi admirer une pivoine qui représente l’art nouveau et un clin d’œil à la fée électricité. Nous déambulons dans la seconde salle où un document atteste l’achat du brevet de dorure par électrolyse par Charles Christofle en 1842,de bijoutier il va devenir argenteur puis orfèvre. Les bourgeois n’ont plus besoin de consacrer autant d’argent pour acquérir de la vaisselle en argent, ils raffolent de l’orfèvrerie moins coûteuse. En 1846 Charles Christofle devient orfèvre, il fabrique lui-même les objets en créant les poinçons pour attester du titre et du maître. Une école d’apprentis existe à l’usine, elle forme en 5 ans un ouvrier, Christofle est une société patriarcale où beaucoup de droits sociaux sont donnés aux employés. Beaucoup d’objets sont exposés : cafetières, théières, chocolatières, bouilloires, le procédé par galvanoplastie va remplacer la dorure par électrolyse. La galvanoplastie s’obtient en coulant dans un moule l’objet que l’on recouvre de poudre de plombagine très bon conducteur d’électricité. On trempe l’ensemble dans un bain, le cuivre va venir adhérer au moule, le procédé réduit le prix de fabrication, c’est une révolution pour l’orfèvrerie. Christofle va produire grâce à la galvanoplastie des pièces plus importantes, les statues qui ornent le palais Garnier qui mesurent 7 mètres de haut, notre dame de la Garde à Marseille, le fronton de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, des monuments aux morts en bourgogne et en Alsace, mais, il ne néglige pas l’art de la table où il reste inégalé. Christofle a produit également la porte de la sacristie de Saint-Marc à Venise, elle mesure 2,5 mètres de haut, elle est en métal repoussé dont le relief est rebouché en étain. Les cloches et les réchauds de table voient leur ère terminée avec l’apparition du service à la Russe apporté par un ambassadeur russe En 1820 en France, la fourchette apparaît donc à gauche de l’assiette et les plats sont amenés à table l’un après l’autre. Les verres sont disposés devant l’assiette, c’est l’avènement du cristal de Saint-Louis et de Baccarat, nous apercevons un chandelier à 8 bougies. Christofle a beaucoup travaillé pour Louis Philippe et la famille impériale de Napoléon III, Nous pouvons admirer un meuble de toilette destiné à l’impératrice, une bibliothèque commandée par un pape, une vierge en argent massif et la maquette d’une voiture papale réalisée par Christofle. Dans la troisième salle on évoque tous les travaux à réaliser afin d’obtenir une pièce d’art : tourneurs, étameurs, repousseurs et polisseurs etc. Le travail pour planer le métal, l’étirer à l’oreille, le repousser, le percer, le tracer, ce sont toutes les tâches à effectuer par le décorateur avant la tâche finale le polissage. En 1850 Napoléon III invente les prix agricoles pour récompenser les éleveurs, nous pouvons en voir quelques-uns uns en exposition. Le Cloud du musée est une cafetière d’art bouveau dont la poignée représente un corps féminin dénudé enroulé autour d’un végétal, qui a obtenu le prix de Paris en 1880. L’art bouveau a duré une vingtaine d’années, il a vu l’émergence des végétaux et des animaux, beaucoup de pièces sont en forme de courge, de lapin, de lézard, un service de liqueur est réalisé en forme de feuille de platane. Dans la quatrième salle après la première guerre mondiale les grands restaurants le Fouquet’s, chez Maxim’s etc, chacun voulait une exclusivité dans l’art de la table. C’est l’époque du cubisme et de l’art déco, nous pouvons admirer un échantillon des 40000 pièces fabriquées pour la CGT (compagnie générale transatlantique) pour le paquebot le Normandie. Il faisait la traversée le Havre New York via l’Angleterre dès 1935, il a brûlé et coulé en 1942 dans le port de New York. Nous passons devant le lit commandé à Christofle par le Maradja, il pèse 290 kilos, 4 statues de femmes une grecque, une italienne, une tunisienne et une indienne ornent le lit. Les chevelures de femmes ont été conseillées par un coiffeur, un système sophistiqué d’éclairage et de musique accompagnait le repos du Maradja. Nous apercevons un service à absinthe, un couvert pliant des soldats de la première guerre mondiale, un monument pour les 300 ans de la mort de Jean de la Fontaine en 1995 avec tous les titres de ses fables œuvre commandée par sa ville natale. Nous découvrons la coupe papale créée en 1997 lors des JMJ (journées mondiales des jeunes) dans laquelle le pape a bu, l’original du calice a été offert à l’archevêché de Paris. Le créateur Charles Christofle est mort en 1863, après 2 heures de visite nous avons rejoint notre bus pour aller déjeuner à Saint-Denis.
Après le repas nous avons pris la direction de l’ancienne zone industrielle du XIX.me siècle, pour aller visiter le nouveau stade prétendant un temps aux jeux olympiques 2012. La France en 1988 se porte candidate pour organiser la coupe du monde de foot ball en 1998, en 1992 la France est choisie comme organisateur, il faut construire un stade de plus de 60000 places assises, le parc des Princes n’en contient que 45000. En mai 1995 le premier coup de pioche est donné, en novembre 1997 le stade de France est terminé. Pourquoi avoir choisi Saint-Denis parce que c’est très proche de Paris, pour ses facilités de transport 2 autoroutes, 2 lignes de RER, 2 lignes de bus, 1ligne de métro. En plus c’est un rééquilibrage des infrastructures sportives de Paris avec à l’est le palais omnisports de Bercy, au sud le stade Charletty, à l’ouest le parc des princes et Roland Garros et au nord à Saint-Denis le stade de France. Ce sont 4 architectes français qui ont remporté le concours international lancé par les organisateurs, le projet était très innovant par la forme sphérique du stade. Le stade a été construit en 31 mois sur un site de 17 hectares, il possède 45 kilomètres de gradins, son poids est de 550000 tonnes d’acier et de béton. Le stade peut contenir 80000 personnes, 25000 dans les tribunes hautes 30000 en tribunes intermédiaires et 25000 dans les tribunes basses. Le stade est modulable pour accueillir des matchs de football et de rugby, des concerts et des meetings d’athlétisme. Le stade a une capacité différente selon la manifestation 80000 personnes pour le foot et le rugby en protégeant la piste d’athlétisme avec des pavés en caoutchouc 100000 places pour les concerts en protégeant la piste d’athlétisme et la pelouse, 75000 places en rétractant les tribunes basses par des vérins électriques pour les meeting d’athlétisme. La rétraction des tribunes est de 15 mètres, l’opération s’effectue en 10 heures et elle coûte 100000 euros. Le toit est sphérique entièrement suspendu, il est haubané et pèse 13000 tonnes, par comparaison la tour Eiffel pèse 9000 tonnes. La superficie du toit est de 6 hectares équivalent à l’avenue des Champs Elysée, 1 hectare du toit est en verrière pour la luminosité nécessaire à la pelouse naturelle. Au-dessus du tunnel des joueurs se trouvent la tribune présidentielle, la loge présidentiel, puis la cabine de presse et des commentateurs qui peut contenir 800 personnes, enfin la régie qui supervise la sonorisation et l’éclairage. Un restaurant le Panoramique propriété du traiteur le Nôtre surplombe la pelouse, il peut recevoir 300 convives. Aujourd’hui sur la pelouse se déroule un tournoi interentreprises de la zone d’activité située autour du stade, l’équipe de sécurité du stade de France participe à cette manifestation. Des tribunes hautes nous descendons au niveau de la pelouse sous les tribunes basses, nous sommes sur la VCI (voie de circulation intérieure), elle fait le tour du stade, elle a une longueur de 800 mètres pour la logistique et toutes les tâches quotidiennes du site. 200 personnes sont employées à l’année, lors des évènements 2 à 3000 personnes sont nécessaire, le maximum de personnes a été de 5000 lors des championnats du monde d’athlétisme en 2003. Des magasins de stockage sont prévus pour les 43 buvettes, le long de la VCI on trouve un centre médical pour les premiers soins, un poste de police, un poste de pompiers ouvert toute l’année avec 3 pompiers en permanence. Lors des manifestations 20 pompiers sont en faction, les policiers assurent des cellules de dégrisement. On accède à la VCI par accréditation, les pompiers interviennent 1400 fois par ans pour la trentaine de manifestations organisées au stade de France. La VCI comme la pelouse se trouvent à 11 mètres sous terre, la pénétrante est-ouest a vu passer les 850000 mètres cube de terrassement, 500 kilomètres de câbles sillonnent le stade. Les camions qui transportent le matériel pour les concerts empruntent la VCI ainsi que le bus des joueurs et la voiture du président de la république. La voiture du président de la république s’arrête devant l’ascenseur 19 qui le conduira à la tribune présidentielle, par sécurité s’il est accompagné de son épouse cell-ci empruntera l’ascenseur 18. Nous sommes à l’endroit où s’arrête le bus des joueurs, dans le couloir le premier vestiaire est celui des arbitres, le protocole voudrait que le vestiaire des invités soit le plus près de la sortie. Lors de la finale de la coupe du monde 1998, le Brésil a souhaité le tirage au sort pour l’attribution des vestiaires, le Brésil a choisi Le vestiaire de l’équipe de France, depuis par superstition la France a gardé le vestiaire des invités. Les vestiaires sont identiques, ils ont été pensés et conçus par Michel Platini, ils ont une surface de 200 mètres carré, le sol est en résine. Le capitaine est toujours placé près du bureau de l’entraîneur, les gardiens de buts sont placés dans les angles du vestiaire car ils ont plus de matériel, les joueurs de même club sont toujours ensemble, tous les maillots des joueurs actuels sont placés à leur place respective. Auparavant le rugby pouvait sélectionner 23 joueurs, depuis 2000 la sélection est de 22 joueurs comme au football. Une place est donc libre à l’extrémité du vestiaire, c’était celle de Zidane qui timide et réservé préférait s’isoler. Depuis son départ par superstition et respect, aucun joueur n’a voulu prendre sa place. A proximité du vestiaire est située la salle d’échauffement, dans laquelle la température est de 5 degrés de plus que le vestiaire, juste avant le match la température atteint 35 degrés afin de réchauffer les muscles avant le début du match. La salle d’échauffement sert de loge pour les artistes en concert, Johnny Halliday avait fait installer un juke-boxes, un flipper et un billard, quant aux Rolling stones ils avaient apporté un bar de 30 mètres de long. Nous sommes dans le hall des joueurs où se déroule l’intimidation, puis le tunnel ou couloir magique et nous voici sur la pelouse. La pelouse pousse à Orléans et à Fontainebleau avant d’être plantée au stade de France, elle est remplacée 2 à 3 fois par an pour un coût de 150000 euros à chaque fois. Les aiguilles de l’horloge du stade mesure respectivement 2,2 mètres et 1,40 mètres de longueur, les 2 écrans géants rassemblés on une surface de 240 mètres carrés ou la valeur d’un terrain de tennis. Toutes les grandes entreprises possèdent une loge de 10 à 30 personnes dont le prix varie de cent mille à deux cent mille euros par an suivant l’emplacement. Le stade compte 168 loges dont 160 sont louées cette année. Des escaliers monumentaux mènent aux tribunes hautes, des passerelles accèdent aux tribunes intermédiaires, des glacis (pente douce) permettent d’accéder aux tribunes basses. Ce qui permet une bonne fluidification du public, le stade se vide en 30 minutes et 10 minutes en cas d’alerte. Les spectateurs des différentes tribunes ne peuvent donc pas se croiser ni même aux toilettes et aux buvettes, le seul point de convergence est le parvis du stade. Le stade est enterré pour ne pas dominer la basilique, s’intégrer au milieu urbain et pour diminuer la hauteur des escaliers (35 mètres) qui mènent aux tribunes hautes. Le stade est géré pour 57 pour cent par un consortium le reste étant l’état. Le stade a coûté 410 millions d’euros soit pour la part de l’état 3 euros par habitant. Le stade de France est une pièce architecturale, 1500 employés se sont affairés à sa construction. Après la culture industrielle et sportive nous prenons la direction de la basilique de Saint-Denis, qui est située au centre de la ville près de la nouvelle mairie. Saint Denis, premier évêque de la ville de Paris, aurait vécu au 3e siècle, avant d'être persécuté par l'empereur Dèce et de mourir décapité. On l'a assimilé
á Denis l'Aréopagite, disciple converti par
Saint Paul au Ier siècle, à Athènes. C'est dans la "vie de sainte Geneviève", récit de 520, qu'est indiqué l'emplacement de son tombeau, au nord de la ville. Une des légendes raconte qu’il a été décapité à Montmartre, il aurait pris sa tête tranchée dans ses main, il serait tombé dans la campagne où il aurait été enterré en cachette par une pieuse femme. sIl fait l'objet d'un culte dès
le 4e siècle. Une première église aurait été édifiée vers cette époque ou au siècle suivant.
Au VIIe siècle, la basilique est choisie comme lieu de sépulture par Dagobert et sa famille. Le roi fonde un monastère à sa proximité. Elle devient ainsi un centre mérovingien important dont la reine Bathilde fait un monastère en 650.
En 741, Charles Martel y est inhumé. Saint Denis, en abritant le panthéon de la première dynastie, devient donc le premier sanctuaire carolingien. L'implication progressive des abbés de Saint Denis dans la vie politique atteint son apogée quand Charles-le-Chauve prend lui-même ce titre (867).
La construction de l'église carolingienne est initiée par l'abbé Fulrad et s'achève en 775, grâce à l'aide de Charlemagne. L'édifice est alors composé d'une nef à trois vaisseaux et de neuf travées et s'achève par une abside surélevée, en raison de la présence d'une crypte : ceci annonce le schéma actuel. L'abbatiale est agrandie à l'est en 832. Les innovations de Suger : la naissance du gothique L'abbatiale a été transformée sous l'impulsion de Suger, qui a longuement expliqué ses choix. Nous ne citerons pas ici les choix iconographiques, qui seront évoqués dans la visite, mais simplement les innovations architecturales.
Suger commence par remanier le narthex (dédicacé en 1140). Il opte pour la façade harmonique qui était apparue pendant la période romane.
Saint Denis constitue le premier exemple de son utilisation en Ile-de-France. La façade comporte pour la première fois une rose au-dessus du portail central. La composition est claire et le programme sculpté, réparti sur les trois portails, d'une ampleur inusitée à l'époque. Des statues-colonnes garnissaient les ébrasements, comme à Chartres et le trumeau du portail central présentait une statue de Saint Denis. Le tympan du portail gauche était orné d'une mosaïque, qui se voulait une référence aux basiliques antiques. Ces derniers éléments ont aujourd'hui disparu.
L'architecture du chevet (construit entre 1140 et 1144) est plus innovante encore. Si le chevet est agrandi, ce n'est pas pour répondre aux besoins des religieux, dont les stalles restent dans les travées orientales de la nef, mais bien pour donner plus de place aux reliques de Saint Denis. Suger conçoit d'abord une nouvelle crypte, qui englobe les cryptes carolingiennes, donnant au chevet de solides fondations. Dans la partie haute comme dans la crypte, le chœur est entouré d'un déambulatoire ouvrant sur des chapelles rayonnantes. Leur disposition est originale dans la mesure où ces chapelles rayonnantes sont juxtaposées. Jusqu'ici, dans les grands édifices romans (comme Saint Sernin de Toulouse ou Saint Benoît sur Loire) elles étaient séparées par une travée de déambulatoire directement éclairée par une fenêtre. De plus, chacune chapelle de Saint Denis est éclairée par deux fenêtres, alors qu'il y en a traditionnellement 1 ou 3. Ce choix novateur est sûrement conditionné par la largeur des baies. En effet, dans la nouvelle oeuvre, une grande place est donnée aux vitraux et à la lumière. Dans tout le choeur sont recherchés la légèreté et l'évidemment des formes. C'est pourquoi l'architecte employé par Suger fait appel, dans la partie haute, à une technique naissante, la voûte d'ogives, dont il fait un usage sans précédent par sa qualité et son inventivité.
Biographie de Suger
Suger naît en 1081 dans une famille d'origine modeste. Il est offert par son père comme oblat à l'abbaye de Saint Denis, alors qu'il a 10 ans. Pendant ses études, qui durent 10 ans, il rencontre le futur Louis VI. Il entre dans la vie publique en 1106 et se voit confier des missions diplomatiques importantes par son abbé. Aux côtés du roi, il entame une guerre contre Hugues, seigneur de Puiset, dont il gardera un constant remords. A partir de 1112, il est souvent en contact avec Rome. Il rédige pour Louis VI une charte de donations à Saint Denis. Il est élu abbé en 1122. Suite à cette élection, il séjourne 6 mois en Italie, ce qui constitue pour lui une expérience déterminante. Il découvre l'architecture des basiliques romaines et du Mont Cassin, ce qui lui permet de mieux appréhender l'architecture chrétienne. Il utilisera ces connaissances pour élaborer le programme architectural et iconographique de Saint Denis.
Il envisage très tôt d'agrandir la basilique et réunit les sommes nécessaires à cette entreprise. Il fait d'abord construire l'avant-nef, se préoccupant tout particulièrement de l'iconographie des portails. Il poursuit son oeuvre par l'agrandissement du chevet, avant que les tours de la façade ne soient achevées.
Parallèlement, il commence une historiographie royale (qui sera par la suite le propre de l'abbaye) en écrivant la vie de Louis le Gros. Mais c'est surtout dans la pierre que s'exprime le souci de pérennité de Suger. Il s'appuie sur la pensée d'Hugues de Saint Victor pour considérer l'art comme un support spirituel. Sa conception de l'art religieux, qu'il veut luxueux pour honorer Dieu, contredit entièrement celle de Saint Bernard.
Suger est aussi un homme d'Etat qui exerce une grande influence auprès du roi de 1112 à 1137 puis à partir de 1144. Il exerce la régence de 1147 à 1149, lorsque le roi part en croisade. Il dissuade d'ailleurs ce dernier de répudier sa femme Aliénor et de déclarer la guerre aux Anglais. La répudiation et la guerre avec les Anglais n'interviendront qu'après sa mort en 1151.
Les travaux du XIIIe siècle
Cependant, entre la nouvelle façade et le nouveau chevet subsiste la nef carolingienne. En 1231, l'abbé Eudes Clément, avec le soutien de Saint Louis et Blanche de Castille, décide de reprendre les travaux. Il décide de conserver la façade et le déambulatoire rayonnant de Suger. Mais l'harmonisation entre le choeur du XIIe siècle et les nouveaux éléments exige de transformer le choeur. Le choeur de Suger est donc démonté jusqu'aux abaques des colonnes. Ces dernières sont remplacées par des piles plus solides, capables de soutenir une plus forte élévation.
Les abaques sont d'ailleurs retaillés pour permettre à des colonnes engagées de monter directement jusqu'aux voûtes. On recherche avant tout une plus grande verticalité, en alignant les arcades du triforium et les lancettes des fenêtres. On choisit de faire un transept très large (doubles bas-côtés) pour répondre au besoin de la nécropole royale qui y a pris place depuis le XIIe siècle. Ce transept gothique rayonnant est achevé vers 1260. A l'extérieur, côté nord, on loge dans le portail un tympan qui date de l'époque de Suger (vers 1160). L'édifice est consacré en 1281. Le mélange des parties du XIIe et XIIIe siècle est réussi. La contribution de Pierre de Montreuil (l'architecte du croisillon nord de Notre Dame de Paris) n'est pas toujours aussi importante que l'on croit. Il n'a probablement pas participé à l'élaboration du projet initial. Il est vraisemblablement l'auteur de la claire-voie des trois travées orientales de la nef. Nef Après le XIIIe siècle, aucun travail d'ampleur n'est entrepris sur l'église (ce qui n'est pas le cas des bâtiments monastiques), à l'exception de l'ajout de chapelles latérales au nord de la nef au XIVe siècle. Une basilique tombeau des rois orants de Marie-Antoinette et Louis XVI Initiés sous les mérovingiens, les liens entre Saint Denis et le pouvoir royal vont en se renforçant. Si Saint Denis ne parvient pas à arracher à Reims le sacre des rois, elle devient la nécropole officielle des rois. A de rares exceptions près (Philippe Ier, Louis VII et Louis XI) toutes les dépouilles des rois y sont inhumées. Après Saint Louis, Saint Denis est même exclusivement réservé aux couples royaux. Cependant, la règle ne s'applique pas aussi fermement aux reines (en revanche, certaines y sont sacrées).
Orants de Marie-Antoinette et Louis XVI (commande de Louis XVIII en 1816 à Edme Gaulle et à Pierre Petitot, réalisée en 1830).
La guerre de Cent ans, puis les guerres de religion, entraînent un déclin progressif de Saint Denis. En 1633, la congrégation de Saint Maur reprend l'abbaye en main, ce qui entraîne, comme bien souvent, la reconstruction des bâtiments monastiques au cours du XVIIIe siècle. Quelques modifications malheureuses interviennent sur la façade entre 1770 et 1785 : le trumeau du portail central est détruit, la mosaïque du portail de gauche est remplacée par des sculptures et les statues-colonnes des ébrasements sont éliminées.
Pillages et restaurations
En 1790, de nombreux pillages ont lieu. Les tombeaux royaux sont profanés. En 1793, l'église est fermée. Un an plus tard, le plomb des dalles de la toiture est fondu, laissant la basilique livrée aux intempéries.
C'est Napoléon qui fait procéder aux premières restaurations en 1805. En 1816, Louis XVIII ordonne la reconstitution de la nécropole royale. Les ossements des Bourbons sont remis dans la crypte Une grande phase de restauration commence ensuite en 1833. Jusqu'en 1846, les travaux sont confiés à l'architecte Debret. A cette date, des lézardes apparaissent dans la tour nord et celle-ci doit être démontée.
Une cabale s'ensuit contre l'architecte, qui cède sa place à Viollet-le-Duc.
Le projet d'achèvement de la façade occidentale, conçu en 1860 ne sera jamais mené à terme. Néanmoins la basilique est définitivement consolidée. Depuis 1966, la basilique a aussi le statut de cathédrale. C’est au pas de course et dans une ambiance de répétition de l’orchestre de radio France que nous allons faire la visite de la basilique et de sa nécropole.
Les tombeaux des rois de France sont disposés par dynastie les mérovingiens, les carolingiens et les capétiens. Les rois sont représentés par des gisants, c’est Saint-Louis qui a eu l’initiative de construire les tombeaux suite aux saccages des tombeaux précédents. On parle même de la commande de Saint-Louis pour ces tombeaux réalisés au XII.me siècle époque où la France rayonnait, Saint-Louis avait fait l’acquisition des reliques du Christ à Constantinople. Les tombeaux des rois sont ornés d’un lion pour la force de caractère, un chien est placé sur le tombeau des reines pour la fidélité. Saint-Louis est mort à Carthage, on a fait bouillir son corps en Tunisie, on a laissé ses chaires à Palerme, le plus important ses os ont été transportés à Saint-Denis. L’importance des os dans la religion catholique a longtemps perduré, ce qui s’est traduit par l’interdiction d’incinération. Le cœur de François I a été ramené de Rambouillet après la révolution à Saint-Denis où il se trouve dans un monument du style de l’école de Fontainebleau, le tombeau de François I existe par ailleurs. Il est à étage décoré D’un F pour François, d’une salamandre et de 3 fleurs de lys symbole de la royauté en France. Louis XVIII a beaucoup intégré de rois bourbons pendant son règne à Saint-Denis, il voulait que sa dynastie soit très représentée, les rois bourbons n’ont pas de tombeaux. Ils sont disposés dans des cercueils qui reposent sur des tréteaux, on peut apercevoir les filles de Louis XV. Des cellules au-dessus des cercueils contiennent le cœur du défunt, celui de Louis XVII mort à la prison du temple a intégré la nécropole de Saint-Denis en 2004 après avoir subi des tests ADN. Nous sommes dans le martyrium où s’il a existé doit être enterré Saint-Denis, comme tout Saint-Patron ses reliques se trouvent sous l’autel de l’église. Encore aujourd’hui on met à jour des tombeaux lorsqu’on effectue des fouilles, nous pénétrons dans la crypte des bourbons. Louis XVIII y est présent, mais Charles X est mort en exil et personne ne le réclame. Louis XVI et Marie-Antoinette ont leur place parmi les bourbons, malgré qu’ils aient été guillotinés sur la place de la Concorde parmi 180 autres condamnés dont tous les corps ont été enterrés au cimetière de la Madeleine les corps recouverts de chaux. C’est tout à fait normal qu’ils soient tout de même présents virtuellement parmi les bourbons, tous les ans des associations royalistes viennent faire des cérémonies dans ce lieu le 16 janvier pour Louis XVI. Nous parcourons le déambulatoire de la crypte, toutes les colonnes sont travaillées le déambulatoire permet d’effectuer le tour des saints. Nous abordons le transept de la basilique où les musiciens continuent d’accorder leurs instruments, le roi Dagobert a son tombeau en évidence, il est considéré comme le premier roi de France. . Clovis étant enterré à Paris à Sainte-Geneviève, la rivale de Saint-Denis ce qu’il fait qu’il n’est pas reconnu par la royauté. Pour les moines de Saint-Denis prétendaient que le vrai roi de France était Saint-Denis, la couronne de France était conservée par les moines de Saint-Denis, elle était transportée à Reims pour le couronnement puis rapportée à Saint-Denis, aujourd’hui la couronne est exposée au musée du Louvre. De nombreux tombeaux sont situés dans la basilique dont celui de Henri II et de Catherine de Médicis. Nous sortons dans le square qui entoure la basilique, au sol est dessiné l’emplacement de l’ancienne chapelle des Valois dans laquelle se trouvait auparavant le tombeau de Henri II et de Catherine de Médicis. Nous pouvons admirer un superbe portail antérieur à Suger, c’est une des plus anciennes sculptures gothiques au monde. Si le Saint-Patron des irlandais est Saint-Partrick, celui des anglais est Saint-Georges à degré moindre celui des français est Saint-Denis. Ensuite nous avons rejoint le restaurant pour le dîner, ensuite nous avons assistés au concert à la basilique de Saint-Denis. Après une journée bien remplie, nous avons rejoint Versailles pour aller dormir chez le roi soleil.
(8) Nous prenons la direction de Meaux et Lagny pour nous rendre dans le village natal de Louis Braille, Coupvray se trouve en bordure du canal. La maison familiale et natale de Louis Braille est une habitation rurale du XIX.me siècle qui a été transformée en musée. Louis Braille est né le 4 janvier 1809 à Coupvray qui se situe en Seine et Marne à une quarantaine de kilomètres de Paris, il s’est blessé dans l’atelier de bourrelier de son père à l’œil droit à l’âge de 3 ans, suite à une infection il est devenu aveugle à 5 Ans. Nous commençons la visite par la pièce commune où vivait toute la famille Braille composée des parents et de 4 enfants, c’est la seule pièce de la ferme qui était chauffée, nous apercevons le lit des parents, les enfants dormaient au grenier et l’hiver ils descendaient leurs paillasses pour profiter de la chaleur. Le père de Louis Braille était bourrelier et vigneron, une cave est située sous la maison pour entreposer le vin, un puits accolé à la maison permettait de se satisfaire en eau. Dans la pièce commune se trouve le four à pain, la cheminée, un endroit dans le mur était réservé pour la fabrication du fromage, un évier est situé près de la porte d’entrée, de nombreux ustensiles du XIX.me siècle sont exposés. L’avenir de Louis Braille était très compromis quand il est devenu aveugle, à cette époque le seul moyen pour vivre était de mendier, ses parents ont voulu lui donner de l’instruction. Son père lui avait fabriqué un alphabet en relief afin qu’il appréhende les lettres et les chiffres avec des clous de bourrelier, le curé du village commença à l’instruire. Louis Braille avait des capacités pour apprendre, il a donc fréquenté l’école du village, ne pouvant ni lire ni écrire, il mémorisait tous les cours. Il était le meilleur de la classe malgré son handicap, mais il ne pouvait pas suivre une scolarité normale. Sa chance c’est que le châtelain de Coupvray le marquis d’Orvilliers faisait partie des donateurs, qui après la révolution ont permis de créer l’institut national des jeunes aveugles à Paris. Il lui fit connaître l’INJa et poussé par le curé et ‘instituteur du village il intégra l’institut à l’âge de 10 ans. Après avoir été un élève brillant, à 19 ans il est devenu professeur à l’Inja, il lisait grâce au système de lettres en relief inventé par Valentin Haüy, cette méthode de lecture était difficile pour un aveugle par contre l’écriture était impossible. Le procédé de Valentin Haüy était très coûteux à concevoir, il n’existait en tout et pour tout que 14 livres transcrits. Le capitaine Barbier de la Serre avait inventé une méthode de lecture dans le noir grâce à des points en relief à des fins militaires, il la proposa à l’INJA et ne fut pas retenu au grand regret des aveugles. Louis Braille âgé de 15 ans améliora le système du capitaine Barbier de la Serre en ramenant le nombre de points en relief de 12 à 6, en abandonnant une lecture phonétique pour une lecture orthographique, en combinant 46 figures géométriques avec les 6 points il fabriqua les lettres, les chiffres, les signes de ponctuation et de mathématique, les majuscules et plus tard il créa les signes de musique en relief toujours avec les 6 points. Son système ne fut pas tout de suite adopté, il est mort en 1852 inconnu, il a fallu attendre 1880 pour que le braille sorte de son anonymat. C’est à cette époque que l’on a édifié une tombe au cimetière de Coupvray et un monument près de la mairie. Le premier INJA était situé près de Jussieu où coule la Bièvre, endroit très humide c’était insalubre, les élèves étaient très mal nourris et ils étaient souvent malades. Chaque année sur les 100 élèves on comptait 6 décès, Louis braille a certainement développé sa maladie pulmonaire dans ce lieu. En 1843 Valentin Haüy transféra l’INJa au boulevard des Invalides dans des bâtiments neufs, Louis Braille était déjà malade, on y dispensait le français, les mathématiques, l’histoire, la géographie et les langues. Valentin Haüy était interprète auprès du roi, il maîtrisait 15 langues. L’INJa formait les aveugles à des travaux manuels et à la musique. Louis Braille est entré au Panthéon en 1952 pour le centenaire de sa mort, on a laissé ses mains sculptées au cimetière de coupvray, c’est une sourde et aveugle qui l’a accueilli au panthéon en lui rendant hommage. Nous sommes dans l’atelier où Louis Braille s’est blessé, il est toujours resté célibataire. Nous montons au grenier que Louis Braille avait transformé quand il était à Paris, nous avons pu toucher toutes les méthodes de lecture pour les aveugles. Nous avons vu la tablette qu’utilisait Louis Braille et une machine appelée décapoint inventée par Louis Braille, qui permettait à un aveugle de dessiner des lettres en noir sur papier carbone. Après une heure de visite nous avons repris notre autocar pour aller déjeuner, ayant tout perdu à chantilly certain on voulu se refaire en grattant des jeux.
Nous reprenons la route, en traversant Choisel nous apercevons la façade de l’usine du chocolat Meunier joyau d’architecture industrielle. Jean-François Meunier 1795-1853 dinamisa toute la région, il a construit l’empire Meunier de manière patriarcale, aujourd’hui Meunier est la propriété de Nestlé. Nous contournons le nouveau quartier de Noisy le grand dont l’architecte est Ricardo Bofill, celui même qui créa le quartier Antigone à Montpellier. Nous nous arrêtons à Nogent sur marne, devant le pavillon Baltard, qui était malheureusement fermé. Nous continuons à descendre la marne, nous approchons de Chanpigny sur marne longtemps administrée par Georges Marchais, nous nous arrêtons aux portes de Paris au Raincy, nous visitons l’église construite en 1922 par les frères Perret qui étaient tout comme Le Corbusier les précurseurs de la construction en béton. Tous les murs latéraux sont faits de vitraux réalisés par Maurice Denis, qui était un des piliers du mouvement Napy. L’église est un sanctuaire voué aux batailles de la marne de la première guerre mondiale, sous l’impulsion du chanoine nègre et des généreux donateurs de la paroisse. Le cloché culmine à 50 mètres, la pente naturelle du terrain met l’autel en élévation, l’église mesure 56 mètres de long et 29 mètres de large. Ensuite nous avons rejoint Joinville-le-pont, nous avons été guinchés dans une guinguette où nous avons mangé des moules frites arrosées comme dans la chanson du fameux petit vin blanc du côté de Nogent. Avant de quitter les bords de marne, Martine nous a présenté Toine et Toinette, qui ont fait réagir certaines personnes, enfin nous avons rejoint Versailles pour y prendre un repos bien mérité.
(9) Aujourd’hui dimanche nous allons continuer la visite du château de Versailles, nous profitons de la musique royale du XVII.me siècle diffusé dans les jardins de Versailles qui nous met dans l’ambiance de la cour du roi soleil. Nous commençons par le palais de chasse de Louis XIII, embelli par Louis XIV qui a été le premier château de Versailles. La construction est en brique rouge , le toit est en ardoise du début du XVII.me siècle, Louis XIII par légende ou tradition venait chasser au petit village de Versailles, quand il était tard pour rentrer au Louvre Louis XIII de goût simple couchait sur place dans une petite auberge modeste. Les gentils hommes qui l’accompagnaient, faisaient grise mine pour le manque de confort, Louis XIII décida donc de construire le pavillon de chasse. C’est depuis le balcon de celui-ci que Louis XVI et Marie-Antoinette sont apparus pendant les journées d’octobre 1789, ils quitteront définitivement le château de Versailles et plus personne ne l’habitera, Louis XIV a fait construire 2 ailes en brique rouge accolées au pavillon de chasse pour venir y habiter, nous découvrons les grandes écuries en forme de fer à cheval construites par Mansard. Les grandes écuries accueillaient les chevaux de guerre et de chasse, les petites écuries étaient réservées aux chevaux de trait. Nous commençons à descendre la perspective au milieu de jardins, de bassins et de bosquet. L’orangerie construite par Mansard soutient la terrasse sud, elle date de 1682 année où Louis XIV âgé de 44 ans a aménagé le château de Versailles. Très fier de ses jardins Louis XIV les a fait peindre par un peintre de la cour, les tableaux sont exposés au grand Trianon, ils ont servi pour la restauration du parc. Tous les matins Louis XIV empruntait les 100 marches pour aller rejoindre le potager, sur le conseil de son médecin il lui fallait une activité, il allait donc apprendre à tailler les arbres avec son jardinier personnel. Nous longeons le bassin des suisses, qui a été recreusé par les suisses d’où son nom. D’immenses parterres de fleurs nous entourent, nous sommes dans le chef-d’œuvre de le Nôtre qui a réalisé ces jardins à la française afin de divertir les 2000 courtisans qui habitaient le Château. Nous passons devant le miroir d’eau composé de 2 immenses bassins, sur le bord des bassins sont dessinés en fonte les grands fleuves et rivières de France. Nous marchons au milieu de fontaines et de fleurs, le géranium n’a été introduit en France que sous Louis XV. Les pièces d’eau réalisées par Mansard sont décorées de gigantesques statues, dont une qui représente une femme qui tient dans ses bras Apollon dieu du jour et Diane la déesse de la nuit et de la chasse. Tout le système hydraulique qui permet d’alimenter les bassins en eau date de Louis XIV, depuis cette époque c’est la même machinerie qui fait cracher les statues et les jets des bassins. Bien sûr les bassins sont ici pour émerveiller l’œil, mais ils ont également été creusés pour assécher les marécages du lieu. Toujours accompagnés de musique nous traversons des bosquets, la rocaille est présente dans de petites clairières. Au milieu d’un bosquet se trouvait une salle de bal ou salon en plein air, le roi recevait l’hiver dans ses appartements au château, l’été il aimait donner des fêtes dans le parc du domaine. Le salon est en forme d’amphithéâtre, les gradins sont décorés par des coquillages, des silex et des concrétions. Des chandeliers et des chandelles éclairés l’ensemble, l’orchestre était situé en haut des emmarchements. Louis XIV dansait sur une plaque de marbre située au milieu du salon, il dansait très bien, les dames de la cour pouvaient le contempler depuis les gradins engazonnés. A l’âge de trente ans Louis XIV se trouvait trop vieux, il a décidé d’arrêter la pratique de la danse. Nous traversons un jardin à l’anglaise créé sous Louis XVI qui a pris place à un bosquet, le jardin à l’anglaise était très à la mode à cette époque. Après près de 2 heures de déambulation dans le parc du château nous avons rejoint le petit train pour se rendre au Trianon, mais devant la menace orageuse nous avons préféré retourner à l’hôtel pour se vêtir de circonstance.
Puis nous sommes allés déjeuner dans un restaurant qui se trouve juste en face du château, le repas terminé nous sommes allés aux grandes écuries pour assister au spectacle équestres de Bartabas. On nous raconte toute l’apologie du cheval, une musique de circonstance accompagne les chorégraphies des chevaux, les combats des cavaliers aux sabres. Les chevaux passent de la position statique à des passes de danses, des roulades, des cambrages etc, les chevaux simulent entre eux des combats, un petit cheval répond à son dresseur au doigt et à l’œil. Le manège et les gradins sont en bois, l’école du cheval de Versailles existait avant celle de Saumur, c’est Napoléon qui l’a fait transféré de Versailles sur les bords de la Loire. Après la révolution les chevaux avaient disparu de Versailles, les grandes écuries de Mansard étaient devenues de véritables ruines. Elles étaient du domaine public, elles appartenaient au château de Versailles, il y a dix ans on a décidé de les restaurer. Pour faire revivre les grandes écuries on a fait un appel d’offre, c’est Zingaro (Bartabas), qui a été choisi grâce à l’esprit qu’il voulait garder des grandes écuries de l’ancien régime de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Sous l’ancien régime les jeunes nobles (pages) venaient aux grandes écuries pour parfaire la monte à cheval, le maniement de l’épée, le dressage du cheval pour devenir de futurs soldats du roi. Pendant leur formation les pages apprenaient à soigner leur monture, les mathématiques et le chant. Bartabas a pris toute cette tradition de l’école des pages, en donnant la charge de 4 chevaux à 2 jeunes qui pendant 2 ans, après avoir été sélectionné sur cassette apprennent l’archéologie équestre modernisée à l’académie équestre de Versailles. Les jeunes pratiquent la danse pour la souplesse et l’élégance, le chant afin de pouvoir s’extérioriser. Le projet a été financé par le ministère de la culture, la région, le département, la ville de Versailles et bien sûr par le château. L’architecte du manège Patrick Bouchin a donné à l’ancien manège très triste une superbe salle des fêtes et de spectacles, en jouant sur des miroirs pour rappeler la galerie des glaces et des sculptures. Les sculptures ont été réalisées par Jean-Louis Sauvat avec les copeaux et chutes de bois obtenues lors de la restauration du manège, elles représentent des chevaux, le décorateur a également dessiné des scènes équestres au fusain sur les murs. Quant au couturier belge Van Nouten, il a créé les costumes des cavaliers qui se produisent dans le spectacle de Bartabas. La plupart des jeunes qui fréquente l’académie équestre sont des filles, Bartabas raconte « lorsqu’un garçon a de l’argent il s’achète une moto, quant une fille a de l’argent elle s’achète un cheval), les filles ont beaucoup plus de sensibilité pour le dressage des chevaux. A la fin de leurs 2 ans de formation les jeunes peuvent restés à l’académie équestre de Versailles, ils n’ont pas de peine s’ils le désirent de trouver un emploi après leur cycle d’études. Ensuite nous avons traversé les grandes écuries, elles font 20 mètres de haut et mesurent 100 mètres de long. Elles sont identiques de l’époque de Louis XIV, elles sont ornées de chapiteaux, de colonnes et de consoles. Tous les boxes sont occupés par les chevaux de l’académie équestre, ils sont de toutes origines portugais, anglais, irlandais et arave. Suite à un embouteillage dans les grandes écuries et à un emballement de notre guide, nous avons perdu notre groupe, Claude, Jean-Pierre et Michel nous sommes rentrés à notre hôtel. Une fois tout le monde rassemblé, nous avons pris notre dernier dîner à Versailles, puis il nous a fallu faire la valise du retour avant de se glisser dans le lit.
(10) Aujourd’hui c’est le départ, nous rejoignons Montpellier en empruntant l’autoroute A6. Vers midi nous nous arrêtons à Tournus, où nous allons déguster un succulent repas dans un superbe restaurant appelé les Remparts. C’est dans une somnolence générale que nous continuons notre route, à 20 heures juste Thierry nous fait toucher notre but final, la gare de Montpellier.
Claudine Passepont et Michel Michelland